Cinéma : Belfast, de Kenneth Branagh
3 minutes de lecture

Le réalisateur Kenneth Branagh est prolifique, c’est le moins que l’on puisse dire, son adaptation de Mort sur le Nil est encore projetée dans la plupart des cinémas qu’un nouveau film sort en salles. Cette qualité de l’artiste a pour fâcheuse contrepartie la réussite aléatoire de ses projets. En atteste précisément son travail sur l’œuvre d’Agatha Christie, criard sur le plan visuel, cabotin dans son interprétation et idéologiquement douteux. On sait pourtant que le cinéaste est capable du meilleur ; souvenons-nous de son Frankenstein (1994) avec Robert de Niro ou de sa version de Hamlet (1996) qui fit connaître Derek Jacobi au public français.
Avec Belfast, il semble que Kenneth Branagh ait retrouvé l’inspiration des beaux jours.
Nous évoquions récemment, sur Boulevard Voltaire, les cinquante ans du Bloody Sunday et les raisons qui aboutirent à cette tragédie. Comme en écho à ce bien triste anniversaire, le nouveau film de Branagh prend pour contexte le début des « troubles » en Irlande du Nord à l’été 1969.
Il faut savoir qu’à l’époque, depuis deux ans, le climat ne cessait de se détériorer entre les communautés protestantes et catholiques. Les « papistes », comme les appelaient les unionistes, multipliaient aux côtés de la Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) les marches pacifistes en vue d’obtenir une meilleure représentation politique ainsi que l’égalité des droits en matière d’embauche et dans l’attribution des logements. En réaction à ce mouvement, en août 1969, des casseurs loyalistes se ruèrent dans les quartiers catholiques de Belfast et mirent le feu aux habitations. Le 15 au matin, on dénombrait 7 morts et 750 blessés. 1.800 familles, dont 1.500 catholiques, avaient été contraintes d’abandonner leur domicile en flammes. En reprenant possession des lieux, les soldats britanniques furent pratiquement accueillis en libérateurs par les populations catholiques (!). Pierre Joannon, dans son Histoire de l’Irlande, se risque même à évoquer une tentative « d’épuration ethnique » de la part des orangistes, c’est dire le degré de violence des affrontements.
Dans ce contexte très particulier démarre le récit de Kenneth Branagh. Librement inspirée de son enfance, cette autofiction relate avec nostalgie les derniers mois vécus à Belfast par l’auteur et sa famille avant de partir s’installer en Angleterre pour fuir les conflits.
Ouvriers protestants, les parents de Buddy sont issus de la majorité confessionnelle et n’ont pas de raison, a priori, de se sentir menacés. Pacifistes, néanmoins, ils désapprouvent le sort réservé à leurs voisins de quartier catholiques, régulièrement agressés et contraints, sous la pression, de déménager les uns après les autres. Une compassion qui sera reprochée au père et l’exposera à la vindicte d’un caïd local.
Au milieu du chaos ambiant et des problèmes financiers de ses parents, Buddy parvient malgré tout à préserver son innocence, garde sa capacité d’émerveillement – devant les westerns américains, les feuilletons télévisés ou lorsqu’il joue à pourfendre les dragons avec son épée de bois –, s’interroge sur les voyages lunaires et rêve d’épouser la meilleure élève de sa classe. Cette dernière préoccupation, du reste, fait l’objet de graves discussions entre Buddy et son grand-père paternel, incarné à merveille par Ciarán Hinds, peu avare en conseils de séduction et autres techniques d’approche. Le point fort du film de Branagh se situe probablement dans cette relation complice et privilégiée qu’entretiennent le vieil homme et son petit-fils. Âgé de dix ans seulement au moment du tournage, Jude Hill fait preuve d’une maturité déconcertante dans son approche du métier de comédien. Vif, le gamin n’a aucun mal à saisir les enjeux du récit et à porter le film sur ses épaules.
Le cinéaste cède bien à quelques facilités du genre, qu’il s’agisse de stéréotypes sur l’enfance ou de l’utilisation du noir et blanc pour signifier l’idéalisation des souvenirs ; cependant, le regard distancié et ironique qu’il pose sur ses personnages aux dialogues (souvent) espiègles rattrape largement ces défauts mineurs.
4 étoiles sur 5
Thématiques :
BelfastPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées








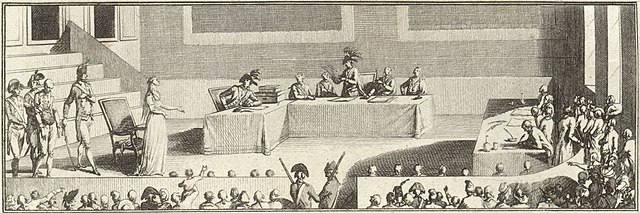





























3 commentaires
Le Crime de l’Orient-Express de Brannagh est de loin la pire des adaptations du roman. Comme acteur, il lui faut un théâtre, pas une caméra. Et comme réalisateur, j’étais prêt à l’éviter comme la peste. Mais si vous dites qu’il lui arrive d’être bon…
Mort sur le Nil idéologiquement douteux ? pourquoi ? au contraire pour satisfaire au multiculturalisme on a introduit des personnages issus de « la diversité » qui n’existaient pas dans le roman. Pour le reste d’accord, beaucoup de bruit, d’agitation, qui n’ont rien à faire avec Hercule Poirot.
La bande annonce en tous cas donne envie…. Comme tous les parias non vaccinés, j’attends le 15 pour aller au ciné.