[CINEMA] Le Joueur de go, vertu et déclin du samouraï

Le Japon, en plein shogunat des Tokugawa, sous l’ère d’Edo (1603-1868).
Yanagida est un rōnin (littéralement, « homme au gré des vagues », un samouraï sans maître), tombé jadis en disgrâce après avoir été victime d’accusations calomnieuses. Vivant pauvrement avec sa fille Okinu dans le célèbre et sulfureux quartier de Yoshiwara, situé dans la capitale, le bushi subvient aux besoins du foyer en confectionnant des sceaux pour une clientèle restreinte. Son seul plaisir dans l’existence est le jeu de go, qu’il maîtrise à la perfection mais par le biais duquel il se refuse, par principe, à gagner de l’argent, conformément au code d’honneur du samouraï. Le talent de Yanagida et son sens aigu de la morale font grande impression sur l’usurier Genbei, qu’il vient tout juste de rencontrer et qu’il a vaincu au jeu. Ce dernier le prend pour modèle de probité et aimerait continuer à jouer avec lui de temps en temps, malgré leur différence de niveau. Cependant, lorsque l’entourage de Genbei accuse injustement le rōnin de lui avoir volé de l’argent, cette amitié naissante doit cesser. Deux fois victime de calomnie, Yanagida réclame justice, mais d’abord et surtout contre celui qui l’a sali autrefois auprès de son daimyo, son seigneur…
Un récit intimiste
Réalisé par Kazuya Shiraishi, Le Joueur de go est un jidai-geki (film à caractère historique sur le Japon médiéval) comme on n’en fait plus beaucoup au cinéma. Très classique dans sa mise en scène, son naturalisme à l’ambiance feutrée et contemplative – la photographie est magnifique ! – l’éloigne assurément du chanbara, le film de sabre japonais popularisé par Akira Kurosawa (Les Sept Samouraïs, Le Château de l’araignée, La Forteresse cachée, Yojimbo ou encore Sanjuro). Intimiste, le récit de Shiraishi s’articule autour d’un héros taiseux, sage et décontracté, plus habitué désormais à combattre avec des pions sur une table de jeu qu’à l’arme blanche sur les champs de bataille ou dans les ruelles malfamées. Pourtant, lorsque son honneur est bafoué, le bushi ne répond plus de lui-même…
L’ère d’Edo
Fort de sa thématique originale sur le jeu de go, dont l’incidence sur le déroulement de l’intrigue va s’avérer décisive, le film livre également le tableau saisissant d’une époque marquée par les conflits entre seigneurs et par une extrême pauvreté (7.000 révoltes paysannes durant le shogunat Tokugawa). Celle-ci découle directement des mauvaises récoltes dues aux intempéries et de l’instabilité chronique de la monnaie.
Bien sûr, l’ère d’Edo est une période faste pour la future Tokyo, laquelle voit sa population augmenter de façon exponentielle – c’est la première ville du monde, avec 1,1 million d’habitants – et éclipse progressivement l’ancienne et majestueuse Osaka. La culture y connaît un véritable essor, principalement avec la littérature, le théâtre kabuki et la peinture (voir notre article consacré au film Hokusai).
Le déclin du samouraï
Surtout, l’œuvre de Kazuya Shiraishi nous montre une société acquise à la pensée néoconfucéenne, héritée de la Chine des Song. Une société d’ordres où chacun occupe une place bien définie, où la figure du marchand est honnie de tous, où les lettrés sont au pouvoir et où le samouraï, autrefois perçu comme un héros, s’est peu à peu mué en administrateur de domaine et s’adonne dorénavant aux loisirs. Paradoxalement, c’est aussi la période où Yamamoto Tsunetomo loue à contretemps dans son Hagakure (À l'ombre des feuilles) – composante essentielle du bushido (« la voie du guerrier ») – l’idéal de vertu du samouraï, cet « être-pour-la-mort », selon les mots de l’historien Gérard Siary.
Accroché aux traditions du passé, auxquelles il se sent prêt à sacrifier sa vie et celle de ses proches, notre rōnin Yanagida fait face, comme il le peut, aux bouleversements d’une société qui perd ses valeurs et dans laquelle il est conscient de n’avoir plus tout à fait sa place.
Romantique, ce film suranné d’un bushi non moins dépassé par son époque ne manque pas de charme.
4 étoiles sur 5
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
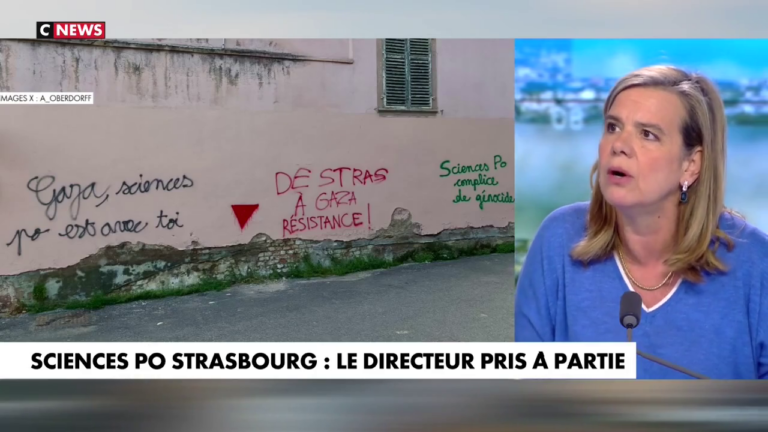







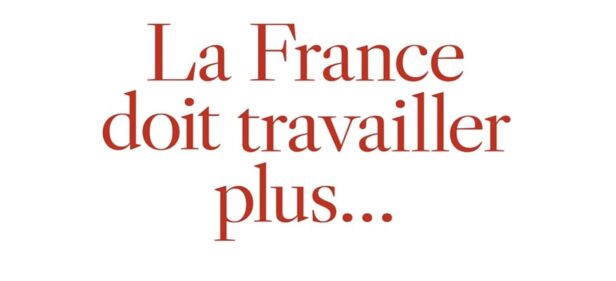
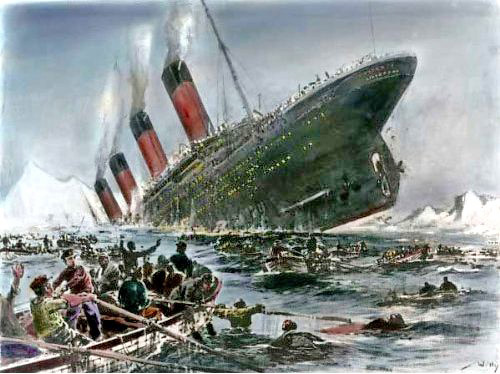
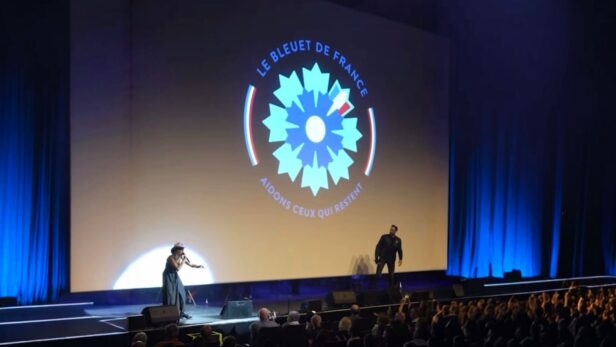





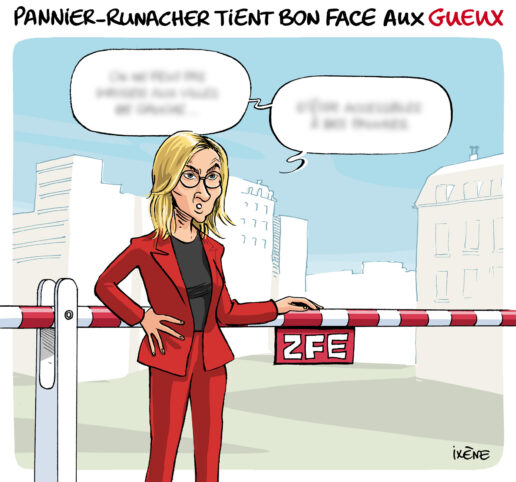







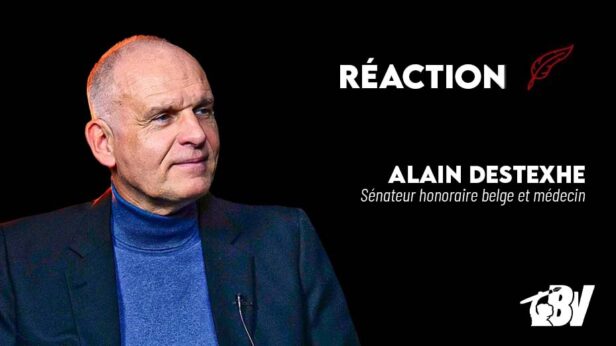
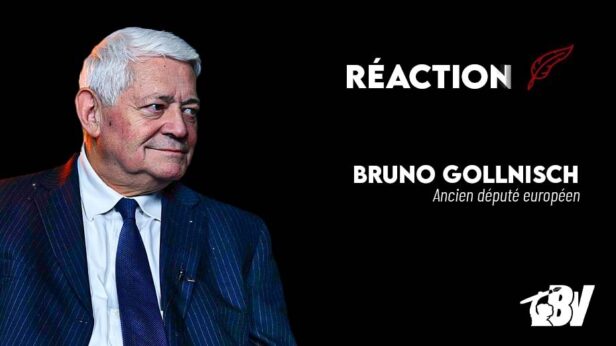










3 commentaires
Le plus grand bonheur et le succès suprême du combattant le plus aguerri en art martiaux est de protéger le faible et de vaincre l’adversaire sans aucune violence. Notre évangile chrétien y ajoute encore bien davantage: l’amour l’autrui!
Un film magnifique. Ceux qui s’attendent à voir des combats au sabre dans le plus pur style Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū, passez votre chemin, l’intrigue est ici nettement plus psychologique. Ce film, d’une durée totale de 130 minutes, est tellement bien fait qu’on ne voit absolument pas passer le temps.
Dōmo arigatō
Pratiquant d’ARTS Martiaux depuis plus de 40 ans, j’ai A DO RE ce film ! …