[CINÉMA] The Brutalist, une (trop) grande fresque qui exalte la laideur

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement entre les années 50 et 70, nombre d’architectes héritiers du Bauhaus conçurent, à travers le monde, des bâtiments d’un style nouveau. Relativement proche, en apparence, de l’architecture soviétique, le « brutalisme » se voulait la traduction, dans l’espace, d’un intérêt renouvelé pour l’égalitarisme social, démocratique et modeste, débarrassé des fioritures du style « Beaux-arts ». Une architecture utilitariste qui, de surcroît résisterait aux guerres futures. D’où l’emploi privilégié du béton – matière bon marché – mis au service de formes primaires, souvent géométriques, imposantes et « brutes ». Cette mode architecturale d’une rare laideur, portée entre autres par Marcel Breuer, Moshe Safdie, Denys Lasdun, Alison et Peter Smithson, Ernó Goldfinger et Jacques Kalisz, nous a légué des œuvres parmi les plus exécrables du XXe siècle. Rejeton esthétique du progressisme et de son rationalisme déshumanisant, le brutalisme n’est pas étranger, en effet, à l’urbanisme froid et désincarné des villes nouvelles et à l’anxiété sociale qui s’y rapporte. Autant dire que The Brutalist, film-hommage de Brady Corbet à ce mouvement architectural, partait plutôt mal…
Un homme qui revient de loin
D’une durée de 3h35, aussi imposante qu’un bloc de béton, le film nous raconte l’histoire de László Tóth, un architecte fictif issu de cette tendance. Un Juif hongrois qui s’est exilé en 1947 aux États-Unis après avoir subi les persécutions en Europe centrale.
Rappelons, à ce propos, pour une meilleure perspective, que selon l’historien Miklós Molnár (Histoire de la Hongrie), le pays d’Árpád et de saint István concentrait, avant son occupation allemande en 1944, la plus vaste communauté juive d’Europe, avec 762.000 personnes directement menacées de génocide. Sous la coupe du régime nazi, le Premier ministre Döme Sztójay, ainsi que son successeur Ferenc Szálasi, permirent, contre l’avis de l’amiral Horthy, la persécution des Juifs, rassemblés pour 435.000 d’entre eux dans les ghettos, avant leur déportation. Seuls 144.000 israélites de Budapest survécurent à la guerre, selon les statistiques officielles.
Rescapé de cette tragédie, László Tóth (Adrien Brody, dont la mère est hongroise) débarque en Amérique, transite comme tant d’autres avant lui par Ellis Island et quitte New York pour rejoindre, en Pennsylvanie, son cousin Attila qui possède une boutique de meubles. Sur place, repéré par le riche magnat et mécène Harrison Lee Van Buren, László Tóth va se voir offrir une chance inespérée de rebondir socialement et de redevenir le grand architecte qu’il fut avant-guerre.
Relecture du rêve américain
Récit d’un homme affligé qui se reconstruit personnellement en bâtissant, The Brutalist renouvelle intelligemment le mythe libéral et ascensionnel américain et sa figure bien connue du « self-made man », conjuguée ici à celle du Juif résilient.
Néoclassique dans son approche globale, avec certes quelques éléments postmodernes de mise en scène, le film nous fait penser par moments au cinéma d’Elia Kazan, bien que l’inspiration principale soit à chercher du côté de Citizen Kane, d’Orson Welles, voire des plus récents Aviator, de Martin Scorsese, et There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson.
Entrecoupé d’un entracte de quinze minutes – voulu par le réalisateur –, ce récit dense se compose de deux parties d’1h40 chacune : la première, qui s’étend de 1947 à 1952, a trait à la renaissance professionnelle du personnage ; et la seconde, qui va de 1957 aux années 80, amorce chez lui une désillusion du rêve américain, le pays se révélant beaucoup moins ouvert que prévu aux populations juives venues d’Europe. Cela, sans compter les contraintes artistiques et financières imposées par un mécène dominateur, m’as-tu-vu et foncièrement malsain (Guy Pearce, excellent) qui incarne les aspects les plus déplaisants de l’Amérique…
Foisonnant, impressionnant même, le film de Brady Corbet réussit le tour de force de nous intéresser jusqu’à la fin au destin d’un homme dont l’œuvre relève, pour nous, du pur délit esthétique, pour ne pas parler franchement de « crime contre le bon goût »… Malgré tout, on ne nous ôtera pas de l’idée que The Brutalist aurait facilement pu durer une heure de moins, moyennant quelques coupes ; c’eût été plus digeste pour le spectateur ; moins « brut », justement…
3 étoiles sur 5
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR




















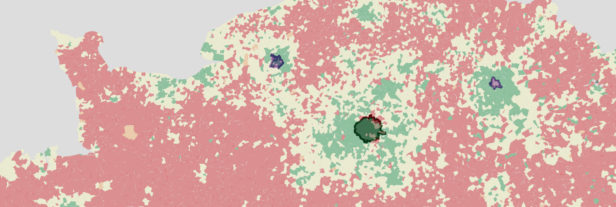












8 commentaires
C’est toujours avec grand plaisir que je lis les chroniques de cinéma de Monsieur Marcellesi et que je remercie chaleureusement.
Et rien sur l’extraordinaire performance d’Adrien Brody ? Pff…
Le béton moche-pas beau, je connais… mais pas le « brutalisme » ni « l’architecture brutaliste ». Donc, un film en deux parties d’1h40 agrémenté d’un entracte d’un quart d’heure… ça donne envie…
Qui a le monopole du « bon goût » J’apprécie la compagnie des nains de jardin? Est-ce grave?
Quel rapport entre un nain de jardin et une architecture soviétique ?
à patrick ramage : Voir avec le cœur facilite quelquefois le bon choix pour nous mais ne représente pas forcément le bon goût. L’exigence, vise l’art, la nécessité, vise l’utilité avant tout. Deux différences majeures dans la perception de ce qui nous entoure.
Cet article également aurait mérité (sic) de durer moins longtemps.
Lisez plus vite!