Extension de la mosquée de Nanterre : l’État dit non à un projet controversé

Depuis six ans, la mosquée de l’institut Ibn Badis tente d’étendre son emprise à Nanterre en rachetant un bâtiment communal voisin. Un projet soutenu par la municipalité communiste mais systématiquement bloqué par l’État, qui y voit un enjeu dépassant la simple question immobilière. Le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, a récemment saisi la Justice pour annuler une nouvelle délibération du conseil municipal. Une décision justifiée par des motifs financiers et administratifs, mais aussi par des inquiétudes plus profondes quant aux orientations de cet institut, placé sous haute surveillance.
Une opposition justifiée de l’État
Dès le départ, la préfecture a relevé plusieurs irrégularités autour de cette vente. En 2021, elle avait fait annuler une première délibération au motif que le prix de vente du bien (2,7 millions d’euros) était sous-évalué, constituant une subvention déguisée. En 2024, alors que la mairie tentait à nouveau d’entériner la cession à un tarif réajusté, l’État avait pointé du doigt l’absence de prise en compte des coûts de désamiantage. À chaque tentative, l’administration locale semblait vouloir contourner les objections légitimes des services de l’État.
Mais au-delà de ces aspects techniques, un élément fondamental justifie l’intransigeance de la préfecture : le projet d’extension de l’institut Ibn Badis pose de sérieuses questions en matière de respect des valeurs républicaines. Loin d’être un simple lieu de culte, cette structure abrite également une école privée, dont les méthodes pédagogiques ont déjà été mises en cause par l’Éducation nationale pour leur manque d’esprit critique. Loin d’être un acteur anodin du paysage associatif local, l’institut est en outre lié à Dignité internationale, organisation qui a largement dénoncé les réponses de Tsahal sans jamais faire mention du 7 octobre sur ses réseaux et qui est dirigée par Ouahid Abassi, figure proche de la grande mosquée de Paris et des réseaux liés au pouvoir algérien implantés en France, comme en témoignent ses réseaux sociaux.
Un institut sous surveillance et des zones d’ombre
Le refus de l’État de voir cet établissement s’agrandir ne doit donc rien au hasard. Depuis plusieurs années, l’institut Ibn Badis fait l’objet d’une vigilance accrue. Son dirigeant, Rachid Abdouni, est connu pour ses propos critiques envers les autorités et pour son activisme sur les réseaux sociaux, d'après les informations obtenues par nos confrères d'Europe 1. De son côté, l'homme se défend auprès de Mediapart contre des attaques qu'il estime venir de l'« extrême droite ». Mais, fait troublant, lors des attaques du 7 octobre, ni lui ni son institut n’ont condamné les actes terroristes du Hamas, préférant se focaliser sur la situation à Gaza sans jamais mentionner la responsabilité du groupe islamiste dans l’escalade des violences. Simple omission ?
De son côté, l’État a estimé qu’il n’était pas opportun de permettre l’agrandissement d’un établissement dont les orientations idéologiques posent question. L’argument de la saturation des lieux de prière ne suffit pas à justifier un projet qui risquerait d’accroître l’influence d’un acteur controversé. La préfecture a proposé des alternatives, notamment l’implantation d’un EPIDE (centre dédié à l'insertion professionnelle de jeunes âgés entre 18 à 25 ans) sur la parcelle concernée, une initiative en adéquation avec les besoins de la ville et que le maire salue comme un « message d'espoir » envoyé à la jeunesse de sa commune.
Loin d’être une mesure discriminatoire, le refus de la préfecture apparaît ainsi au contraire comme une décision cohérente et responsable. Dans un contexte de vigilance accrue face aux dérives communautaires, l’État se doit de garantir que les institutions religieuses respectent pleinement les valeurs républicaines. En s’opposant à cette extension, il rappelle que la liberté de culte ne saurait se confondre avec un passe-droit pour des organisations aux intentions qui pourraient paraître ambiguës.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR


















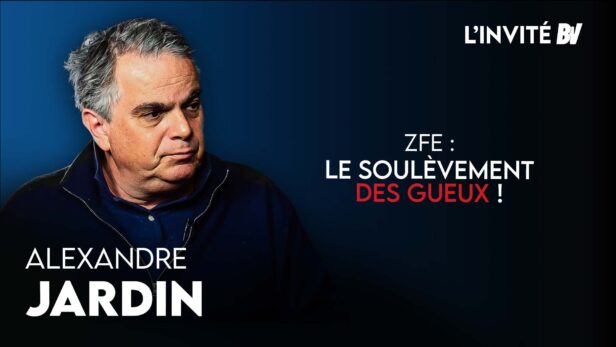





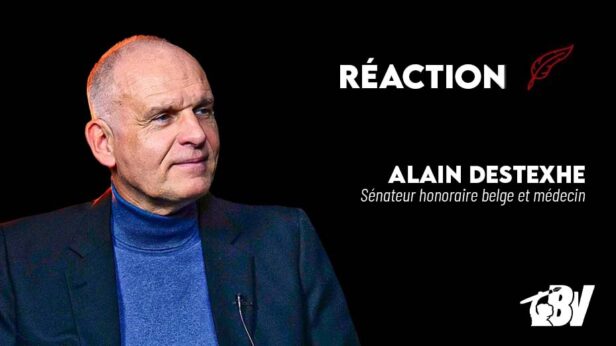
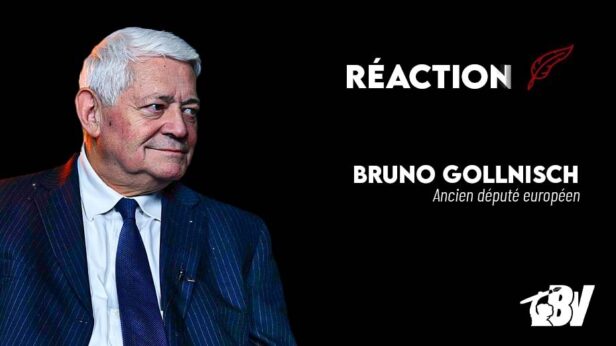








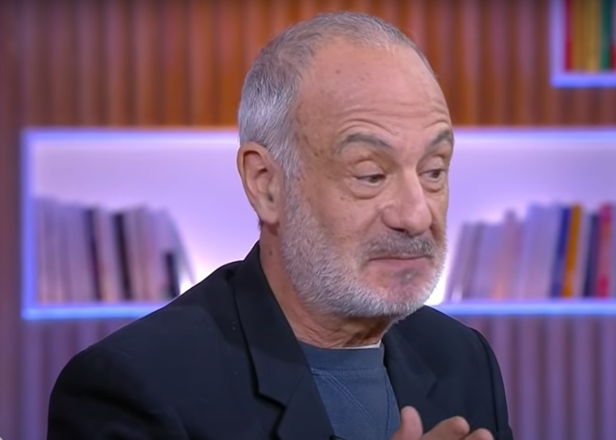
8 commentaires
Par cette action, L’Etat chercherait-il à freiner la mainmise des Frères Musulmans sur la France ? Du jamais vu à ma connaissance ! Gageons qu’il finira par céder, comme d’habitude.
Bâtiment important , qui a payé ? ingérence étrangère ?
Je propose que l’on déplace La Mecque à Barbès…
Génial comme ça la mère Hidalgo pourra être encore élue avec 90% des voix
Il n’y a pas de « culte musulman ». On va à la mosquée pour prier, ce qu’on peut faire à la maison et pour écouter l’imam. Rien de sacré!
Il serait temps ! Au mieux c’était d’interdire toute construction de ce genre dans notre paysage.
Bravo la Préfecture
La taxe culturel est de bon rapports, Extensions de bâtiments culturels, rachats de terrains (sauf quant ils ne sont pas cédés pour 99 ans en temps où la France aura disparue) il y a des moyens quelque part sauf pour l’entretiens de bâtiments d’une autre culture plus proches de nous.