[LE GÉNIE FRANÇAIS] La photographie : du mystère de la chambre noire à l’IA

L’invention de la photographie ne s’est pas faite en un jour. Ni en un siècle. On ne compte pas les inventeurs, artistes, chimistes et autres créateurs français, et même un Anglais et un Américain, qui ont mis la main à la pâte, car cet accouchement des plus complexes a demandé des trésors d’imagination et d’essais chimiques. Citons quelques étapes cruciales.
De Aristote à Vinci
Aristote, – encore lui, ou déjà lui ! – au IVe siècle avant J.-C., faisait l’expérience de la boîte noire et constatait que « tout objet placé en face d’une boîte fermée et percée d’un trou se reflète renversé sur le fond de cette boîte. » Il faut attendre un savant arabe du Xe siècle, Alhazen, pour voir cette théorie se développer. Il précise que « ce n’est pas l’œil qui émet de la lumière, mais la lumière qui entre dans l’œil ». À la Renaissance, Léonard de Vinci s’intéresse à la chambre noire qui sert aux peintres à maîtriser les perspectives et les contours de leurs sujets ou objets en les plaçant devant le trou.
L’invention réelle de la photo attendra le XVIIIe siècle
L’inventeur génial Niépce, au prénom rare mais réel, Nicéphore, est français. Il a passé sa vie à créer, seul et avec son frère. Ils ont mis au point le principe du moteur à explosion, mais il est aujourd’hui mondialement connu comme le grand pionnier de la photographie.
Niépce cherche par tous les moyens la manière de fixer une image de la réalité. D’abord, il dispose au fond de la chambre noire des feuilles de papier enduites de sel d’argent. Il obtient un premier négatif, mais l’image ne tient pas. Elle noircit et disparaît. Alors, il place une plaque d’étain recouverte de bitume de Judée, un composant chimique noir dérivé du pétrole brut. Il met son appareil à la lumière face à la fenêtre de sa maison et attend plusieurs jours. Et voilà, en 1827, la première photographie noir et blanc de l’Histoire, celle de sa propriété. Elle est floue mais ne disparaît pas. Le malheureux Nicéphore n’ira pas plus loin. Il mourra trop tôt et endetté.
Entre Niépce et Daguerre, « est-ce qu’il y a photo ? »
Louis Daguerre, associé de Niépce, poursuit leurs travaux communs. Il remplace le bitume de Judée par de l’iodure d’argent, un composant chimique photosensible, puis réduit encore le temps d’exposition, qui passe de plusieurs heures à vingt minutes. Et pour la première fois, il obtient une reproduction précise de la réalité. Le daguerréotype est né. Nous sommes en 1839. Le brevet est acheté par le gouvernement. L’appareil aura un succès mondial. Mais l’image est positive. Pour la dupliquer, il faut passer par un négatif.
Talbot et la photo argentique moderne
Si l’invention est française, son développement doit beaucoup au britannique William Fox Talbot, qui invente à la même époque le calotype : un procédé négatif-positif qui permet la reproduction multiple d’une image. Talbot installe dans sa chambre noire une feuille enduite de chlorure d’argent pour obtenir un négatif qu’il rend transparent en le cirant. Il le place ensuite sur une autre feuille avant de l’exposer à la lumière du jour et obtient ainsi le positif.
Archéologie et photographie : le linceul aurait 2.000 ans
La photographie fait faire des avancées étonnantes à la science et à l’archéologie. Par exemple, en 1898, le fameux suaire de Turin est pris en photo. Le développement du négatif révèle le portrait et le corps d’un homme dont les détails correspondent point par point à celui du Christ tel que sa mort a été décrite dans les Écritures, il y a 2.000 ans.
Époustouflant !
La photo grand public
Dans l’histoire de la photographie, on ne peut écarter l’importance du rôle joué par l’Américain George Eastman (1854-1932), industriel, inventeur et philanthrope. Il a effectué un travail remarquable de simplification du procédé. En 1884, il met au point le négatif souple : c’est la naissance du film celluloïd qui permet de stocker plusieurs images dans un appareil de plus en plus petit.
Début du XXe siècle. Le Français Auguste Lumière, autre pionnier de la chimie dans le domaine de la photographie, innove avec l'autochrome, ou première photo en couleur. Lui et son frère inventeront, plus tard, le cinéma (ce qui mériterait un article entier).
Clic-clac, Kodak ! : film pub
1946, c’est encore Eastman qui met la photo en couleur à la portée de tous en fabriquant l’appareil de M. Tout-le-Monde, qui est aussi le premier appareil portable. Kodak, sa marque à la sonorité internationale, fait le tour du monde. Et à grands coups de publicité, elle fait entrer le sourire dans les normes photogéniques. Jusque-là, il fallait garder son sérieux ! Le nom « Ko-dak », créé en 1888, vient sans doute du bruit du déclencheur qui a aussi donné le slogan dont la pub est célèbre : « Clic-clac, Kodak. Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. » Pendant cent ans d’un succès mondial énorme, la marque semble indestructible. Elle est pourtant enterrée par le numérique.
L’intelligence artificielle, ses limites et ses dangers
2020-2024. L’IA peut désormais générer des « photographies » de personnes, d’animaux et de lieux n’ayant jamais existé. Notre perception du réel s’en retrouve altérée. Pourrons-nous, demain, nous extasier spontanément devant une photo si nous devons douter de son authenticité ? Toutes les émotions vont-elles disparaître ? Pire : jusqu’où iront les mensonges et les préjudices des auteurs malintentionnés ?
Le Sommet mondial de l’IA organisé à Paris, la semaine dernière, serait « destiné officiellement à l’intérêt général » et « aurait une éthique » ! Pour en faire la promotion, le chef de l’État est passé à la télévision et a cru bon d’illustrer ses propos de photomontages plus ou moins grotesques et de vidéos de sa personne travestie en femme (qui dégradent plutôt sa fonction).
Deux questions d’une actualité dramatique se posent. L’intelligence artificielle peut-elle répondre aux premières préoccupations des Français, telles que leur sécurité ? Et l’intelligence du cœur rentre-t-elle dans les paramètres ? Rien de moins sûr.
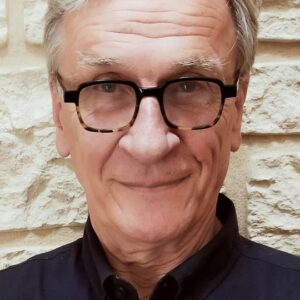
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
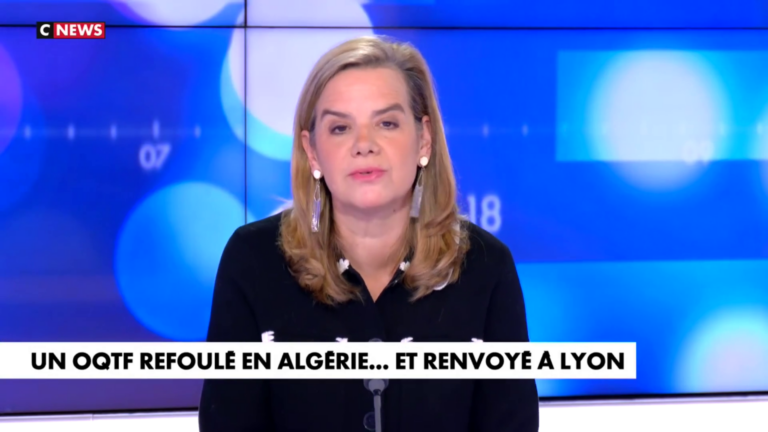






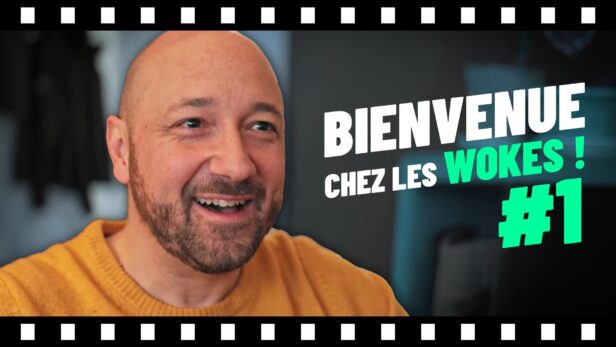











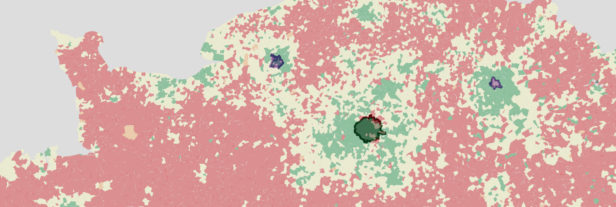

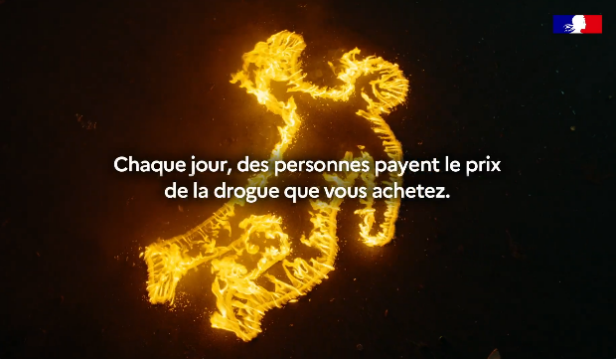


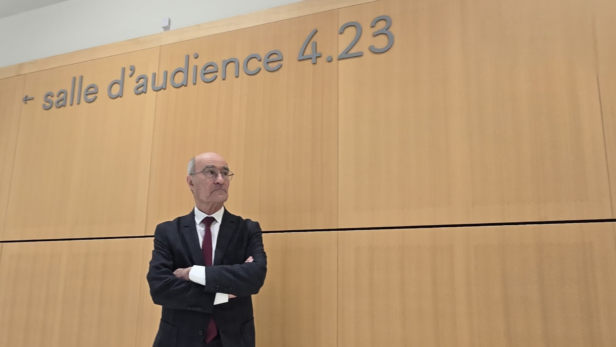
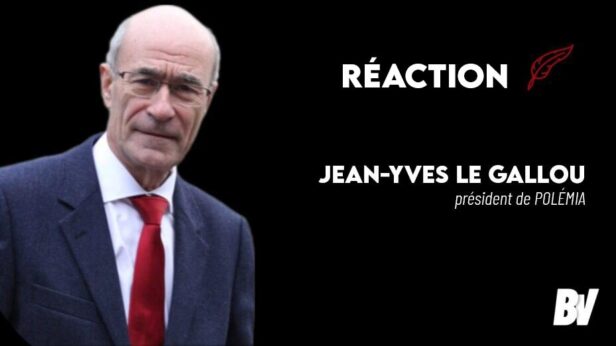

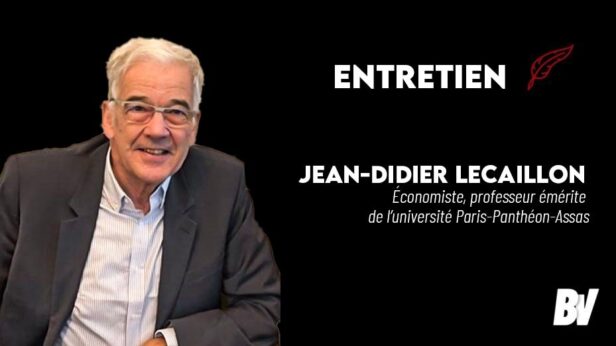
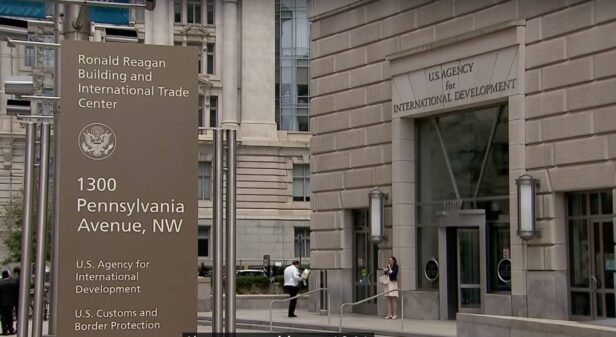




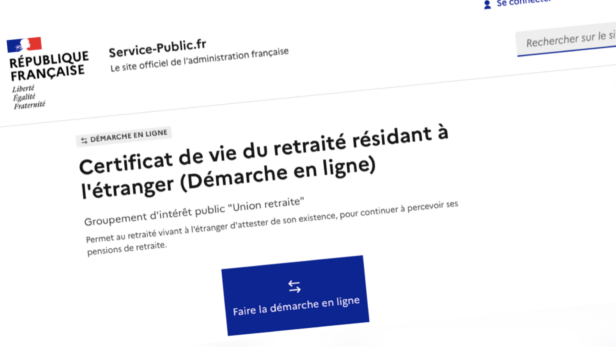


4 commentaires
Article intéressant mais la phrase » Il précise que « ce n’est pas l’œil qui émet de la lumière, mais la lumière qui entre dans l’œil ». » est un mème qu’il ne faut pas colporter : il est bien évident que l’œil n’émet pas de lumière et que celle-ci provient de sources extérieures come le soleil ou une lampe. N’importe qui doué du moindre bon sens peut et a pu le constater, à n’importe quelle époque. Personne n’a jamais eu besoin de ce Alhazen pour le constater.
Article très intéressant.
Et l’IA va surtout permettre au ripoux de trouver un nouveau moyen de sevir. Si elle a permis de faire des photos de Macron travestis en femme rien n’empêchera demain de créer une photo du même en train de violer une petite fille (ou un petit garçon), d’assassiner quequ’un ou de piller une banque. Une simple diffusion sur les réseaux sociaux et la machine à dégommer se mettra en route. Un excellent moyen de faire chanter les gens… A terme, la vidéo surveillance ne sera plus recevable, n’importe qui pouvant faire dire ce qu’il veut à une vidéo.
« vidéos de sa personne travestie en femme (qui dégradent plutôt sa fonction) » !!
Cela fait sept ans, hélas, que cet usurpateur dégrade la fonction présidentielle, car ce ne sont pas les costumes 3 pièces dont il change à longueur de jour qui le grandiront, mais une attitude, un comportement et des manières plus dignes d’un chef d’état.