Le retour à 90 km/h ? Gare aux pièges…

C’était en mai dernier, après des mois de guérilla en jaune : le Premier ministre annonçait la possibilité, pour ceux qui le souhaiteraient, d’un retour aux 90 km/h sur certains axes départementaux.
Avec la hausse du coût de l’essence, la décision d’imposer le 80 à l’heure sur nos routes de campagne avait alimenté le brasier de la contestation tous azimuts, « par 80 % des citoyens et par la quasi-totalité des élus locaux », comme le rappelait au Parisien, en mai dernier, un avocat spécialisé. Qu’importe, assis fermement sur ses convictions, Édouard Philippe restait persuadé que la contrainte « permettrait de sauver 400 vies par an », se disant « fier de sa décision ». Mais il a fini par céder… Devant la pression, la raison ou peut-être même les chiffres.
C’est aux présidents de conseil départemental qu’incombe la décision de fixer la vitesse, donc d’un retour ou non aux 90 km/h, selon une mesure entrée en vigueur ce 1er févier 2020.
Pour l’heure, assez peu s’y sont engagés. En effet, selon l’enquête du Parisien, à ce jour :
- 21 départements ont décidé le retour à 90 km/h sur certains axes ;
- 9 départements y sont favorables mais n’ont pas pris de décision ;
- 6 ont un avis réservé ;
- 13 y sont opposés ou renoncent devant les difficultés.
Comme les raisons qui ont amené le Premier ministre à « aménager » les règles, les difficultés sont multiples. Il y a d’abord la pression, sachant que la guerre fait rage entre associations de défense des automobilistes et associations de victimes de la route ou autre Prévention routière. La raison est celle des ruraux, usagers de nos routes départementales qui refusent de devoir se traîner sur des axes empruntés quotidiennement. Enfin, l’affirmation qu’une route « plus apaisée » aurait, entre juillet 2018 et juillet 2019, sauvé 206 vies « sur le seul réseau passé aux 80 km/h », comme l’affirme le délégué interministériel Emmanuel Barbe, est contestée. D’ailleurs, le représentant de l’État le confirme lui-même : « Le bilan aurait pu être meilleur. Les quatre premiers mois, les résultats étaient en ligne avec les projections mathématiques mais la dégradation massive des radars à partir de novembre 2018 a malheureusement fait remonter le nombre de tués. »
Peut-être, mais on peut lui opposer aussi l’argument selon lequel des mois de blocage routier et autoroutier ont grandement perturbé la circulation avec des conséquences qui peuvent se lire dans les deux sens : moins de morts parce que moins de circulation. Enfin, il est acquis que tenir, comme on le fait, la vitesse pour seule responsable des hécatombes routières est une hérésie. Ce qui tue, c’est davantage l’abus des « substances » licites (nous sommes toujours champions de consommation de somnifères et autres psychotropes) et illicites (alcool et drogue) ajoutés au non-respect des règles (téléphone au volant, Code de la route…). La vitesse est un facteur aggravant, pas la cause unique. Le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes l’affirme : « Depuis 2013, les chiffres sont implacables et la mortalité routière ne baisse pas en France. Factuellement, aucun bénéficie ne peut donc être accordé à cette mesure inique des 80 km/h. »
Reste, pour les départements qui souhaiteraient réaménager la vitesse sur leur réseau routier, un handicap de taille : le prix. La réimplantation des panneaux est d’un coût prohibitif.
Enfin, et c’est le piège que redoutent beaucoup : on fait planer sur eux la menaces de poursuites judiciaires si, d’aventure, des accidents mortels devaient se produire sur les tronçons repassés à 90 km/h. Si les élus « font remonter la vitesse sur leurs routes, ils devront assumer davantage d'accidents et de morts », dit-on en haut lieu… et donc en rendre compte devant la Justice ?
Thématiques :
Limitation de vitesse
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR



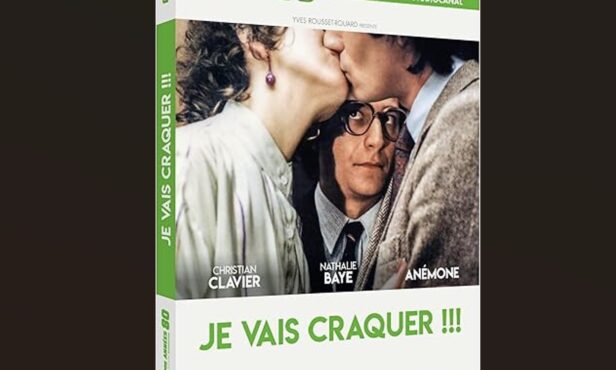
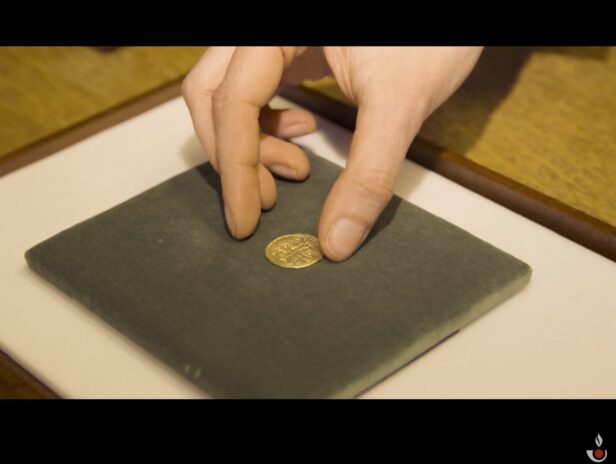



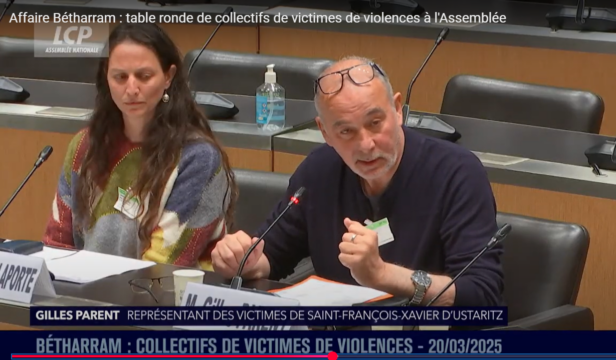













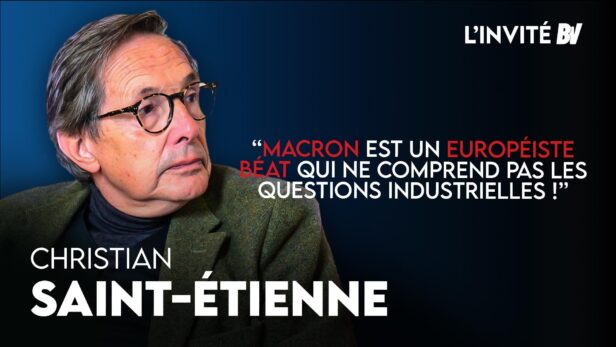





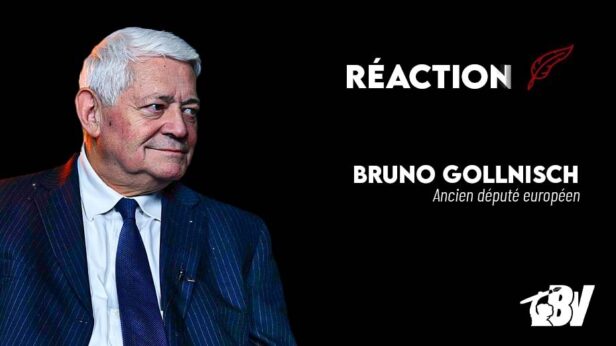





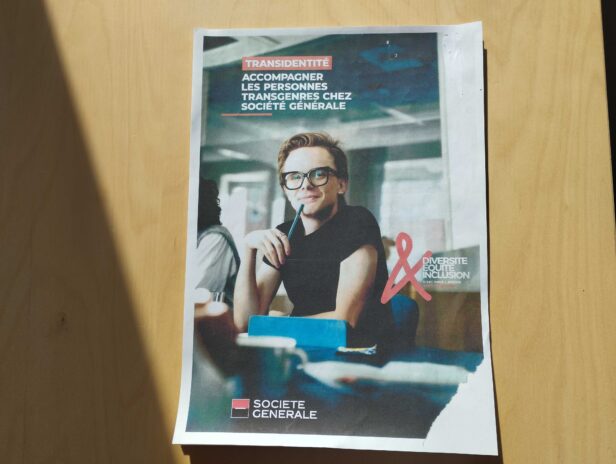




BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :