[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Former des cœurs

Pour retrouver l'épisode précédent, c'est ici.
C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 23
Former des cœurs
Il était quasiment 8 heures du matin et, presque comme des étudiants, les neuf jeunes hommes et femmes que nous avons appris à connaître, désormais vêtus d’uniformes de l’armée britannique, patientaient dans une salle de cours en parlant de sujets anodins. Un timide soleil commençait, de temps à autre, à émettre de légers signaux de morse par la vitre du château. « Limités à la lettre E, toutefois : un coup bref », pensa Duncan, désormais expert dans la lecture de ce code, avec une pointe d’humour.
La veille, au mess, au terme d’un repas léger, le major Vaughan avait demandé aux opérateurs d’être présents à 8 heures le lendemain, en tenue de service courant, dans la salle d’instruction d’Arisaig. Avant de les libérer sans autre forme de procès, il avait cependant ajouté, comme une réponse à la question que Duncan s’était posée plus tôt, ces quelques mots : « Vous êtes officiers de plein droit, à présent. Ce mess est le vôtre. Cet uniforme aussi. Les six semaines que vous venez de passer valent certaines cérémonies factices, et il n’y a pas de fanfreluches, dans ce métier. Nous verrons très bientôt si vos qualités de commandement sont à la hauteur de votre acharnement sur le terrain. Bonne soirée à tous. » Peu de mots, peu d’effets de théâtre, beaucoup de justesse et de densité, tout cela avec une impeccable politesse : Duncan s’était accoutumé au style qui semblait être celui du SOE.
À 8 heures juste, donc, un vieil homme d’aspect rébarbatif, très grand et très droit, portant un épais costume de flanelle grise et de fortes lunettes, fit son entrée dans la salle. Les agents rectifièrent la position, par habitude, et prirent place, sans qu’un ordre leur eût été donné, chacun debout derrière une des tables.
— Asseyez-vous, je vous en prie, dit l’homme d’une voix tranquille, en français.
« Un Français, un vrai, avec un accent chic, un Parisien probablement. Maintien raide, lunettes dorées, un ancien banquier si ça se trouve », analysa Duncan. Il constata que seuls Denise Reynolds, John Gordon, James Erroll, Deborah et lui s’étaient assis. Les quatre autres n’avaient pas saisi cette langue étrangère.
— Pardon, poursuivit le vieil homme en français. Setzen Sie sich, bitte, répéta-t-il, en allemand cette fois.
« Non, c’est un Bavarois, corrigea immédiatement le jeune agent, ou un Autrichien peut-être ; son accent est caractéristique. Il n’a pas l’air drôle, pas assez de fantaisie dans le regard ; comment ai-je pu le prendre pour un Français ? Mais pourtant… » Hendricks et Shannon s’assirent. Hendricks avait fait de bonnes études, mais où Shannon, le paysan irlandais, avait-il appris l’allemand ? Les deux autres, comme par jeu, étaient restés debout, attendant peut-être qu’on les appelât dans la langue qu’ils parlaient parfaitement.
— Entschuldigung, fit-il avec un bon sourire. Siediti, prego.
« On dirait un de ces vieux Romains que l’on entend à la radio, se dit l’agent, de plus en plus décontenancé, mais avec un accent un peu chuintant, peut-être du sud, peut-être de Naples, je ne suis pas sûr. » Duncan était moins certain de son italien. « Mais d’où vient ce type ? », se demandait-il, mi-agacé, mi-admiratif. Carver, l’alpiniste, s’assit avec un froid sourire. Seule, restée debout, rouge comme une pivoine, mais avec un air de défi et presque d’arrogance que Duncan ne lui avait jamais vu, Diana Bullingdon attendait son tour.
— Ma certo, signorina, mi dispiace, sembla s’excuser le vieil homme digne, Isvolt’ié, prissiest’, conclut-il d’une voix de basse enveloppante et riche, en montrant la chaise de la jeune fille.
Diana s’assit.
Du russe ! Diana, dix-huit ans à peine, parlait donc russe ! Et ce monsieur de cinquante ou soixante ans, qui faisait onduler et chatoyer les courbes de la diction slave comme un émigré blanc, combien de langues parlait-il ?
— Je vous prie d’excuser cette petite comédie puérile, reprit-il dans un anglais oxfordien, très cut-glass, aussi irréprochable que le reste. Il s’agissait d’abord pour moi de vous permettre d’apprécier les qualités des uns et des autres – et encore, remarqua-t-il incidemment, certains parlent plus de langues qu’ils n’en ont l’air.
« Mon pseudonyme est Arthur, et je vais vous enseigner, dans les prochaines semaines, les langues étrangères : français, allemand, italien, russe, peut-être un peu d’arabe si nous avons le temps. Après cet entraînement intensif, vous aurez, selon vos capacités et votre assiduité, la possibilité, à tout le moins, de faire illusion quelques minutes sans difficulté dans deux ou trois langues. Cela ne résistera pas à une conversation, encore moins à un interrogatoire, mais ce sera bien assez. Si vous aviez déjà des bases solides, en étant excellent et en travaillant assez, vous pourrez vous faire passer pour un natif dans l’une d’elles, selon votre niveau de départ – et en étant exceptionnel, dans plusieurs d’entre elles. Si vous le souhaitez – et si vous en êtes capables –, n’hésitez pas à échanger entre vous, en dehors des journées de cours, pour apprendre les uns des autres. Ainsi, vous progresserez plus vite.
À ce sujet — [LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Au château
Un mois à peine pour apprendre les rudiments de plusieurs langues, cela paraissait beaucoup en si peu de temps à Duncan, mais la démonstration du professeur l’avait impressionné. Il ne savait que penser de cette promesse de bateleur.
— Pour réussir cette mission, je m’appuierai aussi sur le changement de votre comportement, expliqua le vieux professeur. Ceux d’entre vous qui sont parfaitement bilingues ont peut-être déjà constaté que l’on n’a jamais exactement la même voix dans une langue étrangère, que l’on ne tient jamais, quelque parfaite que soit la maîtrise, exactement les mêmes propos – en un mot, que l’on n’a jamais, dans une autre langue que la sienne, exactement la même personnalité.
« Je vais donc faire changer vos comportements. Vos gestes, votre démarche, vont évoluer d’une langue à l’autre. Vous regarderez des films dans cette salle. Vous imiterez. Je vous montrerai certaines petites ficelles. Au début, ce sera grossier, mais le métier que vous avez choisi suppose tout de même une certaine finesse d’esprit – alors, j’espère qu’au lieu d’être des imitateurs, vous deviendrez rapidement… des moines copistes. Vous allez former votre cœur. Il deviendra plus grand.
Il n’y avait pas un bruit dans la salle, pas une trace d’incrédulité non plus parmi les stagiaires. L’ambiance tenait du cours de théâtre et du numéro de prestidigitation. Le professeur fit claquer le fermoir d’une vieille sacoche de cuir brun et sortit neuf petites fiches cartonnées, qui tenaient dans la main. Il les donna à Denise Reynolds, au premier rang, qui les fit passer à ses voisins.
Duncan regarda son exemplaire. C’était un tableau de mots, à la verticale, écrit en tout petits caractères, recto verso. À gauche, un mot d’usage courant en anglais, puis ses équivalents en français, allemand, italien et russe. Des emplacements étaient volontairement blancs, juste en dessous de chaque mot.
— Voici la grille d’Arthur, la pierre de Rosette d’Arisaig, dit Arthur, sur un ton apparemment parfaitement sérieux. Vous mémoriserez ces trois cents mots dans les prochaines semaines. Vous les mémoriserez chacun avec l’accent parfait d’une personne qui serait née là-bas. Vous ferez les gestes du pays, vous pourrez même glisser une ou deux blagues du pays. Toutefois, tant que vous n’êtes pas certains d’être indétectables, jamais vous ne vous direz originaire de ce pays. Votre mère en viendra, vous y aurez séjourné, vous serez un travailleur frontalier, c’est tout.
Toujours pas un bruit. Arthur, dont le costume sobre, la chemise blanche, la cravate noire et les lunettes dorées auraient pu appartenir à n’importe quel citoyen européen, marchait lentement devant ses élèves en les regardant tour à tour.
— C’est bon ? Alles gut ? Alors allons-y, parlons un peu français.
Il s’empara d’une craie et commença son cours.
***
À midi, Duncan avait terriblement mal au crâne. Il était intellectuellement épuisé comme il ne l’avait jamais été après aucun cours. Jusqu’ici, il parlait, comme toute sa famille, un français parfait, sans aspérités ni accent étranger, mais les subtilités du langage ne lui avaient jamais été montrées à ce point. Lui qui croyait que seule la langue de Shakespeare permettait, comme le disait le professeur Higgins dans Pygmalion, d’identifier la provenance d’un individu à quelques pâtés de maison près, venait de découvrir qu’il y avait un monde entre un Champenois et un Alsacien, entre un Berrichon et un Tourangeau, un monde parfois distant de quelques dizaines de kilomètres seulement. Dans chaque province, le patois des paysans avait imprégné l’accent et les tournures de phrase. Le français nasal et articulé, que parlaient Arthur et Duncan, était en réalité l’accent des classes supérieures, un accent neutre et pur – originaire de Touraine, disaient certains Français.
Au mess, les neuf agents, servis par le caporal (qui, sans chercher à le cacher, accommodait admirablement de simples boîtes de conserve), ne parlèrent que français. Denise Reynolds, dont la mère était normande, semblait, pour la première fois depuis le début du stage, dominer la situation avec aisance et naturel. Au grand étonnement de Duncan, la méthode d’Arthur portait déjà ses fruits. « Ne prononcez pas un mot qui ne soit pas parfait. Cinquante mots comme un natif, pour commencer. Mais interdiction de vous taire », avait dit le professeur. Il voyait Carver s’astreindre à ne pas s’appuyer sur sa connaissance de l’italien. Il disait « Merci » sans rouler les r (c’eût été d’un Berrichon) et « Volontiers » sans faire danser les n (il serait passé pour un Provençal). Diana Bullingdon s’en tirait, elle aussi, très honorablement, aidée cette fois par la musicalité sinusoïdale du russe. En français, comme Arthur l’avait prédit, elle n’était plus la même : elle se tenait plus droite, elle souriait davantage, bien qu’elle ne maîtrisât, depuis quatre heures, que quelques mots élémentaires. Hendricks, à la peine, ne dominait pas du tout son affaire.
Tout naturellement, Duncan se tourna vers Deborah et lui dit, dans son meilleur français :
— C’est un peu curieux de se parler français, vous ne trouvez pas ?
Deborah Stuart le regarda bien en face, lui sourit et lui dit :
— Cela nous offrira l’occasion de nous dire « tu ».
En français, qu’elle parlait parfaitement quoiqu’un peu plus lentement, l’élégante Deborah avait une voix douce et capiteuse, bien plus mûre et audacieuse que sa voix anglaise. D’ailleurs, outre le fait qu’il n’y avait ni « tu » ni « vous » en anglais, elle n’aurait probablement pas osé cette phrase dans sa langue maternelle.
— Tu as raison, répondit Duncan en lui rendant son sourire. C’est mieux ainsi.
Deborah rosit.
— Nous devrions y aller, poursuivit Duncan. Le déjeuner se termine.
À suivre...
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR




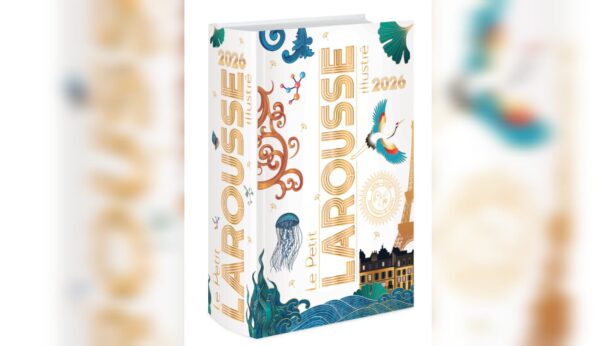







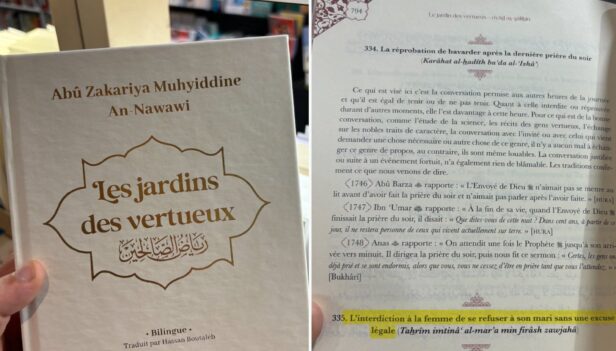














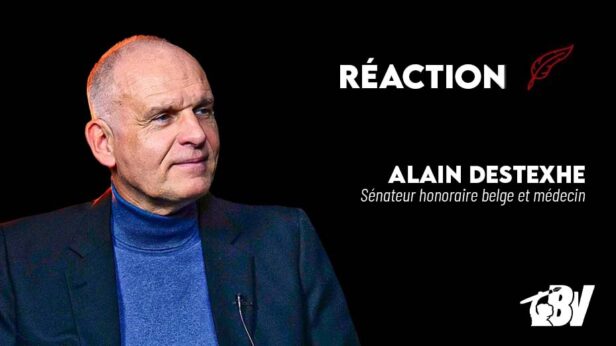









BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :