[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Le cadran de la montre

Pour retrouver l'épisode précédent, c'est ici.
C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 5
Le cadran de la montre
Il y avait maintenant plusieurs heures que Duncan était enfermé dans ce sous-sol. Il n’avait pas la moindre idée de l’heure qu’il était. On lui avait pris sa montre, ses lacets et sa cravate. Tournant la tête à gauche et à droite malgré son visage douloureux, il profita de l’absence de ses geôliers pour essayer de fixer dans sa mémoire les détails de la pièce, et d’en tirer quelques conclusions. Il récapitula rapidement les événements de la journée.
Tout à l’heure, peu après qu’il eut été arrêté et qu’il fut monté dans la voiture, l’un des policiers l’avait menotté dans le dos et lui avait mis un bandeau de tissu noir sur les yeux. Il ne voyait plus rien ; il n’y avait pas moyen – comme à colin-maillard – de tricher en regardant sous le bandeau. La voiture avait alors roulé pendant une heure environ. Au début, il avait essayé de se souvenir du plan – il voyait encore la carte de Londres dans sa tête – mais les détours avaient été trop nombreux pour qu’il puisse se repérer.
Quand la voiture s’était arrêtée, il avait été poussé sans ménagement dans une maison – il avait entendu le bruit d’une clé, puis d’une porte, tandis qu’il montait quatre marches pour entrer – puis emmené à la cave. Là, on l’avait assis sur un tabouret.
Il resta ainsi plusieurs heures, dans la cave dont la lumière était éteinte. Il y avait donc intérêt, nota-t-il, à lui laisser son bandeau, à moins que cela ne fasse partie d’une manœuvre pour l’inciter, en l’empêchant de regarder autour de lui, à trop réfléchir et à avoir peur. Il décida de se donner du courage en pensant à autre chose.
Il se récita toutes les poésies qu’il connaissait. Puis, il chanta des chants de marche qu’il avait appris aux boy-scouts, puis des chansons d’Oxford. Il était à court de chansons, de poèmes et sur le point de s’endormir, lorsque la lumière s’alluma et qu’il entendit des pas dans l’escalier. Il n’y avait sans doute qu’un seul individu, qui lui enleva son bandeau. Duncan ouvrit les yeux.
Face à lui, un homme d’une cinquantaine d’années, en civil, se présenta d’un air menaçant :
— Je suis l’inspecteur Higgins. Vous êtes dans l’un des lieux de détention de Scotland Yard, Monsieur McAllan, ou Mac Corquodale, ou peu importe qui vous êtes.
Duncan garda le silence. En une fraction de seconde, il dut se décider : dire la vérité ou mentir. Le plus simple était de dire la vérité, mais il faudrait alors révéler l’existence du SOE et raconter toute l’histoire. Et ce n’était pas à lui de décider si la police avait besoin de connaître cela. Après tout, si le général Gubbins lui faisait confiance, c’était parce qu’il ne devait rien dire à personne. Il était donc obligé de mentir.
— On nous a signalé qu’un nommé Duncan Mac Corquodale, correspondant à votre signalement, avait pris le train d’Oxford ce matin. Est-ce bien vous ?
— Vous devez faire erreur, Monsieur. J’ai pris le train à Slough, à 8 h 44, et je me nomme William McAllan.
La station de Slough était la dernière avant Londres. Duncan rendit intérieurement grâces au Ciel pour sa mémoire visuelle. Il avait mémorisé les stations et les horaires sur l’indicateur rien qu’en les regardant attentivement.
— Ah bon, fit l’inspecteur. Et que faisiez-vous à Slough, monsieur… McAllan, c’est cela ?
— Oui, c’est cela. Si vous me disiez d’abord pour quelle raison vous m’avez arrêté ? dit Duncan avec froideur.
Le policier fut stupéfait.
— Votre arrestation est illégale, continua le jeune homme ; je n’ai à me justifier de rien et vous feriez bien de me remettre rapidement en liberté avant que je ne porte plainte contre vous. Je ne sais même pas si vous êtes policiers !
Pour toute réponse, Duncan reçut un coup de poing au visage qui lui fit tourner la tête vers la droite.
— Écoute-moi bien, sale traître, cria le policier, on nous a dit que tu travaillais pour les Allemands ! On nous a dit que le général Gubbins t’avait recruté pour poser des bombes dans Londres ! On s’est renseignés sur toi, Mac Corquodale : ta mère est une Allemande ! Alors parle vite, sinon ce soir, tu dormiras dans une prison !
Duncan avait un goût de sang dans la bouche et une vive douleur à l’œil et au nez. La boxe l’avait habitué à la douleur, mais d’habitude, il pouvait se défendre. Son premier réflexe le poussait à dire que le général Gubbins était un patriote, qui dirigeait un service secret anglais nouvellement créé, que la famille de sa mère était amie de l’Angleterre, que sa mère était d’ailleurs liée à la famille royale, qui était une famille allemande elle aussi, et que si le policier lui détachait les mains, il lui casserait le nez d’un seul coup de poing.
Mais pour dire tout cela, il devait reconnaître que son nom était faux, qu’il connaissait Gubbins, et il perdrait donc un temps précieux. Il décida de continuer dans son histoire. Il n’avait plus le choix.
À partir de ce moment, il avait deux options : soit il se montrait courageux, il répondait avec insolence et le policier continuerait sans doute à lui taper dessus, soit il faisait semblant d’avouer une histoire impossible en se faisant passer pour un lâche, afin que personne ne le suspecte de s’adonner à des activités dangereuses. Il décida de faire semblant d’être lâche. Cela ne faisait pas du tout partie de son caractère, mais ce n’était que du théâtre – et il devait tenir, pour être un jour libéré. Il rendrait compte de tout cela plus tard, en arrivant à Baker Street… s’il y arrivait.
A suivre...
Thématiques :
RomandelétéPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
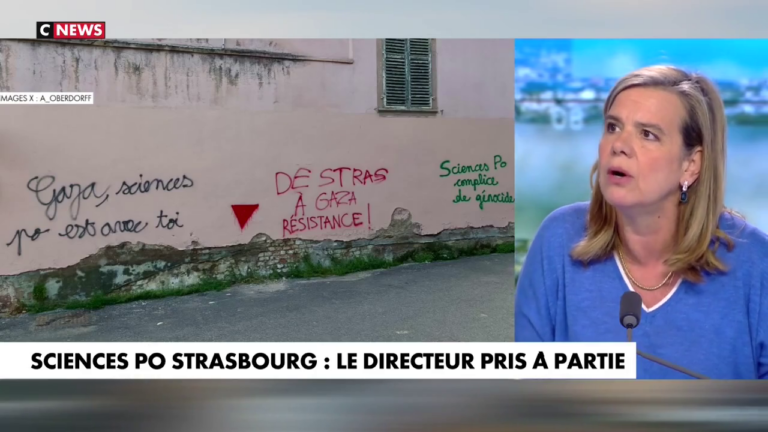

























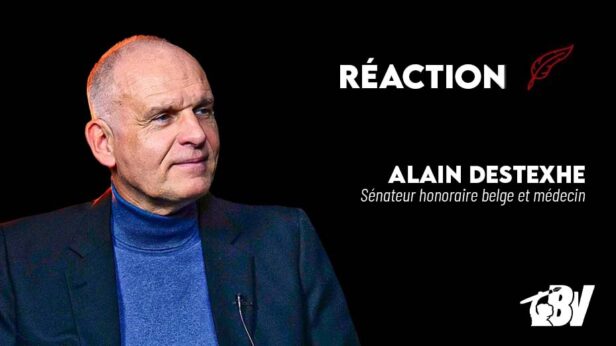











Un commentaire
Histoire passionnante, il me tarde d’être à demain pour la suite