[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Le débriefing

Pour retrouver l'épisode précédent, c'est ici.
C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 6
Le débriefing
Quelques minutes passèrent. Il était 21 h 57. Duncan décida de ne pas frapper une deuxième fois. Les policiers devaient s’être mis à sa recherche. Il fallait attendre cinq minutes au maximum. Après, il estimait qu’il commencerait à être en danger.
À 22 h 00 exactement, la porte s’ouvrit. Une jeune femme gracieuse le regarda d’un air sévère.
— Bonsoir monsieur, que puis-je pour vous ?
— Oh, bonsoir madame. Je viens prendre des nouvelles de Penelope.
— Elle travaille à sa tapisserie, répondit la jeune femme sans se dérider.
— Dans ce cas, je reviendrai demain matin, dit Duncan d’un air naturel.
La jeune femme ouvrit largement la porte et lui fit un charmant sourire.
— Mais non, je vous en prie, entrez un instant.
McCorquodale entra dans l’immeuble. La jeune femme le précéda dans le couloir. Elle portait un tailleur de laine et un chemisier blanc. Ses cheveux châtains, attachés en chignon, lui donnaient son air sévère, que Duncan avait remarqué tout à l’heure. À part cela, elle n’avait pas l’air plus âgée que lui – et elle était non seulement gracieuse, comme une danseuse ou une cavalière, mais aussi plutôt jolie.
Il en était là de ses réflexions lorsque la jeune femme lui dit : « C’est ici », en s’arrêtant devant une porte de bois sombre et de verre cathédrale, au fond du couloir du rez-de-chaussée, avant de partir sans un mot. La partie en verre ne portait aucune inscription. On aurait dit l’entrée de n’importe quel secrétariat administratif.
Duncan entra.
Il se trouva dans une grande pièce qui ressemblait à un salon. Par terre, des tapis sur le parquet. Aux murs, quelques tableaux vieillots, sur un fond vert. Canapés et fauteuils. Rien d’extraordinaire.
Ce qui était extraordinaire, c’était que, face à lui, dans les canapés et les fauteuils, se tenaient non seulement le général Gubbins, mais aussi les deux policiers du matin, dont l’un avait une rougeur à la tempe, l’inspecteur qui lui avait donné un coup de poing lors de l’interrogatoire, ainsi que deux personnes qu’il n’avait jamais vues, un homme et une femme. Il s’était douté qu’il pouvait s’agir d’un test, mais il était tout de même un peu surpris.
Un silence se fit.
— Bienvenue à Londres, monsieur McCorquodale, articula paisiblement le général Gubbins.
— Merci, monsieur, répondit Duncan.
— Nous nous revoyons plus tôt que je ne vous l’avais dit. Notre métier est fait de surprises. Je ne vous demande pas si vous avez fait bon voyage, dit Gubbins, en souriant uniquement des yeux.
Ses acolytes sourirent franchement.
— Excellent voyage, merci mon général, répondit Duncan. Un peu de retard en route.
Gubbins sourit de la plaisanterie.
— Très bien. L’humour est une qualité d’agent spécial, comme la pitié. Sans humour, nous devenons des machines. Tout comme sans pitié, nous devenons des assassins.
Puis il continua, sur le même ton :
— Je vais maintenant vous laisser en présence de vos instructeurs, qui vont décortiquer avec vous la façon dont la première journée s’est déroulée. Ils me rendront compte demain matin. Ce soir, vous dormirez ici. Margaret, ma secrétaire, vous montrera votre chambre provisoire.
Gubbins se leva. Par politesse, ses subordonnés se levèrent.
— Bonne nuit à tous.
— Bonsoir, mon général, répondirent les instructeurs.
Quand la porte se referma, le débriefing commença.
Les instructeurs sortirent une bouteille de whisky et un cendrier. On était loin de l’ambiance martiale de l’armée, pensa Duncan, qui pourtant n’y avait jamais servi ; pas besoin de formalisme ou de garde-à-vous, mais tout était extrêmement professionnel.
Pour commencer, l’homme que Duncan ne connaissait pas : c’était le clochard sur la banquette de la gare d’Oxford. Il avait pris le train au moment de la fermeture des portes, alors que Duncan ne regardait plus sur le quai. Ce fut lui qui parla en premier pour constater la légèreté du jeune homme.
Première erreur. On regarde toujours discrètement si on n’est pas suivi. Il existe, poursuivit le clochard, des moyens simples de déjouer ce genre de surveillance – mais ce serait pour plus tard.
Une fois à Paddington, le faux clochard avait téléphoné au SOE pour rendre compte de l’arrestation du jeune homme, conformément au plan.
Le policier – celui que Duncan n’avait pas frappé – parla ensuite. Il lui rappela que la peur des uniformes devait être vaincue, comme toutes les peurs. N’importe quel idiot peut se déguiser en policier. Ce ne sont pas les fonctions qui sont respectables, mais les comportements. Par conséquent, un policier qui arrête un honnête citoyen sans motif ne mérite pas le respect d’un agent en mission. « La prochaine fois, ils seront allemands, vous savez », conclut le faux policier.
Deuxième erreur. On ne se comporte pas comme un naïf avec les autorités. Si on joue au brave citoyen et qu’on se laisse arrêter, c’est parce qu’on a un plan pour s’enfuir. On ne subit pas ce qui se passe, jamais. On a toujours un plan – même un plan brouillon, même un plan inabouti : un plan de sortie, quoi qu’il arrive.
Ce fut au tour de l’inspecteur Higgins de parler. Il dit au jeune homme que son comportement après l’arrestation avait été presque parfait. Excellent mensonge, excellente idée de se faire passer pour un lâche (la police a du mal à imaginer qu’un agent secret puisse jouer ce genre de comédie), excellent prétexte. Très solide. « Comme tous les gens honnêtes, vous mentez bien aux méchants ; vous avez parfaitement compris qu’il faut donner un maximum de détails, la plupart vrais, j’imagine », dit-il en souriant. Duncan acquiesça. En revanche, continua-t-il, le fait d’être insolent et de faire valoir ses droits arrivait trop tard : il fallait le faire avec les policiers à la gare. Une fois prisonnier, c’était une très mauvaise idée.
Troisième erreur, donc. Quand on est prisonnier, on se fait tout de suite passer pour un pauvre type, le plus peureux et le plus inintéressant possible. Plus on se comporte en héros, plus on se fait taper dessus.
— À part cela, conclut-il d’une voix chaleureuse en offrant un whisky à Duncan, j’espère que je ne vous ai pas fait mal. Je sais que pour un boxeur, prendre un coup et avoir les mains liées est très énervant !
Le deuxième policier, celui que Duncan avait assommé, le complimenta sur sa frappe.
— Je vous ai laissé le temps de vous cacher. Sous le tas de charbon, c’était trop évident ; par ailleurs, vous auriez été sans défense et, même en vous échappant, vous auriez été couvert de poussière noire, donc très facile à retrouver dans la rue. Vos deux solutions restantes étaient
– à part ne rien faire, bien sûr ! – soit de tenter de me trancher la gorge avec un morceau de verre, soit de m’assommer. Si vous aviez essayé de me tuer, je me serais évidemment défendu ! dit-il en riant. Mais surtout, vous auriez été renvoyé. On ne tue pas les gens gratuitement, au SOE. Votre coup de poing sur la tempe était impeccable. Je me doutais que j’allais me faire assommer en descendant les marches, mais je pensais au menton. À la tempe, c’est parfait : inconscience brève et immédiate, pas de risque de casse.
À suivre...
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR






























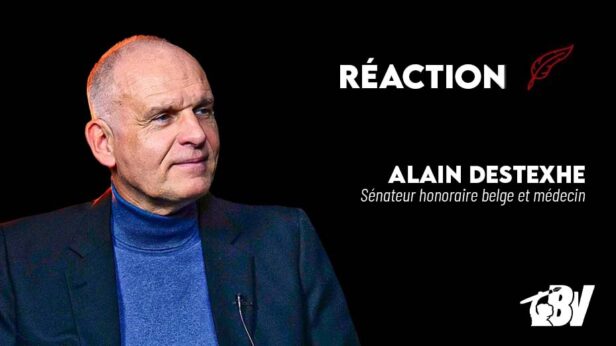










Un commentaire
J’avais vu juste pour le test.