[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – L’heure du déjeuner
7 minutes de lecture

Pour retrouver l'épisode précédent, c'est ici.
C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 12
L’heure du déjeuner
Clac, clac, clac…
Le bruit des semelles, bien qu’il prît garde de courir aussi souplement que possible, devenait pénible. De temps à autre, une bourrasque venue de la côte lui frappait le visage.
Il ne regardait plus sa montre. Il avait probablement les pieds couverts d’ampoules, et en tout cas d’une infinie lourdeur. Les pans de sa veste flottant au vent, la chemise largement ouverte et, chose absurde, les Odes d’Horace dans la poche droite, Duncan courait depuis plus de deux heures. Malgré un entraînement qu’il pensait régulier et une énergie combative – les Anglais disent stamina, comme l’étamine en français – dont il n’était pas peu fier, il commençait à être épuisé. « L’étamine est la partie de la fleur qui donne la vie, pensa-t-il. La vigueur, le retour des saisons, l’énergie qui semble dérisoire et qui est pourtant nécessaire. C’est une amusante étymologie. » Cette dernière pensée ne lui parut pas digne d’être notée. Dans ces moments-là, il aurait bien voulu cesser de penser, d’ailleurs.
Le début de la course avait été relativement facile. Malgré la lourdeur de ses souliers, il s’était imposé dans le peloton de tête. Victoire dérisoire, car il ne s’agissait pas d’arriver le premier, mais d’arriver au complet, avec tout le groupe. À présent, il était seul devant, bénissant l’insistance de ses parents à le voir, dès l’enfance, se dépenser en plein air, mais maudissant aussi, malgré lui, la lenteur de ses poursuivants.
De temps en temps, il se retournait et voyait la jeune fille qui avait brisé ses talons courir quelques mètres derrière lui, avec une grâce assez remarquable. L’effort avait rosi ses joues et ses longs cheveux blonds volaient dans la brise de cette fin de matinée. Elle avait un air de pugnacité et d’abnégation, qui imposait le respect et suscitait cependant une forme d’attendrissement. Duncan se reprit. Ce n’était pas le moment de penser à la beauté des jeunes filles, se dit-il. Ce dialogue interne le fit de nouveau sourire.
La fatigue est une chose étrange quand on n’y est pas habitué. Courir pendant des heures est une sensation particulière, qui procure un grand plaisir quand il n’y a pas de chronomètre, mais peut vite devenir un sujet d’angoisse. Selon que l’on a, ou pas, l’habitude d’être fatigué, cette angoisse peut être difficile à encaisser. Au contraire, quand on connaît les réactions de son organisme, les pensées vagabondent plus librement. On en vient à apprécier l’effort comme l’un des paramètres d’une équation. C’était le cas de Duncan, malgré la souffrance. Après tout, les coureurs n’étaient pas loin du rivage. Ils sentaient le souffle du vent. La matinée était belle, quoique très froide. Ils rendaient service. On leur jouait une sorte de mauvais tour, un défi à relever, voilà tout.
Le château d’Arisaig était toujours invisible. Duncan, cette fois, s’autorisa à regarder sa montre : onze heures et demie. Il allongea la foulée. « Nous n’y serons jamais » fut sa première pensée ; il trouva cette réflexion stupide. Le goût du sang dans la bouche, les poumons en feu, il accéléra la cadence et se tourna vers les autres stagiaires en articulant : « Trente minutes ! »
« La ferme ! » lui répondit une voix haletante, en queue de peloton. Il songea à demander raison de l’affront en arrivant et continua de courir.
La route, toute en faux plats montants et en lacets, encadrée par de grands arbres, ne laissait aucune chance de deviner où on en était. Duncan ne connaissait pas Arisaig. Il se souvenait toutefois de l’emplacement de la plage où avait débarqué le prince Charlie, pas très loin de la position où il se trouvait, et se rappelait qu’il y avait une propriété un peu plus haut. Serait-il possible…
Quelques minutes plus tard, au détour de la route, derrière une colline, un panneau de bois solitaire, dont les caractères étaient presque effacés par les embruns, indiquait « Arisaig House : 0.5 mi ». Le cœur de Duncan cogna de joie : ils étaient presque arrivés. Immédiatement, il annonça la distance restante et fit demi-tour pour aller chercher ceux qui étaient à la traîne, les encourageant de la voix et du geste. « Allez ! Il nous reste un demi-mile à parcourir ! On y sera ! »
Tant bien que mal, la colonne se regroupa. On voyait désormais le chemin qui menait au château et, derrière une haie d’arbres bien taillés, la silhouette austère d’une bâtisse de pierre grise, en forme de U.
Duncan eut alors une idée. Le sergent-major voulait jouer ? On jouerait.
— Dites, les amis, et si nous rentrions en marchant, comme si nous revenions d’une promenade ? Ils doivent nous penser épuisés. Nous leur montrerions qu’ils nous ont sous-estimés !
À ce sujet — [LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Marche forcée
— Vous n’y pensez pas, dit un grand escogriffe au visage chevalin. Ils nous en feraient baver bien davantage encore…
— Je ne suis pas contre un peu de récupération, dit un autre, bon coureur lui aussi, d’un ton jovial.
— En voilà une bonne idée ! dit la jeune fille aux cheveux blonds, d’une voix claire.
Les garçons qui traînaient baissèrent la tête en silence et se rangèrent à son avis. Duncan était heureux et fier d’être provisoirement à la tête de cette petite bande. Immédiatement cependant, il imagina son père lui dire, de sa voix profonde, « tu ne le dois qu’à tes jambes, mon garçon ! » et oublia aussi sec sa bouffée d’orgueil. Courir vite ne faisait pas de vous un chef ; cela ne faisait de vous que quelqu’un qui… ma foi, courait vite.
Les derniers arrivaient, chevaleresques, qui se relayaient depuis longtemps, à en juger par leur état de fatigue et leur visage en sueur, pour porter les deux autres jeunes femmes sans souliers. Duncan eut soudain terriblement honte de lui. Il avait certes mené la troupe, qui sans son exemple ne serait pas arrivée à l’heure, mais il avait oublié l’essentiel : l’attention portée aux autres, l’aide accordée à ceux qui sont en difficulté, la galanterie. Il se sentit ridicule. Son orgueil d’un instant l’avait définitivement quitté.
En quelques instants, tout en marchant d’un aussi bon pas que la douleur le permettait, chacun se rhabilla correctement. Une fontaine, à l’avant-dernier carrefour, leur permit de procéder à de sommaires ablutions, et ce fut au pas, en bon ordre, apparemment reposés, que les douze apprentis clandestins franchirent la grille du château d’Arisaig. Certains s’offrirent même le luxe de discuter à mi-voix.
Dans la cour du château, le sergent-major attendait, impassible, les yeux fixés sur sa montre. Derrière lui, bien rangées, se trouvaient les valises des stagiaires. Le sous-officier leva la tête sans hâte en voyant arriver la petite troupe. Son visage n’exprima aucune émotion particulière.
— Mesdames et messieurs, prononça-t-il de sa voix nonchalante, il est 11 h 45. Vous avez rendez-vous dans un quart d’heure avec le chef du centre.
On n’entendait pas un bruit. Les douze jeunes gens attendaient une nouvelle épreuve, une autre surprise qui les mettrait en difficulté, ou du moins en déséquilibre. C’était probablement le réflexe que le sergent-major voulait qu’ils prissent dès leur arrivée, car il se contenta de laisser tomber :
— Récupérez vos valises. Les chambres sont dans l’aile ouest, fit-il avec un vague geste du bras. Vos noms et les clés sont sur les portes.
Il n’y avait pas à traîner, mais on serait à l’heure. En quelques minutes, les futurs agents eurent récupéré leurs valises, rejoint l’aile ouest, ouvert la porte de leur chambre, déposé leurs affaires et se furent de nouveau rassemblés, dans un alignement quasi militaire, devant le bâtiment principal.
Duncan croisa la jeune fille blonde.
— Je suis Duncan McCorquodale, au fait.
— Deborah Stuart.
Elle tendit, en souriant, une petite main fine que Duncan serra à peine. Il n’y avait pas eu de consignes particulières sur l’usage d’éventuels pseudonymes. Il avait décidé qu’il n’en aurait pas besoin – et la suite ne devait pas le démentir.
Le sergent-major n’avait pas bougé. Et, quand tous furent arrivés, de la même voix, consultant de nouveau sa montre, il dit :
— C’est l’heure du déjeuner. Le chef de centre va vous dire un mot.
De fait, la porte principale du château s’ouvrit à ce moment même.
À suivre...









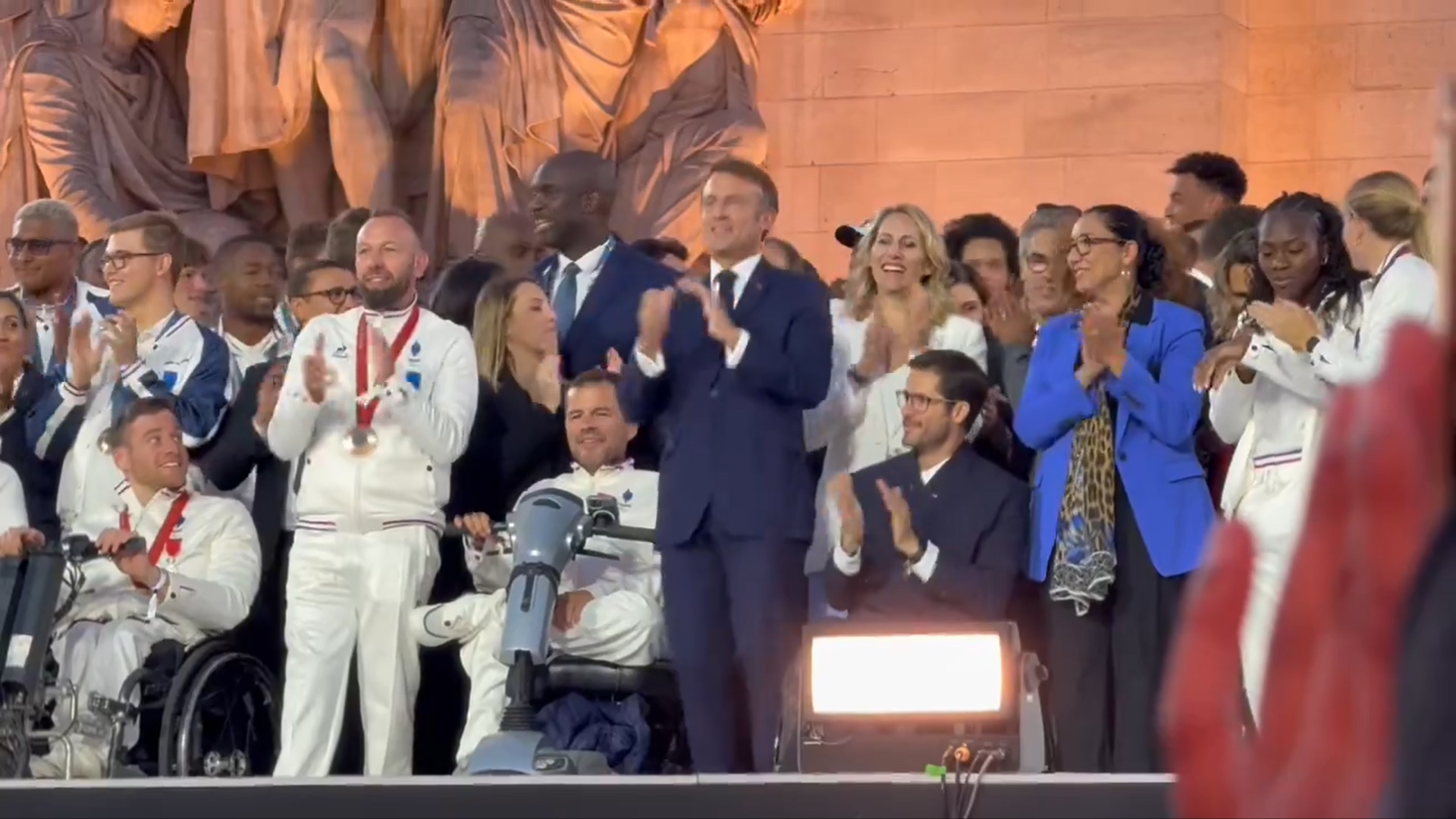








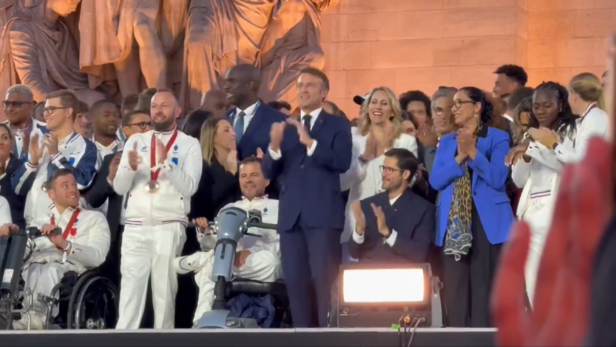























Un commentaire
Tant d’efforts et de jeunesse sacrifiée, de martyres, de morts, lors du dernier conflit pour en arriver, de nos jours, à ce que nos démocraties soient remises en cause, dans la mesure où certains nous disent que les lois de la charia prévalent sur celles de la République… Il y a moins d’un siècle être patriote était héroïque, aujourd’hui être patriote c’est être mis au rang de l’infamie, assimilé aux ennemis nazis… Allez comprendre !