[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard– Une convocation

C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 1
Une convocation
Le 26 novembre 1940 au soir, l’université d’Oxford, la plus vieille de toute l’Angleterre, était endormie sous la neige. Un épais manteau blanc s’était doucement posé sur les vieilles pierres grises, recouvrant les toits pentus, rendant silencieux et immaculés les vénérables cloîtres. Les étudiants en cape noire quittaient les cours par groupes de deux ou trois, emportant sous le bras des liasses de notes ou des serviettes de cuir. Leurs pas crissaient sourdement dans les rues désertes. Au lieu de l’agitation habituelle de la fin de journée, la manifestation précoce de l’hiver avait fait tomber sur ce décor médiéval un silence surprenant et presque religieux.
Comme autant de petits monastères, les différents collèges (c’est le nom que les Anglais donnent aux vénérables institutions d’Oxford qui, toutes ensemble, forment l’université) gardaient leurs lumières faiblement allumées jusque tard dans la nuit, comme s’ils avaient abrité des frères copistes. Derrière ces fenêtres, des murs de livres reliés s’élevaient jusqu’au plafond dans les bibliothèques ; des parquets brillants grinçaient ; des volumes plus que centenaires, contenant des pages d’Homère ou de Virgile, de Hobbes ou de Platon, étaient ouverts sur de longues tables d’acajou, doucement éclairées par des lampes à abat-jour vert. La vieille Europe, dans ce qu’elle possédait de plus cultivé, de plus immémorial, transmettait son savoir.
Sept heures allaient bientôt sonner au clocher de Christ Church, la cathédrale de la ville, quand Duncan McCorquodale frappa à la porte du maître des études du Balliol College, l’un des plus anciens et des plus respectables d’Oxford.
— Entrez !
L’étudiant poussa le battant de l’imposante double porte capitonnée et entra, vêtu de son uniforme (habit noir, chemise blanche, nœud papillon blanc), par-dessus lequel il portait la cape réglementaire. Il se trouva dans une vaste pièce, éclairée seulement par la lampe du bureau, et dont la décoration lui faisait penser à la bibliothèque du Collège : murs couverts de vieux livres, parquet clair, quelques petites tables, un grand globe terrestre à sa gauche. À sa droite, trois fauteuils et une table ronde formaient un salon. Face à lui, derrière les chaises des visiteurs et le bureau du maître, une haute fenêtre arrondie donnait sur la rue principale d’Oxford. On voyait les flocons de neige tomber dehors, à la lueur d’un lampadaire.
Alexander Dunlop Lindsay, maître des études, leva le nez d’une liasse de documents. Son visiteur était de taille moyenne, d’une maigreur athlétique qui laissait une impression d’énergie et d’endurance. Il avait les cheveux châtains, brossés sans soin, et des yeux d’un bleu très clair. Son attitude, déférente mais sans affectation, dénotait une excellente éducation. À côté de Lindsay, un homme en uniforme, qui regardait les flocons tomber, tournait le dos à Duncan. Il y eut un silence.
— Mon nom est Duncan McCorquodale, Sir. Vous avez demandé à me voir.
Il avait parlé d’une voix calme et assurée, avec une nuance de nonchalance qui était la marque habituelle des étudiants de Balliol.
— Bien sûr que vous êtes Duncan McCorquodale. Eh bien, asseyez-vous, dit-il en désignant une des chaises qui se trouvaient devant son bureau. Asseyez-vous, je vous en prie.
McCorquodale s’assit. L’homme en uniforme se retourna. C’était un général de brigade d’une quarantaine d’années, portant une moustache relevée en croc. Il était plutôt petit, mais se tenait très droit. Malgré son air bienveillant, il semblait taillé dans le roc et ses yeux demeuraient sans expression.
— Bien, commença Lindsay en regardant ses papiers, je suppose que vous n’avez pas la moindre idée de la raison pour laquelle vous êtes ici.
— Pas la moindre, Sir, en effet.
— Cela est tout à fait normal. Mais avant que nous ne commencions, auriez-vous la bonté de vous présenter au général Gubbins, ici présent ?
— Certainement, Sir. Vous connaissez déjà mon nom ; je suis âgé de vingt ans et je suis dans ma troisième année d’études de lettres classiques au Balliol College, continua-t-il à l’adresse du général. J’étudie plus particulièrement Homère. Je consacre le temps qui me reste à la pratique de la boxe et de l’aviron et à la Debating Society de l’université. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, dit-il en regardant M. Lindsay.
— Avez-vous une famille ? dit le général Gubbins.
La phrase avait été prononcée avec un accent nettement écossais, sur un ton parfaitement indifférent. Toutefois les yeux du général s’étaient vissés sur McCorquodale.
— Tout à fait, mon général. Mes parents vivent à Phantelean, en Écosse, et j’ai deux petites sœurs de douze et dix ans.
— Je crois, continua le général d’une voix toujours indifférente, que votre père, Lord Lachlan McCorquodale, a servi la Couronne lors de la bataille de la Somme ?
— Oui, mon général. Mon père a terminé la guerre comme capitaine. Il a eu l’honneur d’être l’interprète du général Carton de Wiart.
À ce nom, le général Gubbins cessa de prendre un air indifférent.
La bataille de la Somme, pendant la Première Guerre mondiale, avait duré de juillet a novembre 1916, dans le nord de la France. Au prix d’efforts très importants, les Anglais et les Français avaient regagné du terrain sur les Allemands, au point de pousser leurs troupes jusque sur le territoire du Kaiser. Cette bataille terrible et sanglante leur avait redonné espoir.
Quant au général Carton de Wiart, malgré son nom bien français, c’était un officier anglais, un véritable héros de la guerre. Il avait perdu un œil à la bataille de la Somme en tant que lieutenant-colonel. Quelques mois plus tard, il fut nommé général et on lui donna une brigade. Ses hommes furent effrayés car il avait la réputation de se jeter dans la bataille sans la moindre peur. C’était aussi un soldat très attentif. Ainsi, lorsqu’il passa sa brigade en revue, avec son bandeau sur l’œil, l’un de ses sous-officiers raconta que, bien qu’il fût borgne, le général lui avait fait remarquer que son lacet était cassé.
Le général Gubbins, qui se tenait face à notre héros, avait servi sous les ordres de Carton de Wiart et avait fait preuve, lui aussi, d’une extraordinaire bravoure. Il savait que Lord McCorquodale avait fait partie de l’état-major du général et, comme on le verra, c’était une des raisons de sa présence dans les murs de Balliol.
— Oui, fit-il, comme s’il venait seulement de s’en souvenir, ce nom me dit quelque chose en effet ; je crois que votre père parlait couramment le français et l’allemand.
— En effet, mon général.
— Avez-vous hérité de son don pour les langues ?
— Je l’espère, mon général, en tout cas j’essaie d’être à sa hauteur.
Duncan McCorquodale était faussement modeste ; outre le français et l’allemand, qu’il parlait sans accent, il connaissait l’italien et le grec. Considérant que l’étude des classiques ne valait rien si l’on ne se préparait pas à connaître le monde d’aujourd’hui, il avait appris ces deux langues par lui-même, en même temps que le latin et le grec ancien, qui étaient leurs ancêtres.
Tous ces renseignements figuraient, bien évidemment, dans le dossier qu’Alexander Lindsay tenait ouvert sur son bureau.
Le général s’éclaircit la gorge, ce qui pouvait signifier qu’il passait la parole à Lindsay.
— Bien, reprit ce dernier, je crois qu’il ne serait pas inutile d’en venir directement au fait. Vous n’ignorez pas, jeune homme, que notre pays fait actuellement face à l’attaque de l’Allemagne avec tout le courage dont il est capable.
— Je ne l’ignore pas, Monsieur.
— Vous savez donc aussi que, dans cette bataille, tous les talents seront utiles, et que ces talents seront exploités à leur maximum, afin que prévale l’Empire ?
— Oui, je – pardonnez-moi, monsieur, mais avez-vous l’intention de me demander d’être l’interprète du général Gubbins ? demanda Duncan sans regarder l’officier.
Un bref silence se fit. Lindsay et Gubbins se regardèrent. Ce fut le général qui reprit la parole.
— Pas tout à fait, dit-il de sa voix calme et irréfutable. Voyez-vous, monsieur McCorquodale, si nous avons besoin de tous les talents, nous – et par « nous », je parle de l’unité que j’ai le privilège de diriger – aurons surtout besoin d’individus bien particuliers – de personnalités, comme on dit. Un individu, comme vous le comprenez certainement, ne se résume pas à ses compétences en langues, à ses centres d’intérêt, au fait qu’il pratique l’aviron ou prenne plaisir à débattre avec éloquence au sein de la Debating Society.
« Un individu, continua-t-il en regardant le jeune homme, ne nous intéresse pas uniquement parce qu’il est le descendant de tel ou tel illustre clan écossais, ni parce que son père a bien servi le roi ou parce qu’il connaît l’œuvre d’Homère. Ce qui intéresse mon unité, c’est l’ensemble de ces éléments. Les qualités, les défauts, les compétences, l’histoire personnelle et tant d’autres choses. » Il sortit une pipe qu’il bourrait tout en parlant.
« Mon unité, continua-t-il, est, je crois pouvoir le dire, quelque chose de tout à fait nouveau. Quelque chose de spécial. Nous avons une mission, et c’est Winston Churchill qui nous l’a personnellement donnée : « mettre l’Europe à feu et à sang ». Nous avons un nom, mais il est un peu tôt pour que je vous le donne. Nous avons surtout, et c’est là le but de notre petit entretien (il alluma sa pipe dont il tira quelques bouffées), nous avons surtout un emploi à vous proposer. »
— À moi ? fit le jeune homme avec un sincère étonnement.
— Oui, à vous, répondit Gubbins. À vous, l’Honorable Duncan McCorquodale, fils de Lachlan McCorquodale, baron McCorquodale et chef de clan, et de Dagmar von Grumbach. À vous dont je connais le père, qui a servi en héros. À vous qui êtes un brillant orateur et un boxeur agressif, qui parlez cinq langues et qui avez déjà voyagé en Europe. J’ai pris la liberté de contacter mon ami monsieur Alexander Lindsay, il y a quelques semaines, afin de lui demander si certains de ses étudiants étaient capables, selon lui, de conduire certaines missions pour le compte du Royaume-Uni. Votre nom m’a été donné.
Duncan McCorquodale regarda le maître de Balliol, qui fit un geste de la main, comme pour signifier qu’il n’avait trouvé personne d’autre pour cet emploi. Le général prit une légère inspiration.
— Les jeunes gens et jeunes filles que nous recrutons, nous les appelons : des agents. Ce sont des individus à qui nous donnerons une formation militaire de très haut niveau. Nous leur apprendrons à évoluer dans des mondes dangereux dont ils n’ont pas la moindre idée. Ils sauteront en parachute sur l’Europe occupée, pour aller donner une bonne leçon à ces damnés malades de nazis. Ils franchiront des murs et marcheront des jours entiers dans la forêt. Ils feront exploser des bâtiments, ouvriront des portes et des coffres, poignarderont des sentinelles et s’en iront comme des courants d’air, avec de faux papiers, par des chemins de traverse. Ils devront résister au froid, à la fatigue, à la torture s’il le faut, mais surtout à la solitude, au silence et à l’incertitude. Ils seront capables d’être de parfaits gentlemen, mais aussi de se comporter comme les derniers des voyous. Nous ne leur donnerons ni médailles en chocolat ni reconnaissance officielle. Cela, c’est bon pour les faux héros, qui ont toujours besoin qu’on leur dise merci. Leur courage – et c’est cela, le vrai courage – restera entre Dieu, leur conscience et mon unité. Alors, voulez-vous faire partie de cette équipe ? Voulez-vous m’aider, comme le demande notre Premier ministre, à mettre le feu à l’Europe, monsieur McCorquodale ? (Note)
Il avait dit tout cela sans élever la voix, en détachant toutes les syllabes.
Quand on pose ce genre de question à un jeune homme de vingt ans, patriote et équilibré, on s’attend à la réponse. Aussi Duncan répondit-il immédiatement, en essayant d’avoir la même voix calme et neutre :
— Bien sûr, mon général. Je crois que cela me plairait.
Le général Gubbins prit un instant pour répondre. Il s’adressa d’abord à Lindsay :
— Eh bien, Sandie – c’était le surnom du professeur –, il me semble que vous allez devoir vous séparer d’un de vos hellénistes pour quelques mois, on dirait.
— Quelques mois, ou davantage. – Il regarda en direction du globe –. Messieurs, je pense que tout cela mérite un brandy. McCorquodale, si le dîner d’hier ne vous a pas suffi, bien sûr…
Le 25 novembre, soit la veille de cet entretien, était le jour de la Sainte-Catherine d’Alexandrie, patronne du collège, et par conséquent la date du dîner annuel des étudiants du Balliol College, lequel dîner, on s’en doute, était passablement alcoolisé. Duncan McCorquodale, comme tous les étudiants de l’université, avait bien profité de l’occasion. Mais, comme son père avait l’ivresse en horreur, il avait appliqué ses conseils et avait donc été raisonnable. Aussi fut-ce en toute honnêteté qu’il répondit :
— Ce sera avec plaisir, monsieur. Vos étudiants savent se tenir.
Alexander Lindsay sourit, se dirigea vers le globe dont il souleva le couvercle, dévoilant un bar pléthorique. Il sortit une vieille bouteille, dans laquelle dansait un alcool brun-roux, servit trois verres et les posa sur la table ronde. Ses hôtes se levèrent. Les trois hommes, qui avaient en commun leurs origines écossaises et, désormais, partageaient un secret, firent tournoyer le brandy dans la paume de leur main.
— Au roi ! dit Lindsay.
— Au roi ! répondirent en chœur Gubbins et McCorquodale.
Ils choquèrent les verres et s’assirent dans les fauteuils qui entouraient la table ronde. La neige avait cessé de tomber dehors.
— Il est peut-être temps, jeune homme, dit le général Gubbins après avoir bu une gorgée de brandy, que je vous dise quelques mots sur ce que nous faisons.
— Qui cela, « nous » ? dit Duncan avec une pointe d’ironie.
— C’est juste, fit Gubbins en souriant à son tour. Je ne vous ai même pas donné le nom de mon unité. Eh bien, désormais, McCorquodale, vous allez travailler pour le Special Operations Executive.
À suivre...
Note : Ce mot de Churchill est repris par de nombreux historiens, ici ou ici.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
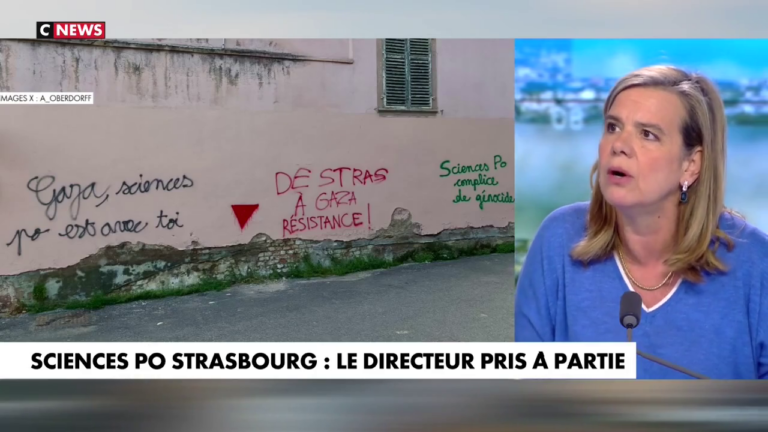




























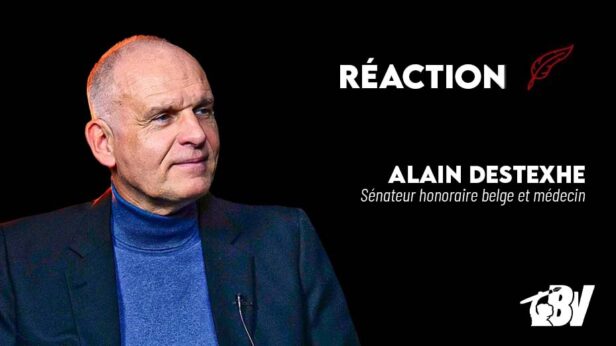










3 commentaires
« Et maintenant, mettez le feu à l’Europe ! » Winston Churchill, Premier ministre… Effectivement la RAF a carbonisé quelques villes d’Europe. Mais ces gens étaient l’incarnation du Bien, aussi leurs crimes n’en étaient pas. À quand le crépuscule de ces idoles maléfiques ?
Beau texte, bien écrit. Personnellement, je me suis toujours demandée quelles auraient été mes réactions, lors de la dernière guerre, face à la Résistance. Mes convictions s’opposent à l’idée de tuer et la perspective de la torture m’est intolérable… Toutefois, accepter l’occupation est également intolérable. Quel dilemme !!!
Ils résistaient, c’est tout, chacun à son petit niveau et dans ses moyens ; armés seulement de bon sens, de bonté, de justice, et d’un peu de prudence ; au jour le jour et sans « plans sur la comète »..Une amie tout récemment décédée faisait à 14 ans, forte de son parler alsacien, le parcours à vélo de Saverne à Nancy pour porter des plis secrets de son papa cachés sous du linge et des sandwichs..