[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Une journée ordinaire

Pour retrouver l'épisode précédent, c'est ici.
C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 25
Une journée ordinaire
La journée du lendemain commença, pour Duncan, un peu plus tôt que pour les autres agents. Après avoir, quelques heures auparavant, caché la bicyclette dans les bois, pris une douche et dormi autant que possible, il se leva à l’aube et, une fois rasé et en uniforme, guetta l’arrivée d’Arthur en se postant dans un coin du château qui donnait sur l’aile des instructeurs. Il avait laissé la fenêtre de sa chambre très légèrement entrouverte, pour pouvoir revenir discrètement plus tard.
Vers 7 h 30, le vieux professeur, qui habitait probablement aux abords d’Arisaig, sinon dans ses murs, apparut sur le perron et alluma une cigarette. Duncan sortit de son embrasure, comme s’il allait prendre le frais avant les cours. L’idée de fumer une cigarette en guise d’accroche de sa « cible » lui répugnait profondément. Il n’avait jamais fumé et ne comptait pas commencer. Il allait devoir trouver autre chose – ou même rien du tout.
— Bonjour Arthur, comment allez-vous ? commença-t-il dans un français impeccable.
— Oh, bonjour mon lieutenant, bonjour, repartit le professeur avec bénignité.
La suite se déroula exclusivement en français, ce qui permettrait peut-être à Duncan, dans une langue qui s’y prêtait mieux que l’allemand, et qu’il maîtrisait plus naturellement que l’italien, de parvenir à ses fins.
— Je me demandais, attaqua directement le jeune agent, si vous m’autoriseriez à m’absenter aujourd’hui, pour des raisons de service, puisque aujourd’hui nous allons parler français.
Arthur se voûta légèrement et tira, entre le pouce et l’index, en clignant d’un œil, une longue bouffée de sa cigarette, qu’il souffla droit devant lui, comme un paysan qui réfléchit. « Il fume même en français », s’amusa intérieurement Duncan, admiratif.
— Je présume que t’as tes raisons, mon gars, dit le professeur en changeant d’accent. Il prit soudain un air bourru, sourcils froncés, en roulant les « r ». Il n’avait plus rien d’indistinctement européen : n’eût été l’impeccable costume qu’il portait, bleu marine ce jour-là, on aurait dit un agriculteur français, sans aucun doute possible.
— C’est pas pour vous manquer de respect, m’sieur, répondit Duncan sur le même ton, qu’il voulait tout aussi rustique (berrichon, normand ou auvergnat ? Il n’était pas sûr de lui), mais j’ai vraiment besoin d’sortir de classe aujourd’hui, vous savez. Je rattraperai tout c’que vous aurez fait aujourd’hui.
Il y eut un petit moment de silence. Arthur tira de nouveau sur sa cigarette puis regarda Duncan, cette fois sans aménité particulière.
— D’accord, fit-il en se redressant et en reprenant la voix française qu’il adoptait naturellement pendant les cours. Je n’ai pas à savoir de quoi il s’agit et je n’en rendrai pas compte à votre encadrement. Vous possédez d’excellentes dispositions en langues étrangères, notamment, à l’évidence, en français, et vous avez certainement quelque chose d’important à faire. Je ne vous demande que deux choses : d’abord, soyez à 6 heures ce soir à la fin du cours.
— Certainement, Arthur, pas de problème.
— Et travaillez vos accents régionaux. Vous ne savez pas dans quelle région vous irez – si toutefois vous allez en France.
— Bien, Arthur.
— Et maintenant, filez ! conclut l’instructeur en esquissant un sourire.
Duncan ne se le fit pas dire deux fois. Il courut se changer, enfila la dernière chemise civile propre de sa valise (à Arisaig, on ne lavait le linge que le dimanche), marcha rapidement jusqu’aux sous-bois, retrouva le vélo et partit.
Le soleil se levait paresseusement au-dessus d’un paysage humide. Duncan avait pris un carnet, un crayon, la carte des environs dans la doublure de sa veste et son faux passeport dans sa poche. Il pédalait sans hâte excessive le long de la route.
Il fut aux escaliers de Neptune au tout début de la matinée. Les maisons étaient ouvertes, quelques dames entre deux âges marchaient dans les petites rues. Le ciel était frais et dégagé. Le mécanisme du cabestan, dont les pales étaient bien visibles le long de l’écluse, était relativement facile d’accès. Il y avait un drôle de contraste entre l’aspect pacifique, inoffensif, du village éveillé, et ce qu’il se préparait à y commettre – fût-ce pour les besoins de l’exercice. Nul ne le verrait, nul ne le saurait. Ainsi allait la vie d’un agent clandestin, dans une sorte de réalité superposée, ni tout à fait différente du monde quotidien, ni comparable pour autant.
Duncan arpenta les environs toute la journée. Il prit des notes sur les points de coordination, mesura les distances à parcourir, évalua les angles morts et les possibilités de se cacher. Il échafauda des prétextes pour la présence de chaque agent, couvrit à vélo les chemins d’accès et de repli et commença à répartir les responsabilités. Les heures passaient vite et il ne prit pas le temps de déjeuner. Selon ses estimations, il lui faudrait partir vers 3 heures afin d’avoir le temps de reposer discrètement la bicyclette en place – à supposer que personne n’ait remarqué sa disparition – et de remettre son uniforme pour dîner au mess.
À deux heures et demie, Duncan relut longuement ses notes : il avait terminé ses calculs de charges explosives, étudié les cas non conformes, marqué précisément sur la carte où il situait les points de regroupement, ainsi que le plus capital, la dernière main courante : le point de raccroc. Il pouvait partir. La mission était ficelée. Il avait tout étudié. Le reste serait de la mise en forme.
Peu après 4 heures de l’après-midi, il fut en vue d’Arisaig. Il gara la bicyclette dans les sous-bois alentour, mémorisa son emplacement pour la remettre en place à la tombée de la nuit, courut – hors de vue du château – jusqu’à la fenêtre de sa chambre, se glissa à l’intérieur et se mit en uniforme. Il prit le temps de relire de nouveau ses notes, rectifia quelques idées qu’il avait ruminées pendant le trajet du retour et rangea le tout sous la latte du parquet. Après cela, il attendit 5 heures, heure traditionnelle de la pause avant les derniers extraits de films – ce jour-là, il le savait, c’était la suite de La Grande Illusion, de Jean Renoir, commencé quelques jours auparavant. Cette histoire d’héroïsme et d’amitié, dans la tourmente d’une guerre imaginée avant qu’elle n’eût lieu, parlait au cœur de Duncan.
À 5 heures juste, les huit agents sortirent prendre l’air, accompagnant Denise Reynolds et Patrick Shannon, qui fumaient. Duncan se mêla à leur groupe, l’air aussi détaché que possible.
— Bon sang, Duncan, où étiez-vous passé ? l’apostropha (en français, bien sûr) Hendricks, qui avait toujours un peu de mal avec les voyelles – les « ou », notamment.
— J’ai dû partir flâner un peu, répondit-il, nonchalamment.
Deborah s’approcha de lui avec un sourire ironique.
— Tu as raté un film très intéressant, aujourd’hui.
— J’ai préparé quelque chose de plus intéressant encore.
Avec une discrétion devenue tout à fait naturelle, personne ne chercha véritablement à connaître la raison de son absence prolongée. Ils n’en avaient pas besoin. C’était le métier.
Arthur, déjà, s’approchait dans l’encadrement de la porte, le maintien digne. Il haussa un sourcil en apercevant Duncan. Le rôle du capitaine de Boëldieu, incarné par Pierre Fresnay dans le film qu’il venait de projeter, semblait avoir déteint quelque peu sur lui.
— Alors, mon lieutenant, dit-il, comment s’est passée cette journée ?
— Fort bien, Arthur, vraiment. Une journée ordinaire.
Plusieurs sourires saluèrent cette remarque. Arthur s’assura que Shannon et Denise avaient terminé leur cigarette. Puis :
— Allons, il est temps de terminer notre instruction.
Le mot « instruction », Arthur le savait, était une des faiblesses de John Gordon, qui prononçait le « r » avec un raclement de gorge presque flamand. Le professeur ne perdait décidément pas une occasion d’enseigner.
Un à un, les agents, redevenus silencieux, regagnèrent la salle de cours obscure. Dans la chaude lumière du projecteur, comme autant d’étoiles grises, les grains de poussière dansaient.
À suivre...
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR































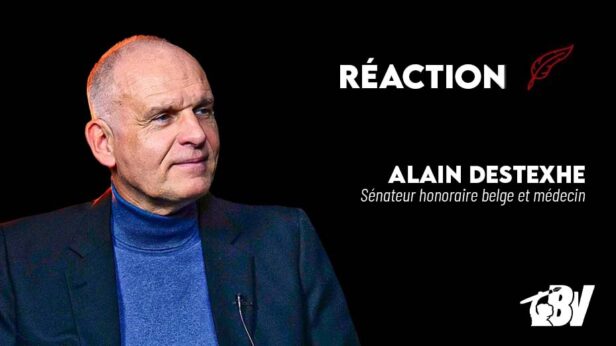










BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :