[LIVRE] M. Maffesoli nous délivre un remède contre la sinistrose de l’époque !

Apologie. Autobiographie intellectuelle : avec un tel titre, on aurait pu s’attendre à « un livre de combat ». Mais Maffesoli ne considère pas que la sociologie soit « un sport de combat » et il ne s’agit, dans cette « apologie », au sens traditionnel du terme, ni d’une exaltation de son ego ni d’un règlement de comptes.
Maffesoli, sociologue de la postmodernité
Pourtant on sait que ce sociologue de la postmodernité a suscité de nombreuses polémiques, dans sa discipline où ses détracteurs l’ont accusé de n’être ni scientifique (ce qu’il n’est effectivement pas, ne pratiquant ni la mesure, ni l’observation objective et distancée des enquêtes quantitatives), ni strictement observant des canons de la discipline, ce qu’il n’est effectivement pas non plus, lui qui, comme son maître Gilbert Durand, s’est toujours défini comme un essayiste aux confluents de diverses disciplines : philosophie, théologie, anthropologie, sociologie. À peine relate-t-il ses échanges, respectueux, mais effectivement en désaccord avec Pierre Bourdieu, dont il déplore malgré tout qu’on lui attribue la création de la notion d’habitus, qu’il a reprise à Panofsky et, avant lui, à saint Thomas d’Aquin.
Pas de réponse, non plus, dans ce livre aux nombreuses polémiques journalistiques et politiques qui l’ont accusé d’être de droite, voire d’extrême droite… Maffesoli s’en tient aux leçons de son maître Julien Freund, de neutralité axiologique : il dit ce qui est et non pas ce qu’il voudrait qui soit. Et s’exprime devant tout public.
Qui a beaucoup de détracteurs a aussi beaucoup d’amis. Et, au fond, c’est ce qu’on trouve essentiellement dans cette autobiographie, relation de beaucoup des rencontres qui l’ont aidé à construire son œuvre.
Une œuvre parfois visionnaire, dans laquelle il décrit, depuis plus de trente ans, le devenir, l’advenir de la société postmoderne. La fin d’une modernité construite sur le rationalisme, l’individualisme, l’utilitarisme et la croyance en un progrès infini et bénéfique. L’émergence de nouvelles formes de solidarité, ce qu’il nomme le Nous plutôt que le Je, une raison sensible, qui prenne en compte l’imaginaire, les rêves et pas seulement la réalité mesurable, l’intérêt pour des activités créatives plutôt que purement utilitaristes et, enfin, un ancrage dans la tradition, une sorte d’attention à ce qui, dans le passé, vivifie le présent. Il rappelle souvent, et dans ce livre également, le titre de sa première thèse, « L’Enracinement dynamique ». C’est-à-dire une conception de l’Histoire qui ne prétend pas (plus) dépasser le passé (« du passé faisons table rase »), qui ne reporte pas à des lendemains qui chantent l’espoir de changement de la société, mais qui s’ancre profondément dans un présent densifié par le passé et contenant dès à présent le futur. L’oxymore est végétal, une plante ne grandit bien qu'à partir de ses racines, et les siècles passés l’ont trop souvent oublié. Nous allons donc retrouver dans ce livre, pourrait-on dire, les racines des principales notions développées dans son œuvre par l'auteur.
Une œuvre dense et exigeante
Œuvre dense, exigeante, aux références nombreuses et d’un abord parfois difficile. Cette autobiographie consacrée au terroir et au terreau humain dans lesquels elle s’inscrit est un moyen poétique et concret de l’aborder. Une poésie du quotidien dans laquelle on voit émerger les notions, les métaphores qu’il déploie pour décrire le climat de l’époque. Une poétique, en quelque sorte, au sens de la « poétique de la relation » d’Édouard Glissant. Maffesoli dirait « éthique de l’esthétique », au sens d’une communion émotionnelle. D’une société aux identifications multiples plutôt qu’aux identités figées.
Un professeur inspiré
Dans cette autobiographie on retrouve le souffle du professeur de la Sorbonne qui nous emmenait dans ces déambulations sociologiques, dans une vision de la société ni judicative, ni normative, mais plutôt jubilatoire. La jubilation du chercheur qui découvre toutes les facettes d’un quotidien « réenchanté ». J’ai fait partie, de longues années durant, de ce public éclectique qui, au-delà des doctorants et postdoctorants, rassemblait des chercheurs, des architectes, des urbanistes, des publicitaires, des hauts fonctionnaires, etc.
J’ai retrouvé dès la couverture du livre, avec la photo de Maffesoli dessinant la spirale du temps sur le tableau noir de l’amphithéâtre Durkheim, le souffle de l’enseignant. Son talent et sa générosité comme passeurs de tous ces penseurs dont il nous transmettait les pépites, qu’il les ait fréquentés dans les livres ou in vivo. « Nous sommes des nains perchés sur les épaules de géants » : Maffesoli a toujours rendu hommage à tous ceux qui l’ont inspiré.
Un livre d'hommages
Et dans ce livre, écrit à l’aube de ses 80 ans, il se livre à un hommage réfléchi et approfondi. Hommage émouvant à ses parents, au village cévenol et à la communauté des mineurs de fond dans lesquels il a grandi. Au contraire de nombre de ses collègues, Michel Maffesoli n’est ni dans la plainte ni dans le déni de ses origines populaires. Comme Richard Hoggart, comme son philosophe de prédilection, Heidegger, il n’a ni regret ni ressentiment de n’avoir pas appartenu, dès ses jeunes années, au Gotha intellectuel parisien. Celui de l’École normale supérieure, celui de la nomenklatura communiste, celui de la médiacratie. Bien peu démophiles, dit-il de ces apôtres de la démocratie.
Hommage, ensuite, à ses maîtres, non seulement ceux qui, à l’université, l’ont guidé dans ses travaux doctoraux : Julien Freund, Lucien Braun et surtout Gilbert Durand, le grand anthropologue de l’imaginaire, l’élève lui-même de Gaston Bachelard et de Carl Gustav Jung. Mais également à ceux qu’il a rencontrés parfois très tôt (Martin Heidegger, Carl Schmitt) et tout au long de sa carrière. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Claude Lévi-Strauss, Jean Baudrillard (l’ami), sans oublier ses collègues proches : Georges Balandier, Louis-Vincent Thomas, André Akoun et Serge Moscovici, le psychosociologue.
Un chercheur exemplaire
J’ai parlé des cours à la Sorbonne. Michel Maffesoli fut aussi un directeur de recherche et de laboratoire (le Centre d’études sur l’actuel et le quotidien, CEAQ) de grande envergure. Ce petit laboratoire, par les moyens humains et matériels, a fédéré de nombreux chercheurs doctorants, français et étrangers, organisant des groupes de recherche, des colloques, des publications. Cette activité qui s’apparente plus à celle d’un atelier de la Renaissance, avec certes un maître, mais des compagnons et des apprentis animés par la même soif de connaissance qu’à celle d’une École, tranche avec le devenir de l’université actuelle, empêtrée par la bureaucratie et les débats idéologiques. La publication, en annexe, de la liste des thèses soutenues sous sa direction témoigne de la fierté du maître devant le travail de tant de jeunes gens à qui il rend hommage, aussi.
Au fond, cette autobiographie est avant tout œuvre de reconnaissance envers tous ceux qui ont aidé Michel Maffesoli à exprimer son amour de la vie. Dans ce livre, il rend grâce à la vie, à sa vie, au souffle de la vie. Car c’est cela, au fond, le centre de son œuvre : montrer, selon l’adage de Nietzsche qu’il aime à citer : « Ici l’on pourrait y vivre parce que l’on y vit. » C’est pourquoi lire ce livre est un merveilleux remède contre la sinistrose de l’époque !

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
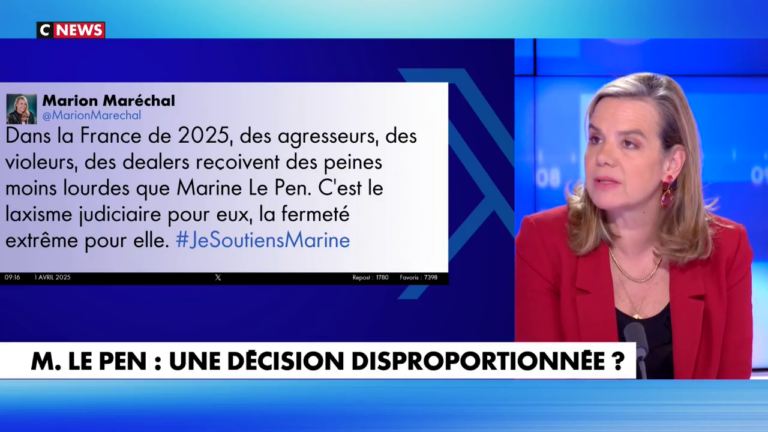

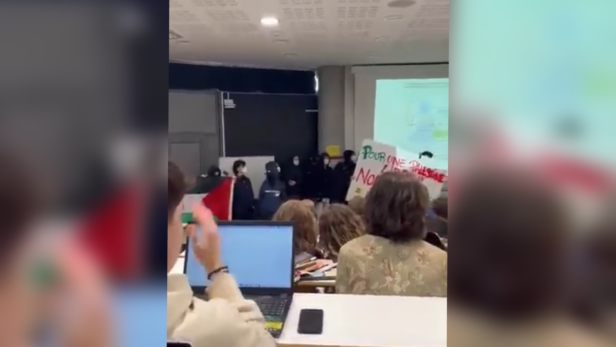






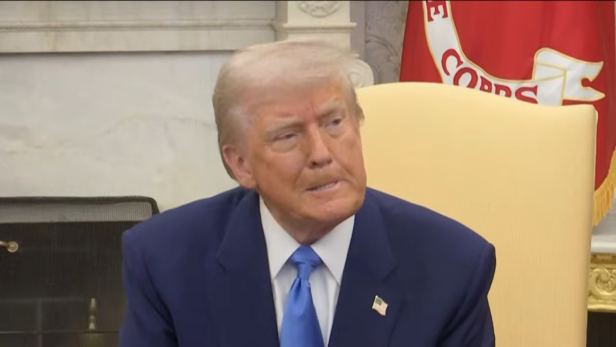










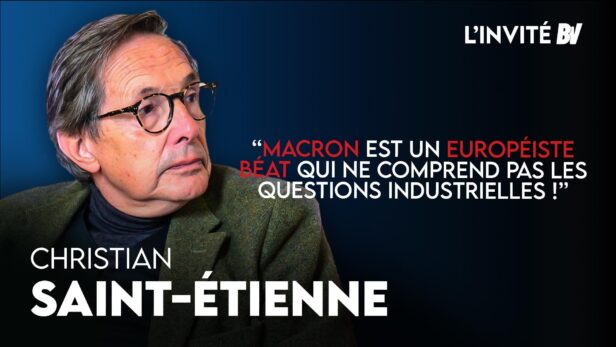





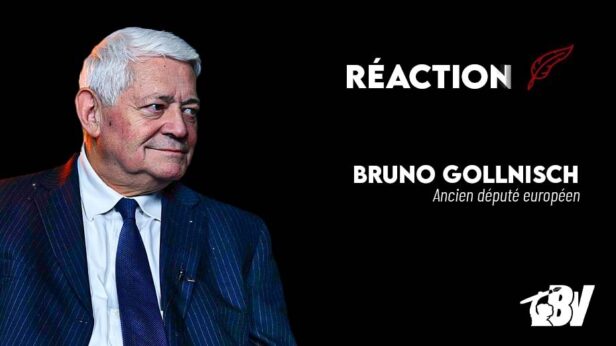











11 commentaires
« »La jubilation du chercheur qui découvre toutes les facettes d’un quotidien « réenchanté ». » » Ce type quand il parle donne l’impression d’être illuminé par la grâce. Ampoulées, alambiquées, ses circonvolutions rhétoriques sont et difficilement abordables.
@Michel Berges : M. Maffessoli ETAIT … franc-maçon mais il en a démissionné .
Il est une personne d’une très grande intégrité .
Vous devriez le lire …!
Il est toujours très agréable de lire ou d’écouter Monsieur Maffesoli. Ses propos sont clairs, sa plume est ciselée et incitent à la réflexion. Qu’on aimerait n’avoir comme représentants que des hommes de sa qualité.
Ce sont les Editions du Cerf qui ont publié le dernier essai de Monsieur Maffesoli.
C’est à remarquer en ces temps où certaines maisons d’édition ont perdu de vue l’éthique intellectuelle et morale.
Un peu d’oxygène avec ce monsieur de 80 ans : j’espère que le « jeune » Macron a inscrit cet essai dans la liste de ses prochaines lectures.
Sûrement passionnant
Non, Madame, chère collègue. Mafesolli, qui appartient à l’École philosophique de Grenoble, autour de Gilbert Durand, sensible à l’analyse des mythes et de l’imaginaire, est un franc-maçon déclaré. Donc un mondialiste dont les idées sont responsables des impasses actuelles sur le plan de ce que l’on appelle « L’Occident ». Derrière la philosophie (comment évoquer Nietzsche !) et une sociologie « fille de l’instant » sur le plan épistémologique, il transfigure en mots doux une réalité dont les idées mondialistess qu’il défend sont responsables du chaos actuel, dans les espaces concernés. Il manque à son œuvre une approche historienne approfondie et anthropologique comparative. Merci de l’avoir évoqué, car il dépasse la propagande journalistique quotidienne.
Absolument d’accord.
Ah ? Le mondialisme est incompatible avec la démocratie, par nature. Il est donc à à tendance totalitaire. Il serait très intéressant de définir concrètement ce qu’est la démocratie, (comme par exemple Etienne Chouard tente de le faire), pour en déduire – comme j’en suis persuadé – qu’elle ne peut exister exclusivement que dans le cadre d’une nation, c’est-à-dire d’un peuple, d’une culture et d’un territoire associés.
Merci à Michel Berges et à BV de publier ce commentaire qui révèle, entre autres, pourquoi Maffesoli est si souvent invité dans les médias. Sa béatitude est une variante du projet de Schwab « ils n’auront plus rien et seront heureux » ! Ce n’est pas ma vision du bonheur !
Il a constaté dans son dernier ouvrage la déviance de la maçonnerie qui s’est embourbée dans la politique. J’aime bien cet homme cultivé.
pertinent!