[LIVRE] « Vivre en ville » : l’humanité en mode urbain, par Jonathan Siksou

Début décembre, Jonathan Siksou a reçu la médaille de vermeil de l’Académie, cuvée 2024, pour son livre Vivre en ville (Éditions du Cerf). L’ouvrage avait reçu auparavant le prix Le Temps retrouvé, « mention spéciale ». Bien que primé - ce qui est arrivé à bien des livres médiocres disparus de la mémoire des hommes -, Vivre en ville est tout sauf un livre bas de gamme, dans la forme comme dans le fond. Quand un écrivain parle de clochards et non de SDF, de concierges et non de gardiennes, et, s’agissant des pigeons et des rats, ne dit pas « animaux liminaires » mais pigeons, rats, on sait qu’il est un écrivain de bonne tenue.
Voyage autour de ma ville
Divisé en deux parties - extérieur, intérieur -, le livre rassemble observations, considérations et souvenirs sur les passants, les affiches, les jardins, les ascenseurs, les commerces, etc., et tant d’autres choses, pour finir avec le chez-soi, qui, tout chez-soi qu’il est, reste une cellule de la ville. Mais quelle ville ? Siksou est-il un piéton de Paris, façon Léon-Paul Fargue ? Cette référence ne figure pas parmi les auteurs de bon style qu’il cite au fil de la plume (Mercier, Queneau, Vialatte…), sans doute parce qu’il n’a pas voulu sembler seulement parisien dans ses déambulations, même si je le soupçonne d’être furieusement parisien.
Sans y toucher, en dandy, Siksou a la dent dure. Au sujet de la mendicité organisée des Roms, lesquels fleurissent sur les trottoirs ou dans le métro, il écrit : « À la faveur des grands principes défendus par l’Union européenne, un commerce prospère : celui de la traite humaine. » Aux observations, l’auteur joint l’art de l’aphorisme. « Je n’ai rien contre les changements de civilisation, il en va ainsi depuis toujours et il serait difficile de s’y opposer ; ce qui m’ennuie, c’est que je ne m’attendais pas à être témoin de la fin de la mienne. »
Nous autres, villes, savons que nous sommes mortelles
Il la constate, cette fin qui se matérialise en un #SaccageParis, à quantité de signes tangibles. Dans sa volonté d’emprise sur le plan et de tout baptiser à sa guise, la mairie de Paris en vient à nommer « places » des croisements de rues. Les commerces changent, et avec eux l’atmosphère d’un quartier : le boucher remplacé par un « créateur de macarons », la teinturerie par « un comptoir à bubble tea »… Le musée devient « un vaste défouloir où des artistes nous font part de leur engagement pour dénoncer, […] le pas joli de l’inégalité, le pas bien de la guerre et le scandale de la pauvreté ».
Reste les églises, « le plus grand musée du monde ». Jonathan Siksou s’émerveille de ce que « l’Église catholique, mécène insurpassable, a permis au génie humain d’offrir ce qu’il a de meilleur et aux artistes de créer ce que personne n’avait fait avant eux ». Il s’interroge devant cet irréfutable constat : « Il y a, là encore, un certain mystère dans tout cela, et je sais pas si c’est - seulement - celui de la foi. » Le mystère de l’espérance, peut-être, en un monde moins laid ?
L’effet Babylone
Dénigrer la ville en soi est un lieu commun depuis longtemps. C’est l’effet Babel, ou Babylone, surnoms qui ont été donnés à Jérusalem, à Paris, à Rome pour en stigmatiser les défauts et les vices. Une page de Félicien Marceau, au début de Bergère Légère, laisse percevoir que les choses sont plus complexes que cela et qu’au cœur des métropoles, au détour d’une rue, on trouve… la province et le village. De même Jonathan Siksou nous laisse-t-il entrevoir des villes parallèles moins rébarbatives où il fait bon vivre, sans rien perdre de son humanité.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR







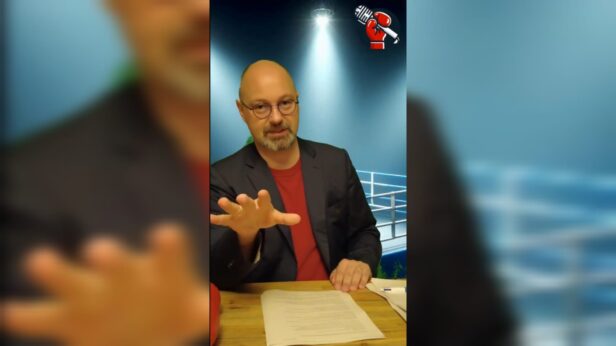



















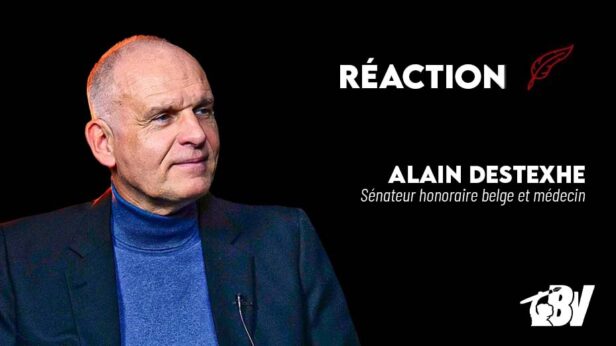









11 commentaires
En tous cas moi, Paris, je n’y vais plus !
Les villes devraient rester petites et à taille humaines, quelques milliers d’habitants. quitte à en avoir plus. L’être humain a besoin d’espace et de nature pas trop artificielle.
Dieu a mis l’homme dans un « jardin », c’est la nature humanisée …
Et Caïn partit fonder des villes …?? Phrase mystérieuse de la Genèse.
Je déduis de la lecture de cet article que le seul vrai mérite de l’auteur de ce livre est d’appartenir au même clan que celui de l’auteur de cet article…
Toutefois beaucoup de manies grotesques de la bien-pensance y sont pointées.
Intéressant
Si comme le prédisent certains, qui ne sont pas des farfelus, il y a un effondrement, il vaudra mieux être au fin fond de la campagne, que dans les villes « heureuses » dont il est question ici.
la ville non merci
Rien ne vaut les petits villages ruraux et paysans sans résidences secondaires.
pour définir le musée, on a maintenant le « centre d’interprétation ».
Preuve qu’on est plus à l’aise dans la « jargonnerie » que dans l’usage de la bonne terminologie.
Dans lequel on peut « revisiter » le passé .