Mort de Claude Régy, metteur en scène exigeant de Sarraute, Pinter, Handke, Depardieu et la Bible
4 minutes de lecture

Un grand du théâtre s'en est allé, ce 26 décembre. Aussi discrètement qu'il avait patiemment enchaîné les perles d'une vie au service du théâtre contemporain, une « aventure », comme il le disait, exceptionnelle : plus de soixante ans de mises en scène. Il s'en étonnait lui-même dans le film-hommage d'Alexandre Barry : « Je me demande comment j’ai pu créer un nouveau spectacle à peu près chaque année, pendant soixante ans. Pour moi, c’est un mystère absolu. »
La liste des auteurs qu'il révéla au public français montre l'exigence qui était la sienne : Harold Pinter, Peter Handke, qui vient de recevoir le prix Nobel, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras. Quant à la liste des acteurs qu'il dirigea, elle donne le tournis : Delphine Seyrig, Jean Rochefort, Michel Bouquet, Jean-Pierre Marielle, Claude Piéplu, Emmanuelle Riva, Pierre Brasseur, Claude Rich, Michael Londsdale... Et donc Gérard Depardieu, à qui il fait passer une audition, à 24 ans, et que le public découvre dans Saved, d'Edward Bond, en 1972, puis dans Isma, de Nathalie Sarraute, et La Chevauchée sur le lac de Constance, de Peter Handke. On a tendance à oublier que Depardieu n'aurait pas été Depardieu sans ces six pièces mises en scène par Claude Régy de 1972 à 1977.
Rien ne prédestinait ce fils d'un officier de cavalerie du Midi protestant né en 1923 à embrasser une carrière de metteur en scène. Et ce fut contre le souhait de son père qu'il s'inscrivit au cours de Charles Dullin, dans l'ombre - un mot essentiel pour comprendre l'homme et ses mises en scène - duquel il va découvrir le métier.
Pourtant, plus qu'il ne le croyait peut-être, le protestantisme des origines le façonna dans ses choix artistiques : rigueur, sobriété, passion pour le texte, les silences, la lenteur, attrait pour les pièces en tension vers un au-delà du langage, un indicible, un sens du tragique, tout cela en faisait une sorte de mystique du théâtre. Gérard Depardieu avait admirablement cerné la personnalité de ce dernier grand patriarche du théâtre : « Une sorte de faucon, au regard dur et au caractère radical […] l’apôtre du silence, de la pénombre et du dépouillement. »
Et en effet, ses premières créations sont marquées du sceau de l'attente et de la perte : en 1952, Doña Rosita, de García Lorca, avec Silvia Monfort, l'histoire d'une jeune femme qui laisse partir son fiancé et attend en vain son retour. Deux ans plus tard, La vie que je t’ai donnée, de Pirandello, l'histoire d'une mère qui a perdu son fils. Tragique encore, quarante ans plus tard, avec Jeanne au bûcher de Claudel et Honegger à l'Opéra Bastille, en 1992.
Mais austère comme un prophète de l'Ancien Testament ou un Agrippa d'Aubigné, Claude Régy l'était aussi sur le théâtre subventionné d'aujourd'hui. En 2001, dans un entretien à Libération, il ne mâchait pas ses mots : « Le “subventionnement” des établissements de la décentralisation théâtrale a créé un monde de fonctionnaires qui dirigent ces maisons comme des sous-ministères. [...] l'histoire de la décentralisation dramatique et celle du communisme se ressemblent. Des amateurs peuvent enlever leur culotte et faire les cons, c'est du théâtre, on peut écrire en imitant un peu les conversations que l'on entend dans les bistrots, c'est du théâtre, mais ce n'est que du théâtre. Pensez à ce que l'on voit dans les rues d'Avignon pendant les tristes semaines où se manifeste cette monstruosité qu'est le Festival et qui ressemble plus à une foire exposition qu'à quelque chose qui aurait encore quelque lien avec l'art. D'ailleurs, il faudrait supprimer le Festival d'Avignon pendant plusieurs années, qu'on oublie cette infection pour avoir idée de reconstruire autre chose. Et pareil pour l'ensemble des maisons de la culture. La situation est alarmante, mais c'est celle de toute notre société, on a le théâtre que l'on mérite. »
Claude Régy avait, de fait, d'autres ambitions : il avait monté les nouvelles traductions des textes bibliques du poète Henri Meschonnic où les blancs sont là pour rendre aux versets bibliques tout leur souffle : en 1995, les Paroles du Sage (L'Ecclésiaste) et, en 2005, Comme un chant de David, d'après Gloires, nouvelle traduction des Psaumes.
Son spectacle Rêve et folie, de Georg Trakl, créé en septembre 2016, au théâtre de Nanterre-Amandiers, restait bien dans cette veine faite d'exigence et d'interrogation métaphysique. Claude Régy disait que ce serait le dernier. Il avait encore eu le mot juste.
En cette nuit du 25 au 26 décembre, il a rejoint « l'insaisissable que l'on touche dans le sombre silence ».
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées







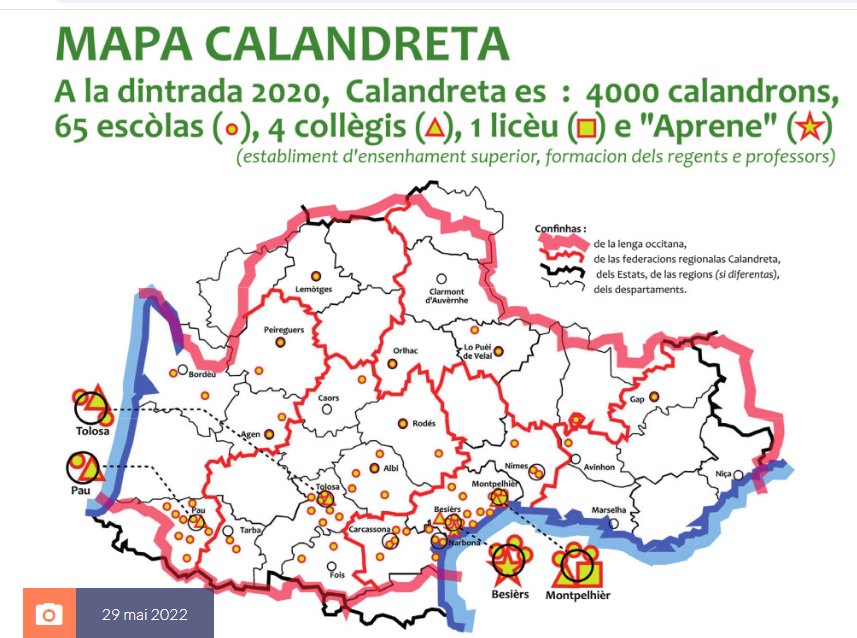




























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :