Paysan, un drôle de métier, et c’est pas d’hier…

Il porte un béret basque, roule les R et compte en anciens francs. Il est aveyronnais. Ce matin, il a commencé son travail à 5 h 30 et n’a pas eu encore le temps de déjeuner. C’est l’époque des foins et, tout à l'heure, l’orage grondait. « Le paysan, vous savez que c’est un drôle de métier, un métier très pénible. » Cela lui plaît-il ? « Ah, ça me plaît, oui ! »
Nous sommes autour de 1969 - il y a un demi-siècle. Le paysan a un fils de 16 ans. Qu’est-ce qu’il va faire, plus tard ? « L’agriculteur, si ça lui plaît, voyez », répond le paysan. Aujourd’hui, cet adolescent que l’on voit dans le film, s’il est encore en vie, est sans doute à la retraite. A-t-il suivi le chemin de son père, qui était probablement celui de son grand-père, de son arrière-grand-père ? À cette époque, il y avait plus de 1.500.000 exploitations agricoles en France. On en compte, aujourd’hui, moins de 440.000.
Toujours à cette époque, plus précisément en 1967, Henri Mendras publiait La Fin des paysans, ouvrage dans lequel l’auteur décrivait la disparition d’une civilisation millénaire. Une civilisation qui reposait sur le travail : on en parle beaucoup dans ce petit film où le paysan dit ne pas compter ses heures. Sans lien de cause à effet, et sans essayer d’y trouver une explication, on allait bientôt entrer dans une « civilisation » où l’on travaillerait de moins en moins et où il y aurait de plus en plus de chômeurs…
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
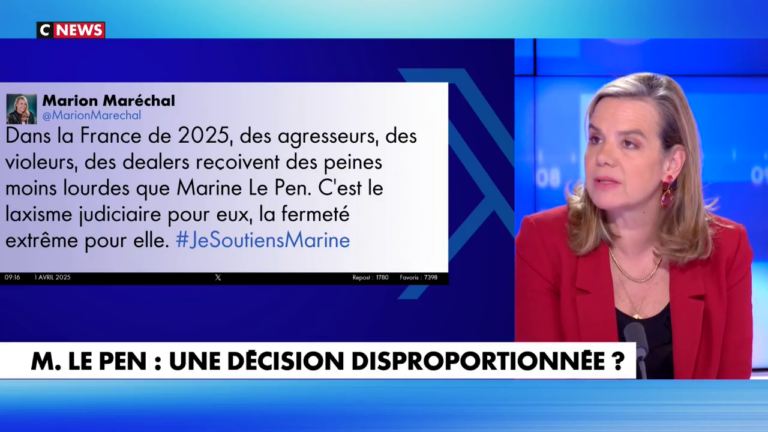


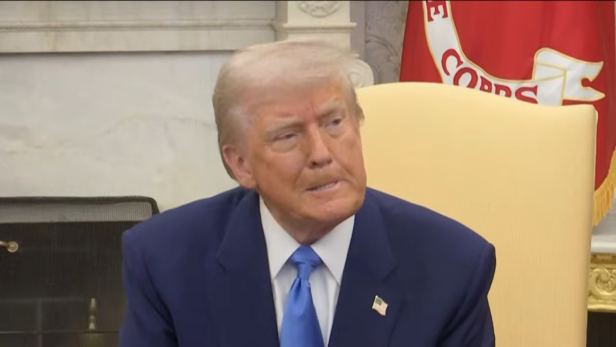




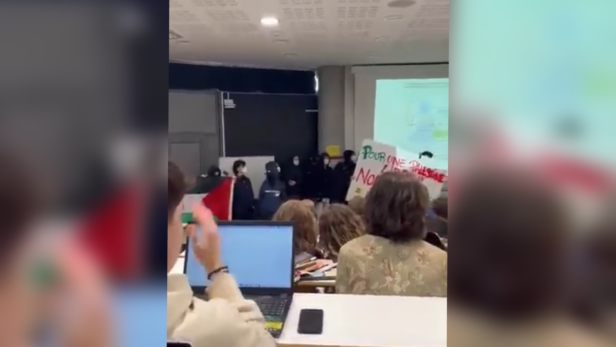








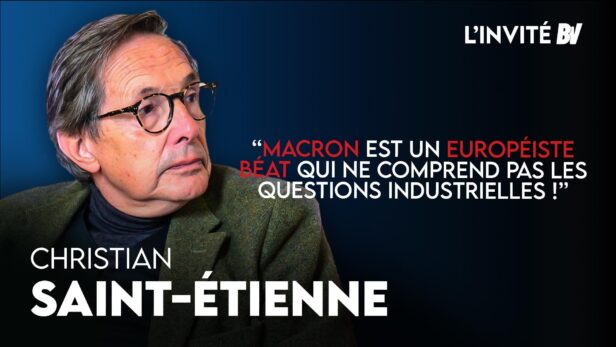





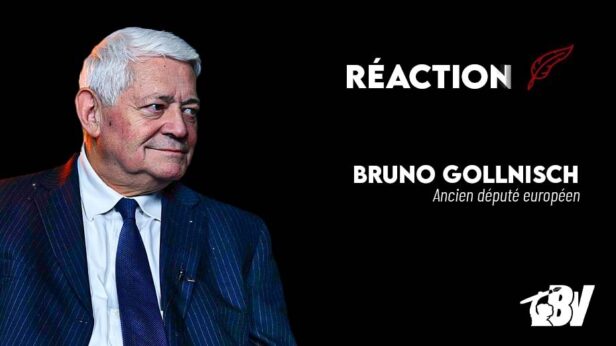











BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :