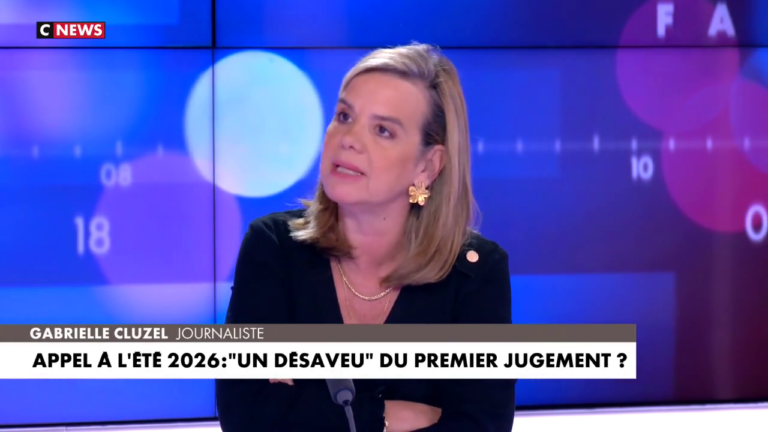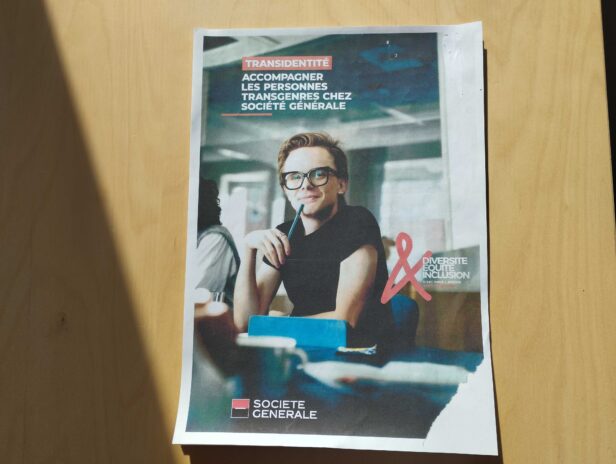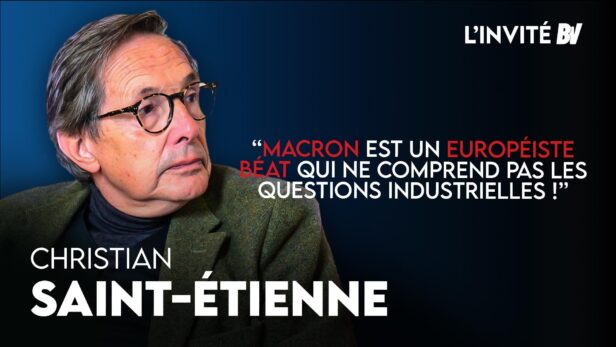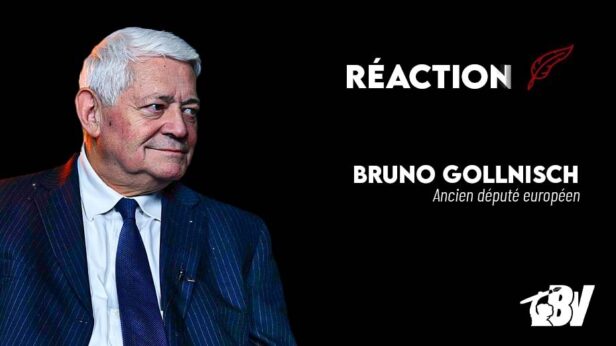Quand les cinémas chinois fêtent les cent ans du Parti communiste

Wang Xiaohui, directeur de l'Administration nationale du cinéma et haut fonctionnaire du Département de la propagande en Chine, organise en ce moment la célébration des cent ans du Parti communiste chinois (PCC) prévue pour le mois de juillet.
Concrètement, l’idée est d’œuvrer à ce que l’ensemble des cinémas du territoire programment au moins deux films « exceptionnels » par semaine, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Des films « étroitement orientées vers les louanges du Parti, de la patrie, de son peuple et de ses héros ». Les exploitants devront ainsi faire leur choix parmi une liste de douze longs-métrages produits entre 1952 et 2020, dont huit à caractère historique. De quoi terrifier bon nombre de journalistes occidentaux qui y voient complaisamment – et non sans quelque raison – la vision dangereusement utilitaire du cinéma promue en 1942 à Yan’an par Mao Tsé-toung …
Plutôt que de condamner la chose de façon péremptoire, demandons-nous un instant pourquoi le gouvernement chinois éprouve ce besoin aujourd’hui.
Depuis le programme de réformes modernisatrices de Teng Hsiao-ping en 1978, la Chine s’est peu à peu libéralisée sous l’influence de Taïwan – fraîchement démocratisée après la disparition du Kuomintang – et de sa diaspora hongkongaise et américaine.
En 1984, déjà, une grande conférence sur l'industrie cinématographique chinoise avait estimé que des centaines de films tournés dans les années 50 et 60 avaient été dénoncés et censurés à tort pendant la révolution culturelle. Une autocritique salutaire qui entraîna l’émergence du cinéma de « la cinquième génération », une sorte d’équivalent chinois de notre Nouvelle Vague. Porté, notamment, par Chen Kaige, Zhang Junzhao, Tian Zhuangzhuang, ou Zhang Yimou, ce mouvement se caractérisa par un refus de toute propagande, voire par une dépolitisation totale. Ces jeunes cinéastes, souvent formés en Occident, délaissaient volontiers le collectif pour s’attacher aux tourments de l’individu en conflit avec la société (Un et huit, Le Voleur de chevaux, Terre jaune ou encore Le Sorgho rouge).
Ce « cinéma de la cinquième génération », en vérité, fut un échec commercial retentissant, la non-adhésion du public chinois étant proportionnelle au succès (politique ?) que les films rencontrèrent dans les festivals internationaux « boboïsés ». La presse reprocha alors à ces jeunes cinéastes de tourner le dos aux traditions nationales pour imiter l’étranger et se hisser en tête du box-office mondial. Il faut dire que Chen Kaige leur prêta le flanc : « Si on est dans une situation arriérée par rapport à d'autres pays du monde, est-ce que ce n'est pas en rapport direct avec notre culture et notre civilisation ? Donc, je ne me sens pas tout à fait fier de cette culture. »
Peu à peu, les cinéastes devinrent plus virulents. L'Affaire du canon noir (1986) s’afficha ouvertement antibureaucratique mais put être exploité en salles sans difficulté. Le Bourg de l'hibiscus (1987), de Xie Jin, abordait, lui, les séquelles de la révolution culturelle, tout comme La Légende du mont Tanyun. Même Tchang Kaï-chek fut réhabilité dans La Bataille de Taierzhuang.
D’autres thématiques progressistes apparurent sur les écrans : la critique des mariages arrangés, la délinquance des jeunes des grandes villes, les abus de pouvoir de la police (Ronde de flics à Pékin), le commérage et la pression sociale, les mères célibataires, le divorce, le sexe, la nudité, l’homosexualité (Adieu ma concubine)…
Cette occidentalisation fut le fait caractéristique des cinquième et sixième générations. Une tendance accentuée grandement par la démocratisation, dans les années 80, de la télévision dans les foyers, de la vidéo, de l’antenne parabolique (qui permettait de capter aussi bien la BBC que CNN). Le cinéma américain, enfin, pénétra le marché chinois, tandis que les Hongkongais investirent massivement dans la construction de salles en Chine continentale en vue d’y exporter leurs films.
On se souvient alors de Zhao Ziyang, ancien secrétaire général du PCC, déplorant à l’époque « l'action corruptrice des idées décadentes de la bourgeoisie » et sa « pollution culturelle ». Quoi de moins surprenant que de voir les dirigeants actuels tenter de sauver les meubles en promouvant des œuvres historiques et, plus largement, le cinéma populaire, seul à avoir trouvé son public et, donc, sa légitimité.
Thématiques :
ChinePour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR