Retour en grâce des fanfares de villages : la tradition a encore de l’avenir !

Nos fanfares semblent avoir le vent en poupe ; logique, pour des instruments à vent. Ainsi, Rachida Dati, ministre de la Culture, vient-elle, ce jeudi 13 mars, d’annoncer « l’élargissement du plan fanfare » à grands coups de flonflons. Il est vrai qu’entre-temps, le succès inattendu du film En fanfare, d’Emmanuel Courcol, est passé par là. Ne jamais regarder les trains passer sans y monter, tel est le destin des vaches et des ministres de la Culture.
La pétulante locataire de la rue de Valois sera-t-elle entendue ? Nul ne le sait. Pourtant, il y a dix ans déjà, The Conversation, site à vocation universitaire, s’interrogeait sur la renaissance de ces fanfares, longtemps synonymes de la France d’en bas. D’où les déclarations d’un certain « Guillaume », chef de file d’une fanfare au nom charmant, Mouettes et Charbons : « Nous, on préfère ne rien demander à personne. C’est pour faire de la musique, pour en faire profiter le public, pour passer un bon moment, pour aller boire un coup après. On pourrait demander des subventions. Mais nous, on ne le fait pas, parce que sinon, on est redevable. »
Une musique par essence conviviale
On ne saurait mieux dire. Et le même de poursuivre : « Il y a un côté extrêmement paisible, dans cette musique. C’est le peuple rassemblé, une fanfare qui défile, les gosses suivent, les gens sont là tout autour, on les regarde et on n’a pas envie de se taper dessus. » Bref, la fanfare serait une musique plus apte à adoucir les mœurs que le rap. Et le même site d’évoquer une « réappropriation culturelle » longtemps passée sous les radars des musicologues distingués de Libération ou de Télérama. Voilà qui n’est pas faux et qui mérite une menue parenthèse historique.
Traditionnellement, une fanfare, ce sont des tambours et des cuivres. Soit une ancestrale habitude remontant aux armées des temps jadis, celle des légions romaines, par exemple. Pourquoi des cuivres et des tambours ? Tout simplement parce que c’est facile à transporter (plus qu’une harpe ou un piano à queue, notons-le) et que cela fait du bruit. Ou, plutôt, un boucan infernal destiné à terroriser l’ennemi. Les guerriers africains le savaient déjà, dont les entêtantes percussions semaient l’effroi dans le camp d’en face.
Les cuivres ? Au contraire des saxophones et autres trompettes et buccins, ils n’ont pas de touches. Il faut tout jouer à la bouche, à condition d’avoir de l’oreille, ce qui permet d’avoir une main de libre pour tenir les rênes du cheval. Les tambours ? Une grosse caisse, celle qui fait le plus de vacarme, suffira ; les charlestons et les cymbales, ce sera pour plus tard. Pour cela, le jazz et la java seront là.
Les Ottomans, premiers de la classe et de l’orchestre
Toujours dans le même registre, on notera que les premières fanfares militaires contemporaines sont turques, tel que rappelé par le site Chroniques ottomanes : « Le mehter takımı, sous l’Empire ottoman, représentait la fanfare militaire qui accompagnait les troupes lors des marches de conquêtes. Cet orchestre militaire passe pour être le plus ancien de la musique militaire, il aurait même inspiré les armées européennes, qui n’avaient jamais rien vu de tel. »
Il est vrai qu’à l’écoute et dans le registre viril et oriental, nous sommes loin de Bilal Hassani à l’Eurovision. La fanfare, avant de devenir musique civile, participait aussi de l’arsenal militaire. C’est aujourd’hui toujours vrai. La preuve par la prison de Guantánamo, sise à Cuba : au bout de quelques jours d’écoute intensive de Rihanna ou de Céline Dion, le chef d’état-major d’Al Qaïda avouera qu’il est rabbin, danseuse étoile ou correspondant de la CIA.
Nos fanfares villageoises, malgré leurs origines militaires, fussent-elle venues de la Sublime Porte, ce, dès le XIXe siècle, participent d’une approche plus pacifique du clairon. Leur heure de gloire ? Peut-être l’arrivée en fanfare de Glen Miller dans les fourgons de l’armée américaine, en 1944, avec son tube immortel, In the Mood.
Une tradition qui perdure
Dans la foulée, il y eut aussi les majorettes, autre importation folklorique d’outre-Atlantique. Nonobstant, la fanfare à la française a toujours tenu ses positions. Certes, on n’y jouait pas forcément en virtuose et les fausses notes y furent – et continuent à demeurer – légion, alors qu’elles sont censées y être étrangères. Peu importe : seul compte cet enthousiasme qui, même parfois maladroit, demeure communicatif. Cela s’appelle la communion, celle liant les artistes d’un jour au public d’un soir. Certes, nos fanfares ont changé, depuis. Entre celles des retraités de nos campagnes, alternant entre ritournelles d’hier, et celles autrement plus jeunes et versées dans une forme de jazz urbain, il y a forcément plus qu’un pas. Il n’empêche que le même chemin demeure, du costume dominical en Tergal™ au saroual.
C’est déjà ça. Ce n’est pas rien. Et ça donne, quoi qu’il en soit, une assez bonne raison de fanfaronner.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR










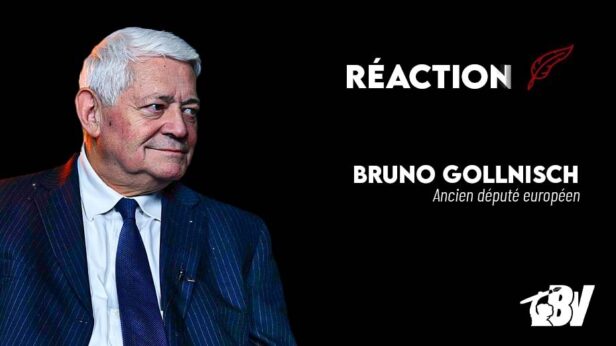
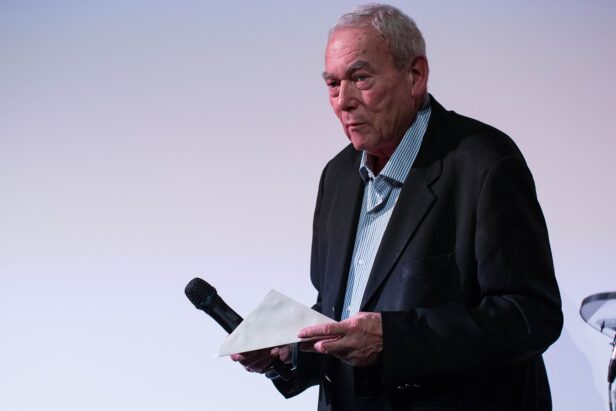









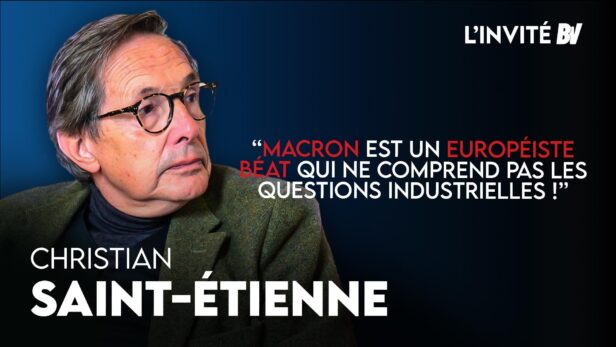

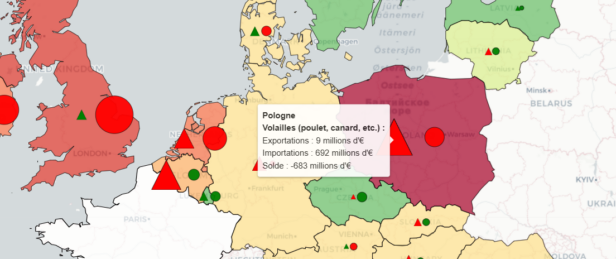













15 commentaires
Fanfares, cercles celtiques, bandas du Sud-Ouest, majorettes, repas gastronomiques en plein air autour du plat régional… Les médias n’en parlent pas – trop ringard dans les salons des métropoles – mais ces traditions existent bel et bien. L’été va les voir de nouveau fleurir dans les communes.
Merci d’en parler dans votre article.
Pour avoir participer à une fête du village natal de mon épouse en Bresse, j ai été heureusement surpris du nombre de jeunes qui participaient à l orchestre de la fanfare du village
Idem pour moi dans les Vosges ( NB: avoir participé)
J’apprends toujours plein de choses en vous lisant monsieur Gauthier. Soyez en remercié. Vive les fanfares et le retour de la musique populaire garante de nos traditions.
Magnifique musée des musiques populaires à Montluçon. Un salle magnifique consacrée aux fanfares. N’hésitez pas à faire le détour. MOP….
Changez de musique pour les jeunes des cités que l’ on abrutit actuellement , et vous changerez favorablement la société .Mais , pour cela , il faudrait limiter les pouvoirs injustes de la SACEM .
C’est grâce aux traditions bien ancrées dans nos villages qu’on sauvera la France. Haro sur tous ceux qui essaient de déconstruire notre âme, pour vouloir y insérer une autre culture.
Sauf que la majorité des fanfares étaient du monde catho comme les kermesses et autres dispensaires, tout ce que la République et les gauchos débiles ont détruit.
Oui
J’adore les fanfares. C’est toujours un immense plaisir de les regarder défiler, bravo à tout ces musiciens, et vive les traditions Françaises.
Sauf quand on est assise sur une estrade en bois (triomphe de St Cyr – Coet), enceinte jusqu’aux yeux pour voir le futur papa, et que la belle-famille croit intelligent de scander la mesure (si tant est qu’ils aient quelqque notions musicales !) en tambourinant des pieds de toutes leurs forces : bonjour, doux bébé !
Excellent texte !
Oui privilégié j’habite une partie de l’année dans un village du sud ou les traditions sont vivaces,entretenues par les jeunes qui sont fiers de porter des costumes traditionnels et dansent lors des fêtes..la France n’est pas morte,il faut la faire vivre à travers ses traditions régionales en être fier ..quant on ne se laisse pas emm…par la doxa et aime son patrimoine..l’envahisseur ne passe pas…
Chez nous dans le sud-ouest les bandas n’ont jamais perdu leur souffle. Elles accompagnent les fêtes votives bien sûr, les courses de vaches, les mariages et même parfois les enterrements.
Elles sont partie intégrante de notre identité au même titre que la corrida, le rugby et la chasse à la palombe .
Effectivement et il devrait en être de même pour les accordéonistes et les chants grégoriens.