Soutien de l’Église aux migrants : ces catholiques qui hésitent à donner

Un détail qui n’est pas passé inaperçu. En début de semaine, BV s’intéressait à une étude, menée par le think tank Destin commun, sur la répartition des migrants dans les campagnes. Financé en partie par l’Open Society Foundations du milliardaire George Soros, Destin commun affiche fièrement sur son site ses nombreux partenaires, parmi lesquels figure la Conférence des évêques de France, organe de représentation de l’Église catholique en France, qui réunit l’ensemble des évêques du pays. Compte tenu de l’orientation progressiste du think tank, ce partenariat n’a pas manqué de susciter l’indignation de nombreux lecteurs et fidèles qui dénoncent une Église « complice » de l’immigration de masse. Sur les réseaux sociaux, certains vont même jusqu’à annoncer ne plus vouloir contribuer par leurs dons aux actions pastorales de l’Église.
Une Église au service des migrants
La Conférence des évêques de France a en effet collaboré par deux fois avec Destin commun. La première fois, en juin 2018, dans le cadre de la publication d’une étude sur les « perceptions et attitudes des catholiques de France vis-à-vis des migrants », la conférence épiscopale a pu bénéficier des travaux menés par le think tank. Deux ans plus tard, les évêques français ont réitéré leur partenariat afin de « promouvoir le changement de regard des catholiques français vis-à-vis de l’immigration ». Cette collaboration, dont l’objectif était de « remédier aux sentiments d’hostilité grandissants au sein de la communauté des catholiques de France », a donné naissance à un guide et à des dizaines de formations. « C’est grâce aux plus hautes instances de l’Église, notamment la Conférence des évêques de France, que ce projet a pu voir le jour », rappelle, ainsi, Destin commun, au cœur de son étude.
Outre ces études d’opinions, l’Église s’engage également sur le terrain dans l’accueil des « exilés ». Depuis septembre 2021, le diocèse de Paris soutient ainsi financièrement (300.000 euros de subvention d'exploitation en 2022), la Maison Bakhita, qui œuvre à accompagner et soutenir les personnes migrantes. Plusieurs paroisses de la capitale ont par ailleurs, les années précédentes, collaboré avec l’association Utopia 56, association connue pour son engagement politique en faveur de l’immigration de masse, en offrant des hébergements à des migrants sans domicile. À Nantes, également, le diocèse a pendent un temps offert un toit à plusieurs familles migrantes. Et le diocèse de Lille a, lui aussi, signé une convention avec Utopia 56. Cette générosité - ou charité chrétienne, diront certains - répond à l’appel du pape François qui demandait, en 2015, que « chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe accueille une famille de réfugiés ». Un appel qui se retrouve aujourd’hui financé directement ou indirectement par les dons des fidèles, dont le denier de l’Église, et qui ne semble pas du goût de tout le monde.
À ce sujet — Financé par Soros, un think tank soutient la répartition des migrants dans les campagnes
Un denier fragilisé
En effet, certains catholiques pratiquants, rencontrés par BV, à l’instar des fidèles outrés par la collaboration entre la Conférence des évêques de France et Destin commun, confient avoir renoncé ou refusé de verser leur participation au denier de l’Église. Si le denier de l’Église, contribution financière essentielle au fonctionnement de l’Église qui ne vit que de dons, sert en priorité à subvenir aux besoins de prêtres, payer les salaires des laïcs employés par les diocèses et entretenir les églises et autres bâtiments à usage pastoral (chauffage, travaux…), une part bien moins importante sert également au développement des actions pastorales de l’Église (formation, catéchèse, action sociale), dont l’aide aux migrants. « Je ne donne plus au denier de l’Église parce que je ne suis pas d’accord avec la gestion qu’en font les évêques, nous confie ainsi une mère de famille, engagée dans sa paroisse à Paris. Je veux soutenir les causes en accord avec mes convictions, donc je préfère donner à des communautés ou instituts qui ont tout autant besoin de cette aide financière. » Un sentiment partagé par Éric, jeune actif : « Je ne donne pas au denier parce que je préfèrerais savoir très précisément où va mon argent. Je ne veux pas que mes dons servent à financer des projets qui ne correspondent à mes valeurs car je sais que certains évêques, notamment dans mon diocèse, ont une vision très progressiste que je ne partage pas. » Et une autre jeune cadre d’ajouter : « Je considère que je fais partie de l’Église, donc je me sens obligée de donner. Je donne donc un peu à un diocèse rural qui en a sûrement besoin. Mais je donne dix fois plus à deux communautés pour la formation de leurs prêtres et pour les travaux de reconstruction d’une abbaye. » Cette jeunesse catholique, plus encline au traditionalisme et plus conservatrice, ne se retrouve donc pas toujours forcément dans la tournure prise par l'Église.
Cette méfiance peut être une des causes d’explication de la fragilité du budget de l’Église. Car si le budget global de l’Église se maintient (+2 % en 2022), le denier, quant à lui, connaît une légère baisse (-5 %). Mais plus inquiétant, le nombre de donateurs continue de diminuer. « Dans ma paroisse, les jeunes ne donnaient pas. La moyenne d’âge des donateurs se situait aux alentours de 60-70 ans », nous rapporte François*, un ancien membre du conseil paroissial pour les affaires économiques d’une ville bourgeoise de l’Ouest parisien. Si certains choix pastoraux ou idéologiques de l’Église peuvent expliquer ce désamour des nouvelles générations pour le denier, pour François, la cause principale reste la « non-transmission de la culture du don ». « À cela s’ajoute une baisse de la pratique religieuse, les églises se vident et, donc, inévitablement, les dons reculent et sûrement un manque de communication sur le sens du denier », complète-t-il. Toujours est-il que si la contribution au denier baisse, les dons pour des actions spécifiques (à savoir constructions d’églises, JMJ…), quant à eux, augmentent. Preuve, donc, que les fidèles sont soucieux de voir leur argent bien utilisé.
*Le prénom à été modifié
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
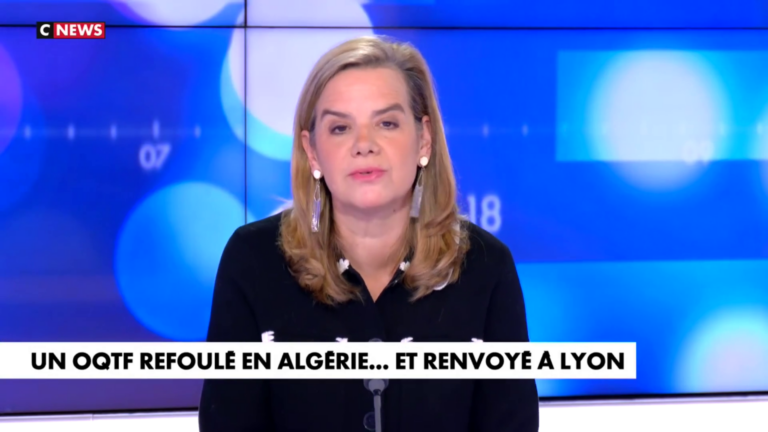




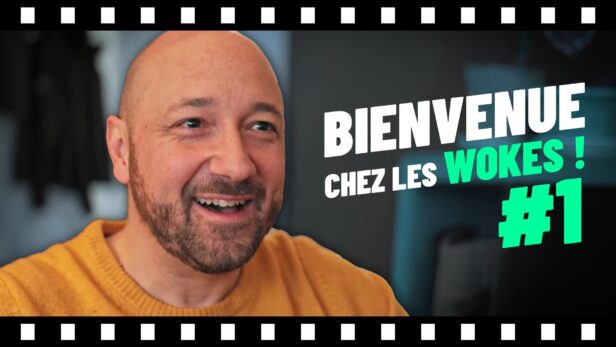













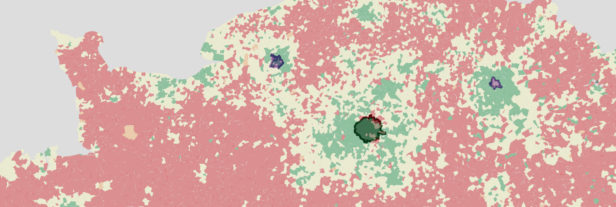

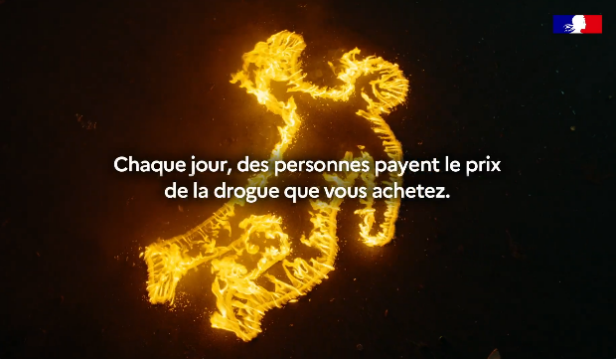


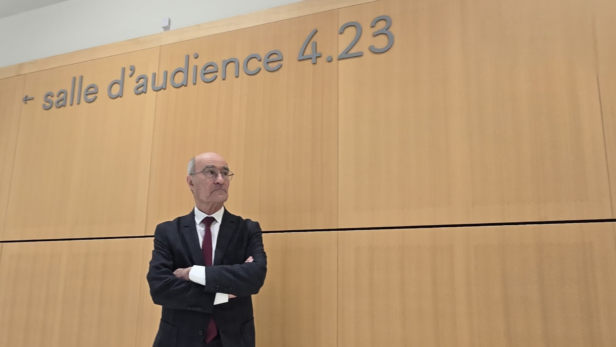
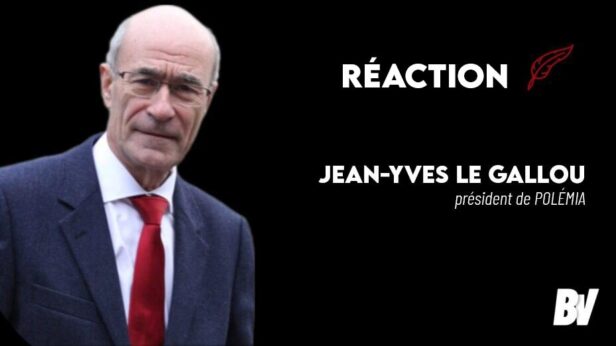

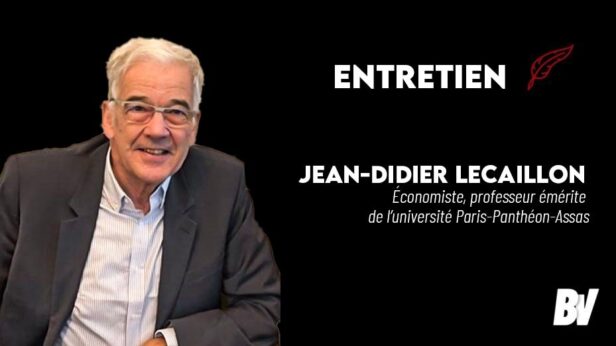
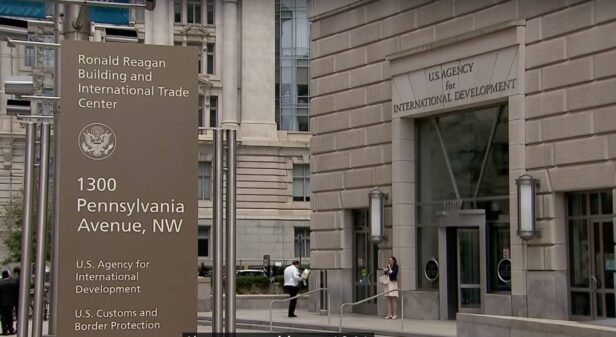




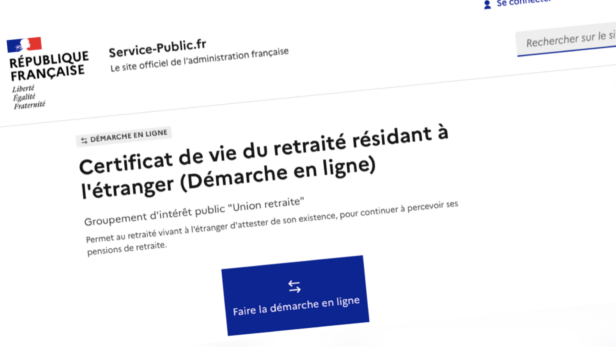


57 commentaires
L’église est en train scier la branche sur laquelle elle est assise. Moins de fidèles, des dons en baisse, elle chassent les fideles de ses églises, Pense-t-elle les remplacer par les tenants d’Allah ? bientôt les évêques à Pole Emploi ?
je ne donne plus au « deniers du culte » depuis de nombreuses années, en fait depuis que j’ai vu le nouveau pape, laver les pieds des clandestins le jeudi saint et sa complaisance envers l’islam.
En revanche, je soutiens les chrétiens d’orient que le « bon » pape François ignore de manière flagrante.
Vous avez parfaitement raison…
Il suffit d’ecouter ou de lire le cardinal Sarah pour être lucide.
Je veux bien, la charité et tout ça. Mais, l’église doit bien se rendre compte que ce qu’ils font consiste à introduire le loup dans la bergerie? L’église souhaite aider les musulmans à envahir la France et répandre leur religion délétère? Car, combien de musulmans embrassent la religion catholique? combien adhèrent aux valeurs de la France? Non, ils sont devenus fous.
Cela rappelle les heures grises de la fuite des Nazis en Amérique du Sud avec l’ aide du Vatican. Là c’ est l’inverse. Il y a suffisamment de place dans ce petit état immensément riche pour accueillir les migrants . Le pape pourrait le dimanche leur distribuer des images pieuses.
L’église catholique c’est comme la macronie, un désastre pour notre civilisation. Ce pape n’a de pape que le nom. Je suis catholique, mais traditionaliste et royaliste de surcroît.
Je ne donne plus à une eglise collabo mais je donne directement à une categorie de migrants à laquelle tout Français devrait se sentir redevable :les harkis, leurs descendants et leur famille
Il suffit de voir dans les campagnes les nouveaux prêtés qui sont nommés….
Traditionaliste pur et dur , la position des évêques de France n’a rien d’étonnant puisqu’ils ont oublié leur mission première, porter l’Evangile et convertire.
Le Pape précédent a eu le courage de laisser sa place quand il ne se sentait plus en mesure de garantir l’église, celui d’aujourd’hui est comme Macron il va s’incruster jusqu’au bout pour détruire notre société.
Seul 1% des hébergés dans les centres d’urgence d’Emmaüs sont français (Chiffres de 2017 )
Toutefois, les chiffres donnés dans le rapport d’activité de l’année 2017 par Emmaüs Solidarité donnent une photographie assez claire et inquiétante de l’état présent de notre pays. Ainsi, parmi les 22.355 personnes suivies en 2017 par Emmaüs dans le cadre de l’accompagnement social des 60 structures d’hébergement et de logements adaptés, seules 3 % d’entre elles étaient de nationalité française et 2 % ressortissantes d’Etats-membres de l’Union européenne. Ce qui signifie donc que 95 % des personnes accompagnées venaient de pays non membres de l’Union européenne ! On compte d’ailleurs 95 % de célibataires et une très large majorité d’hommes (19.397, soit 86,76 % des effectifs).
La tendance est encore plus marquée pour ce qui concerne les personnes hébergées dans les 18 centres d’urgence présents en France, puisque ces dernières se recrutent à 98 % dans des pays non membres de l’Union européenne ! Même les centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont concernés par le phénomène, alors que leur mission diffère très largement, accueillent 66 % de personnes issues de pays hors de l’Union européenne. C’est proprement colossal. À savoir qu’un Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale est un établissement accueillant des personnes stabilisées pendant une durée de deux ans en moyenne où elles seront prises en charge par des équipes sociales correspondant en moyenne à un travailleur social pour 12 hébergés contre 25 en Urgence.
Je fuis ce clergé proimmigrationiste
Combien de migrants le pape loge t’il dans son palace ? Je lui rappelle que les français paient suffisamment pour ces migrants . Non seulement par l’impôts et les taxes mais également en vie humaine dont la liste s’allonge . De plus nous sommes de plus en plus taxé pour les soins quand les migrants ont tout gratuit et le nombre de français laborieux qui peine à finir le mois s’allonge de jour en jour .
Entièrement d’accord avec vous !
Tout est parfaitement résumé
ce n’est pas pour rien que l’évêque de Lille a été nommé à Paris !
« Changer le regard des catholiques français vis-à-vis de l’immigration » ? Il faudrait commencer par changer le regard des migrants vis-à-vis de la France, des Français, des Chrétiens, des Juifs et des femmes et la quasi-totalité du problème serait réglé. Si les chrétiens pensent que l’Église fait un mauvais usage du denier du culte, ils ont bien raison de s’abstenir. Si l’Église est incapable de comprendre le message, tant pis pour elle, le Christ était pauvre, elle n’a qu’à faire de même.
BRAVO!
Je suis d’accord avec vous !