[TÉMOIGNAGE] Anniversaire de l’attentat du Drakkar : un témoin raconte

En ce 23 octobre, jour anniversaire de l'attentat du Drakkar au Liban où 58 soldats français ont perdu la vie, BV a interrogé M.P*, engagé sur place, qui témoigne de ce qu'il a vécu. À l'époque, le Liban était ravagé par la guerre civile et les soldats de l'armée française envoyés pour « ramener la paix ».
Sabine de Villeroché. Quelles circonstances vous ont amené à être présent au Liban, ce 23 octobre 1983, jour de l’attentat du Drakkar qui provoqua la mort de 58 soldats français ?
M. P. Avec ma compagnie, nous faisions partie de ce qui se nommait alors la FMSB (Force multinationale de sécurité à Beyrouth). À distinguer de l’ONU. C’était une particularité, car depuis 1978, la France servait au sein de la FINUL (dont on parle, aujourd’hui, à la frontière israélienne au Sud-Liban, les fameux Casques bleus). Nous étions sous béret rouge, nos bérets d’origine. Avec le 17e régiment du génie parachutiste (17e RGP), nous étions partis pour la mission appelée Diodon 4, comme d'autres régiments parachutistes ; positionnés sur la ligne verte transverse qui divisait Beyrouth en deux, en proie aux bombardements toutes les nuits. Les Américains, pour leur part, étaient à l’aéroport et les Italiens aux portes de la ville.
À l’époque, dans mon souvenir, nous n’entendions pas parler du Hezbollah mais plutôt des Amal, qui étaient face aux chrétiens. J’ai connu le nom du Hezbollah plus tard.
[Le Hezbollah (qui signifie « Parti de Dieu » ) a été créé, en réalité, en 1982 au Liban à l’initiative de l’Iran, soit un an avant l’attentat du Drakkar, NDLR]
Nous étions là pour faire notre « mission génie » de dépollution (déminage) et de merlonage, c’est-à-dire de fabrication de buttes de terre positionnées en travers des rues pour empêcher les trajectoires de voitures piégées. Nous devions essayer de maintenir la paix.
Le dimanche 23 octobre (c'était un dimanche matin), je me trouvais sur la terrasse de notre position avec le transmetteur. Tous les jours, un ou deux obus étaient envoyés sur une de nos positions, ces obus venaient de Syrie. Nous étions habitués au bruit et à la fumée qu’ils produisaient. Mais à 6 heures du matin ce jour-là, nous avons entendu un énorme bruit qui nous paraissait particulièrement plus important que d’habitude. Nous nous sommes rendu compte que ça venait de l’aéroport.
[Quelques minutes avant l’attaque du Drakkar, un attentat suicide frappait le quartier général des Marines américains, faisant 241 morts, NDLR].
Puis, à 6h20, nous avons entendu une deuxième explosion, cette fois à un kilomètre de chez nous et, par la radio, nous avons appris qu’il s’agissait du Drakkar. À partir de là, le capitaine qui commandait la compagnie nous a demandé de rassembler les hommes, préparer les engins, les chaînes, les câbles, tout le matériel, et de nous porter sur les lieux au plus vite. Un gros quart d'heure après, nous étions sur les lieux, prêts à intervenir. On était en état de guerre permanent, c’était un séjour difficile ; depuis le début, nous avions pas mal de blessés au niveau du contingent français.
Arrivés sur place, le Croissant libanais, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge française, avait déjà sorti un ou deux survivants ; ils avaient du métier face à ce genre de sinistre. Le bâtiment est tombé en tournant sur lui-même, comme une sorte de mille-feuille. Le Croissant libanais ayant plus l'intelligence de ces pratiques (nous n’étions pas formés au sauvetage-déblaiement), ils ont attaqué par l’arrière et le dessous du bâtiment et par les endroits où il fallait. Ils ont donc sorti les premières victimes. Nous avons ensuite commencé à fouiller avec nos mains, avec nos pelles, avec nos pioches, marteaux piqueurs, avec ce que l’on avait, mais nous n’étions pas outillés pour soulever des dalles de béton de 30 tonnes. Nous avons fait ce que nous pouvions, sauvant les premiers survivants - quatre ou cinq, de mémoire. Ma section a sorti l'une des victimes qui était bloquée sous les décombres par un fer en béton planté dans sa cuisse. Il a fallu couper ce fer à béton à l’aide d’une scie à métaux pour le sortir de là.
Le lendemain ou le surlendemain, les maîtres-chiens de la Sécurité civile venus de France en renfort ont fouillé à leur tour les décombres. Nous faisions silence pour repérer les blessés dans le bâtiment. Pendant deux jours, nous avons entendu crier les survivants… J’en ai encore des frissons. Le dernier a été sorti le mercredi.
Avec les grues qui sont arrivées plus tard, nous pouvions passer des chaînes pour soulever les dalles de béton et sortir les corps de nos camarades. Nous avons terminé d’évacuer les corps de nos frères d’armes le jeudi midi. Entre-temps, Mitterrand est venu sur place avec le ministre de la Défense. Les victimes étaient dans leur grande majorité des appelés, mis à part les officiers et sous-officiers.
S. d. V. Quels sont les souvenirs qui vous ont le plus marqué ?
M. P. Lorsque le bâtiment a été entièrement évacué, il restait un cône d'environ 7 à 9 mètres de profondeur. Dans mon souvenir, la dernière personne que nous en avons sortie était la femme du concierge du bâtiment, son mari était parti faire des courses, elle tenait encore son bébé dans les bras. Nous avions déjà évacué les 58 corps de nos camarades à la Résidence des Pins, à l’état-major de la force française.
S. d. V. Quel peut être l’état psychologique de ceux qui ont assisté à un tel drame ?
M. P. Nous sommes tous rentrés très fatigués et atteints moralement. Mais pas seulement à cause de nos 58 morts : au mois de décembre, nous avons subi un second attentat causé par un camion piégé qui a explosé à quelques centaines de mètres de notre position. C’était le 3e RPIMa qui était visé. L’onde de choc est arrivée chez nous au point que les fenêtres de notre bâtiment ont alors volé en éclats. Il y a eu beaucoup de morts individuels, pendant ce séjour. C’était vraiment dur. Et puis ces cris des gars restés sous les décombres du Drakkar restent gravés dans ma mémoire.
S. d. V. Avez-vous gardé des contacts avec les survivants ?
M. P. J’ai encore des contacts avec eux. Certains d’entre eux vont bien. Mais d’autres ne s’en sont jamais remis. À l’époque, l’armée ne reconnaissait pas le stress post-traumatique. Le militaire touché par ce syndrome devait, à l’époque, le gérer seul, ce qui pouvait entraîner de vrais problèmes dans sa vie privée ou familiale.
[Le stress post-traumatique n’a réellement été pris en compte, officiellement, par l’armée qu’en 2013, NDLR.]
S. d. V. Qu’ont signifié, pour vous, les récentes éliminations des chefs du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Fouad Chokr, considérés comme commanditaires de l’attentat du Drakkar ?
M. P. Juste une remarque concernant les chefs du Hezbollah : quel âge avaient ces deux hommes lors de l’attentat du Drakkar ? Maintenant, si ces deux hommes sont les commanditaires de cet attentat, merci à Tsahal.
[Hassan Nasrallah est né le 31 août 1960, il avait donc 23 ans en 1983. Si on en croit sa notice Wikipédia, il a accédé au commandement du Hezbollah en 1992. Fouad Chokr, né le 15 avril 1961, était âgé de 22 ans lors de l’attentat du Drakkar. Il aurait été une des principales figures du Hezbollah dès sa création dans les années 80 (notice Wikipédia), NDLR.]
Le Drakkar devait être vengé, donc, plus tard, lorsque des Étendard ont décollé d’un porte-avions pour bombarder un camp terroriste, camp en réalité évacué avant l’attaque. Au bilan, ils ont tué trois chèvres et leur gardien. Tout le monde était parti, car prévenu à l’avance.
[La riposte officielle de la France se limitera au bombardement aérien, le 17 novembre 1983, d'une caserne occupée à Baalbek, dans la plaine de la Bekaa, par les gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah, NDLR.]
Le Liban, ça a toujours été compliqué. C’est un pays qui est en grand danger, pris en étau entre la Syrie, qui veut l’annexer pour avoir un accès à la mer, et Israël. Plus tard, en 1986, lors d’un autre de mes séjours au sein de la FINUL, un soldat de ma compagnie a été victime d’une roadside bomb alors que nous faisions un footing autour de notre position. Un attentat qui aurait pu être évité, car certains Libanais étaient informés de ce qui nous attendait.
En principe, les Casques bleus sont là pour ramener la paix. La mission est particulièrement difficile à réaliser, on le voit encore aujourd’hui. On n’a jamais eu le droit de tirer pour se défendre, nous descendions dans les abris lorsque les tirs étaient trop proches. Il est vrai que la mission de l’ONU est de maintenir la paix…..
En cette veille de commémoration de l’attentat du Drakkar, une pensée pour nos frères d’armes. Que saint Michel veille sur eux !
*M. P est un pseudonyme
Thématiques :
DrakkarPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR



























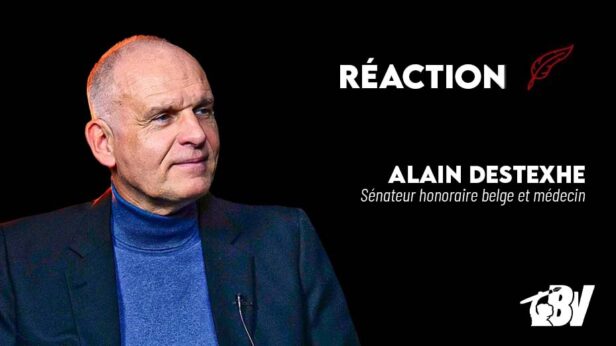










24 commentaires
Le responsable des ces deux attentats n’est pas le Hezbollah dont personne ne connaissait l’existance à cette époque, mais a été revendiqué par le Jihad Islamique ,il n’y a qu’a consulter les documents de l’époque .Le Hezbollah a été créé dans le but de faire face à l’occupation d’Israël au Sud Liban .
J’étais au 1er RCP à cette époque et je devais partir avec la compagnie du Capitaine THOMAS. Je ne suis pas parti car ma femme ne voulait pas. J’ai même invité le Capitaine THOMAS à déjeuner chez moi pour qu’il comprenne…
Merci à Israël d’avoir vengé mes camarades.
J’espère que les Israéliens, vont mettre une bonne raclée au Hezbollah, puisque américains et français, avons été trop lâches pour le faire.
« Tout le monde était parti, car prévenu à l’avance. » Non seulement lâches mais surtout complices ? Car seuls les officiers du Clemenceau et le gouvernement auraient été au courant de l’opération. Le ministre des Affaires étrangères Claude Cheysson aurait été furieusement opposé à toute riposte militaire. Il suffit donc d’ajouter deux et deux pour retrouver les mêmes trahisons de gauche, banales depuis la guerre d’Algérie. Est-ce que 58 morts l’ont empêché de dormir? Pas à ma connaisance.
Mémoire ; Honneur et respect pour nos 58 compagnons. Emmanuel MACRON a bien été silencieux pour nos bérets rouges. Merci Benjamin de les avoir vengé(s) !! Quand la politique est absente, il faut agir, et ne pas s’agenouiller comme le fait si bien la politique politicienne française !!