[TEMOIGNAGE] Une jeune fille sous les bombes, le 6 juin 1944 à Caen

Chers lecteurs,
Vous avez été nombreux à visionner notre documentaire « BV en Normandie, hommage aux victimes civiles » et à entendre (mais en partie, seulement) lecture du témoignage de Josette F., qui vivait à Caen lorsque les alliés ont débarqué, le 6 juin 1944. Un témoignage unique et exclusif que nous publions ici en intégralité en remerciant Bruno Leverrier, historien passionné interrogé dans le reportage, pour avoir recueilli et transcrit les paroles de Josette.
« Je suis née le 9 décembre 1927, rue de Bras à Caen dans la maison de mes grands-parents R*, à l’emplacement actuel de la FNAC. Mon grand-père, Raoul, était sellier à Caen où il avait ouvert une entreprise de carrossier. Il a vendu ses terrains et ateliers à la mairie de Caen, qui a construit à cet endroit la gare routière des Courriers normands inaugurée en 1938.
Mon père, Jean Marie F*, né le 23 octobre 1898 dans le Finistère chez son père qui était maréchal-ferrant à Saint-Yvi, était apprenti chez Raoul R*. C’est là qu’il a connu ma mère Yvonne, née en 1899, et l’a épousée. Il avait effectué son service militaire en 1919 au sein des troupes d’occupation en Allemagne. Son frère Fernand avait combattu dans l’armée blindée et revenait souvent, dans ses témoignages, sur le fait que lors d’une attaque, son char avait basculé dans un entonnoir et qu’il avait été recouvert par la terre des explosions d’obus alentour. L’équipage n’avait dû son salut qu’au fanion qui restait visible à la surface du terrain et qui avait permis leur exhumation.
Jean Marie, associé à son beau-frère André, a fondé la carrosserie R*-F* qui a acquis un terrain avec une maison, rue de Bayeux. Cette maison était située entre la propriété de la marquise de T., qui est devenue en 1932 l’institution Saint-Pierre, et la maison des de T., où j’ai connu leur fille Béatrice. Après quelques travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accès des véhicules, l’atelier a employé 3 tôliers, 2 forgerons, 2 peintres, 3 menuisiers et un sellier. Les châssis arrivaient nus et l’équipe d’ouvriers construisait les carrosseries. C’était un travail artisanal et nous ne faisions pas de mécanique. C’est dans ce quartier que j’ai passé mon enfance avec mon frère et ma sœur aînée, Arlette, née d’un premier mariage de ma mère avec Cirille D*.
Une jeune fille sous l'Occupation
J’allais à l’annexe de l’école normale de jeunes filles située au bas de la rue de Bayeux. Pendant l’Occupation, mes parents ont continué leur activité. Au début, les Allemands sont venus à l’atelier pour réaliser des maquettes d’avions en bois et toile tendue, qui servaient de leurres. Après que les Alliés eurent bombardé les aérodromes avec des bombes en bois, les commandes ont cessé. Nous avions un stock de matériau important qui nous avait permis de conserver la clientèle en effectuant du troc contre des denrées alimentaires. Mon père a réussi à continuer à faire usage de son automobile à essence. Il avait un Ausweiss et circulait même la nuit. Il nous a raconté qu’un jour, en rentrant de la côte avec un chargement de poissons destiné au ravitaillement, il avait été arrêté par un barrage allemand. Il a montré son laissez-passer et les sentinelles l’ont autorisé à continuer sa route et lui ont même fait le salut militaire. Il en riait, disant : « Ces boches ont salué mes maquereaux ! » Je ne sais pas s’il a participé à des actes de résistance, il me semble qu’il a évoqué une fois après la guerre, avec des personnes présentes au bureau, le fait d’avoir transporté des parachutistes qu’il a fait passer, à un barrage, pour des fous qu’il emmenait au Bon-Sauveur. Quand les Allemands ont voulu vérifier, les passagers ont essayé de sortir en hurlant et en gesticulant et les soldats, surpris, ont vite refermé les portes.
J’avais pour camarades de classe Yvette P*, la fille d’un gardien de la maison d’arrêt, et Claudine Indictor, qui a disparu sans explication pendant l’Occupation et dont j’ai pu lire, après la guerre, le nom de son père sur la plaque des déportés, située au coin de l’esplanade du lycée Malherbe. Nous avions comme professeur d’anglais M. Desbiot, qui fut lui aussi déporté et dont le nom figure sur cette même plaque. De plus, je suivais des cours du soir dans les sous-sols de la mairie, avec le professeur de dessin des beaux-arts, Robert Douin, et en plein milieu d’un cours, des policiers français sont entrés et l’ont emmené dans une pièce à proximité. Il est ensuite revenu nous dire : « Les enfants, rentrez chez vous et laissez les papiers. » Je ne sais pas si c’est précisément ce jour qu’il a été arrêté, mais il a été exécuté le 6 juin 1944 à la prison de Caen.
Les professeurs des beaux-arts nous avaient désigné des gardes du corps, Pierre L. et Michel H. pour ma part, afin de nous raccompagner après le couvre-feu. C’était devenu un jeu et nous allions chez les uns et les autres nous raccompagner mutuellement. Michel a eu un destin tragique. J’ai appris, par la suite, que son père était résistant, et c’est peut-être la raison pour laquelle il s’est engagé à 17 ans, dans les blindés de l’armée Leclerc après la libération de la ville. Il est revenu en permission en avril 1945 pour fêter sa médaille militaire et c’est lors d’une visite en groupe des plages du Débarquement, accompagné de son jeune frère Pierre, qu’il s’est noyé […].
Le 15 mai 1944, nous avons appris avec stupeur l’arrestation de Maurice [beau-frère de Josette F., NDLR] et Michel par la Gestapo. Leur frère Émile avait réussi à échapper à la capture, sa sœur l’ayant prévenu à temps. Arlette [sœur de Josette F., NDLR] a, une fois, tenté d’entrer rue des Jacobins pour obtenir des nouvelles. Le planton l’a refoulée dans la rue sans même lui demander son identité. Elle a pu récupérer des vêtements tachés de sang ainsi que quelques messages. Nous vivions tous dans l’espoir que la résistance tenterait de libérer ses frères d’armes. J’ai longtemps eu du ressentiment qu’aucune action n’ait été entreprise dans ce sens.
« Ça y est, c’est le Débarquement ! »
Le 5 juin dans la soirée, nous avions assisté, au théâtre de Caen, à la dernière représentation de Véronique, de Messager. En remontant la rue de Bayeux avec mes parents, nous avons aperçu des lueurs orange dans le soleil couchant accompagnées d’un grondement sourd. J’ai demandé à mon père si c’était l’orage et il a répondu : « Je voudrais bien. » Je suis allée me coucher et à l’aube, ma mère est entrée brusquement en criant : « Ça y est, c’est le Débarquement ! » Je me suis levée très excitée et je me suis mise à jouer la Marche turque au piano pour fêter l’événement. Ma mère a réfréné mes élans. Au même moment, nous avons subi le premier bombardement, vers 8 heures 30, et l’angoisse a commencé à monter d’un cran. Ma mère, qui s’inquiétait pour la famille de son autre fille, a décidé à la première accalmie de se rendre rive droite.
Nous avons réussi à franchir le chaos et les destructions et avons trouvé l’immeuble de ma sœur en ruines. Ma mère s’est mise à fouiller fébrilement les décombres à la recherche d’Arlette et de ses petits enfants. Voyant cela, une voisine est sortie pour nous prévenir que la famille au complet s’était heureusement enfuie à la première alerte pour se cacher dans les carrières de la brasserie S*. Rassurées, nous sommes rentrées par le même chemin et, à mi-parcours, nous avons cherché refuge dans un café encore ouvert. Nous étions couvertes de poussière et avions la gorge desséchée. La patronne hurlait de peur et de colère, mais elle a consenti à nous servir un verre d’eau. Au vu de la situation, nous sommes reparties rapidement, mais la cafetière nous a rattrapées dans la rue pour nous faire payer les consommations.
Le centre avait été durement touché, mais les environs immédiats de notre domicile avaient été relativement épargnés. Dans l’après-midi, un second bombardement a fait des victimes en haut de la rue de Bayeux, vers le passage à niveau, près de l’entrepôt de M. F*, un client de papa. Tout près de là, mon professeur de français, Mme P*, discutait avec une voisine sur le pas de sa porte quand les bombes sont tombées. Elle a soudain été projetée au fond du couloir et couverte de poussière, elle est revenue voir dans la rue mais Mme Legrain s’était volatilisée. Sa bicyclette pendait pitoyablement en haut de la barrière et la pauvre femme répétait : « Mais où est donc Mme Legrain… Mais où est donc Mme Legrain ? »
« Ils sont tous Français, maintenant que le vent a tourné ! »
Ces événements dramatiques ont décidé mon père à partir vers Noyers-Bocage, où un de ses clients, M. L*, vivait avec ses deux filles, dont l’aînée se prénommait Félicienne, dans une ferme en dehors du village. La grosse Renault commerciale qui pouvait contenir dix personnes fut rapidement chargée et nous prîmes la route en fin d’après-midi. La voiture était tellement pleine que je suivais en vélo avec mon cousin qui, dès que c’était nécessaire, me protégeait des mitraillages aériens en se couchant sur moi dans le fossé. Nous sommes restés dans cette ferme quelque temps en nous cachant des soldats qui venaient en permanence chercher du ravitaillement.
Mme L* m’a dit un jour : « Il y en a même un qui m’a dit qu’il était français et m’a montré un ruban tricolore cousu dans un revers de poche ! » Un autre réfugié a alors rétorqué : « Ils sont tous Français, maintenant que le vent a tourné ! »
Un matin, des chars allemands ont fait irruption dans la cour de la ferme. J’ai alors vu des soldats habillés en noir sauter d’un tank et menacer Mme L*, qui ne voulait pas leur donner de provisions. Ils ont pris les volailles et tout ce qui les intéressait, puis ils ont abattu les chiens. Mon père, sentant le danger de cette cohabitation forcée, a essayé une ou deux fois de nous faire passer les lignes vers le nord, mais cela s’est révélé impossible. Finalement, un après-midi, alors que nous revenions d’une vaine tentative dans la voiture chargée, il a décidé de rentrer chez nous. Cela s’est fait sans encombres, et arrivés rue de Bayeux, nous avons constaté que la maison était encore debout. Néanmoins, l’intérieur était vandalisé et pillé.
« Il fallait à chaque voyage escalader les ruines d’une maison »
Quelques voisins nous ont aidés à creuser une tranchée au fond du jardin. Elle a été transformée en abri confortable, grâce au stock de matériaux de l’atelier, à l’aide de billes de bois pour la toiture et de toile tendue sur les parois pour masquer la terre. Nous étions proches des combats, car chaque soir, un tank montait la garde dans l’entrée. Le centre de ravitaillement se trouvait dans l’école supérieure des garçons de la rue Bicoquet. J’y allais un jour sur deux chercher notre ration constituée de pain très épais qui collait aux dents et d’un bol de marmelade. Obtenir de l’eau était plus problématique. Au début, un voisin docteur avait ouvert son jardin et les réfugiés se servaient librement au puits. Il a été rapidement asséché et il nous a fallu organiser avec ma mère des voyages jusqu’à la rivière, la Noë, située dans la prairie à peu près à l’emplacement actuel du Zénith. Nous descendions par la rue Damozanne et le chemin du Pancréon. Nous tenions une lessiveuse et chacune, de l’autre main, moi un arrosoir et ma mère un seau. À l’entrée de la rue de Bretagne, au croisement de la rue du Clos-Caillet, je me souviens qu’il fallait, à chaque voyage escalader, les ruines d’une maison qui s’était effondrée dans la rue et barrait le passage. Il y avait même encore les jambes d’un cadavre d’homme ou de femme qui émergeaient d’un tas de gravats.
Nous avons été surpris un jour avec mon père dans l’atelier par des Allemands qui venaient réquisitionner les véhicules des clients qui étaient stationnés là ; ils étaient déjà en train d’essayer de les démarrer. Prudent, mon père avait cru pouvoir les garder en démontant les têtes de Delco™. Les soldats, qui n’étaient pas dupes, sont devenus très agressifs et l’un d’eux l’a plaqué brutalement contre une cloison en le braquant de son pistolet. Mon père m’a crié de m’enfuir, ce que j’ai fait rapidement. Comme j’étais en pleurs au fond du jardin, il est venu peu après pour me rassurer et m’expliquer qu’il avait joué la surprise en leur disant ensuite qu’après réflexion, c’étaient certainement les clients eux-mêmes qui avaient immobilisé leurs automobiles de cette façon.
Un jour, la maison d’un voisin a été détruite par une salve d’artillerie et nous avons vu une femme courir en tous sens en criant : « Champagne ! Champagne ! » Son mari était mort sous les décombres, mais c’était son chien qu’elle réclamait. Nous l’avons hébergée avec son animal quelque temps à la maison et avons pu constater que Champagne était l’objet de toutes ses attentions.
« Lors d’un de ces bombardements quotidiens, une inconnue m’a brusquement mis son bébé dans les bras »
Lors d’un de ces bombardements quotidiens qui nous ont pris par surprise dans la rue, une inconnue m’a brusquement mis son bébé dans les bras et est partie en hurlant. Je suis rentrée précipitamment chez nous, en passant sous la verrière, les éclats de verre cassé pleuvaient sur moi. Je me suis réfugiée dans l’abri en tremblant et, dans le vacarme assourdissant, je serrais la paume de mes mains sur les oreilles de l’enfant qui criait de terreur. À la première accalmie, je suis ressortie et cette femme s’est ruée sur moi, m’a arraché le bébé des bras tout en continuant de hurler. Je ne l’ai jamais revue par la suite.
« Un obus a décimé plusieurs personnes qui faisaient la queue »
L’épisode le plus dramatique de cette période s’est déroulé bien avant notre libération par les troupes canadiennes. Je faisais la queue pour le ravitaillement dans la cour de l’école des garçons, puis vint mon tour d’être servie. Comme je quittais l’établissement, un obus a touché le pignon du bâtiment et a décimé plusieurs personnes qui faisaient la queue, juste à l’endroit où je me trouvais quelques minutes plus tôt. Prise de panique, je m’enfuis en courant et j’ai vu les impacts des éclats trouer les rideaux métalliques des garages qui bordent la rue. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée allongée dans les décombres, et soudain, j’ai vu un véhicule rempli d’Allemands debout descendre la rue de Bayeux. Honteuse, je me suis relevée et j’ai couru jusqu’au Planitre, à l’intersection des rue de Bretagne et de Bayeux, où une nouvelle salve m’a obligée à me réfugier dans le couloir sombre d’un immeuble. Là, me pensant enfin protégée, j’ai lentement repris mon souffle pour m’apercevoir avec horreur que j’étais debout sur un corps étendu duquel sourdait une mousse rouge entourée de mouches. Je suis ressortie paniquée et une voisine, Mme H*, a juste eu le temps de m’emmener chez elle où je me suis cachée sous une table.
J’ai alors entendu d’autres explosions et j’ai hurlé : « C’est tombé chez nous ! » Puis je me suis ruée dans la rue, j’ai croisé des gens mutilés, la fille de Mme S* avait une jambe fracassée et le voisin d’en face un bras arraché. En entrant dans la cour, j’ai vu qu’un obus était tombé sur l’atelier, mais heureusement, mes parents et mon frère étaient indemnes dans la tranchée. Ensuite, tous les habitants sont sortis pour évaluer les dégâts et s’occuper des victimes, j’ai entendu quelqu’un dire : « Pauvre Mme H*… » J’ai alors répondu en criant : « Non, elle n’a rien, je viens tout juste de la quitter ! » Hélas, elle aussi avait été tuée par un éclat en sortant derrière moi pour essayer de me retenir. Nous sommes allés, par la suite, prendre des nouvelles de nos voisins hospitalisés au Bon-Sauveur.
M. L* a été abattu par des soldats allemands alors qu’il était sorti, croyant les combats terminés
Les Allemands ont, un jour, exigé que tous les civils soient évacués de notre zone car les combats se rapprochaient et les défenseurs voulaient se battre rue par rue. Mon père a pris la décision de rester et nous nous sommes camouflés dans l’abri avec plusieurs voisins. Le 6 juillet, alors que mon père était sorti pour prendre des nouvelles, nous l’avons vu revenir effondré car il venait d’apprendre que M. L*, le menuisier du haut de la rue de Bayeux, avait été abattu par des soldats allemands alors qu’il était sorti, croyant les combats terminés. Nous ne sortions presque plus et, un jour, nous avons entendu la porte du jardin s’ouvrir, puis des cris en allemand. Les soldats ont tourné autour de l’abri sans entrer.
[Note de Bruno Leverrier : soit LEFEVRE Raoul Léon Albert né à Rouen 23/10/1893 décédé à Caen 02/07/1944 cause tirs d’artillerie ou LEFEVRE ? né ? décédé 08/07/1944 cause bombardement ]
Le char a tiré plusieurs salves qui ont incendié deux maisons
Un matin, alors que nous revenions d’une énième corvée d’eau avec ma mère, en passant l’obstacle de la maison détruite, nous avons vu une colonne de soldats allemands descendre la rue de Bayeux : elle longeait précautionneusement les murs sur le trottoir de droite en épiant les façades avec méfiance. Ma mère eut le réflexe de se jeter au sol, mais je ne sais pourquoi, je lui criai de n’en rien faire et de continuer notre route. Quand nous sommes arrivées à leur hauteur, un soldat casqué a croisé longuement mon regard, avant de s’éloigner vers le centre-ville. Un peu plus tard, nous étions dans notre abri et l’ambiance nous a paru bizarre, nous avons traversé l’atelier pour regarder dans la rue à travers les interstices des volets. Le tube d’un canon est apparu au pignon du café Cherpin, suivi par un tank allié et des fantassins qui avançaient prudemment. Le char a tiré plusieurs salves qui ont incendié deux maisons. D’abord celle qui se trouvait à l’angle des rues Damozanne et Bayeux, puis celle dans le prolongement de la rue de Bayeux, à l’intersection avec la rue de Bretagne, certainement pour en déloger les derniers défenseurs allemands.
Peu après, tous les civils avaient pressenti la fin de leur calvaire et ce fut un déferlement de joie pour accueillir les libérateurs canadiens. Le cafetier, M. C*, un ancien de 14-18, hurlait dans la rue : « Ne donnez pas d’alcool aux soldats, ils vont être saouls et vont se faire tuer par votre faute ! » C’est alors que, fait incroyable, des soldats alliés sont revenus du centre-ville en escortant une colonne de prisonniers, et j’ai à nouveau croisé le regard, moins arrogant cette fois, de l’Allemand, à présent tête nue, que nous avions rencontré quelques heures plus tôt. »
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
























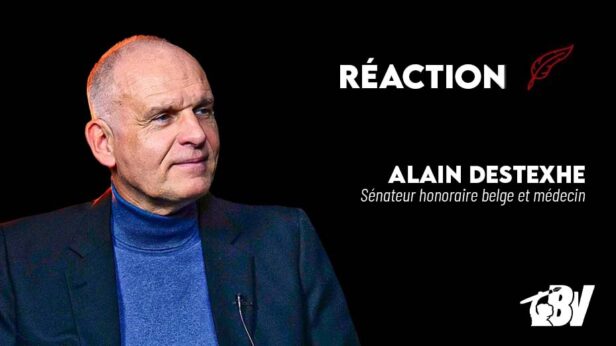










8 commentaires
Caen n’est visiblement pas Gazza aux yeux de certains. Et pourtant, n’y a t il pas une similitude?
Dans les années 50, le dimanche, lors des repas de famille, mes parents, mes oncles, tantes et grand-parents parlaient de tout. Mais après le dessert, le sujet déviait toujours sur la guerre passée.
Une autre page de l’Histoire de la fin de ce conflit mondial où pour moi est mis en exergue le sacrifice de ces populations que l’on désigne aujourd’hui par le terme de « victimes collatérales » et que l’on admet volontiers.
Mais la même situation se déroulant en ce moment, en d’autres lieux, font rugir les « protecteurs » de la veuve et de l’orphelin qui se disent « humanistes », et voudraient qu’une sélection des cibles soient faite avant intervention…
Aux fous !… Moi je reviens de voter en mon âme et conscience, pour virer tous ces hurluberlus qui veulent effacer notre pays.
Très émouvant
Que dire de plus…
Des bombardements sur les villes, tout les ports de l’Atlantique ont presque tous été rayés, personnellement j’ai embarqué à Lorient sur un sous marins basé à la BSM et à cet époque cette magnifique ville avait encore les stigmates de ce qu’elle avait subit sauf que la population était bien moins en sécurité que les allemands en ces temps là de guerre. Ignorons aussi Hambourg, Dresde … bombardés au napalm tous les habitants n’étaient pas forcément des nazis. Bon, le Japon connait çà aussi.
Chacun a sa propre guerre chacun sa vérité ce qu’il a vu et subi et le récit de tous ces souvenirs enrichit notre Histoire.
J’avais 15 ans à la libération et j’ai subi l’occupation après l’exode meurtrière avec les bombardements alliés qui ont perduré tout au long de l’occupation avec plus ou moins d’intensité selon les régions . Si Paris affamé était au cœur des conflits ,on
peut dire que la Normandie a été franchement dévastée et qu’elle a payé un très lourd tribu avec le débarquement.
Une jeune fille parmi tant d’autre qui a vécu l’horreur de la guerre .