[UNE PROF EN FRANCE] L’école trahit les vrais principes républicains
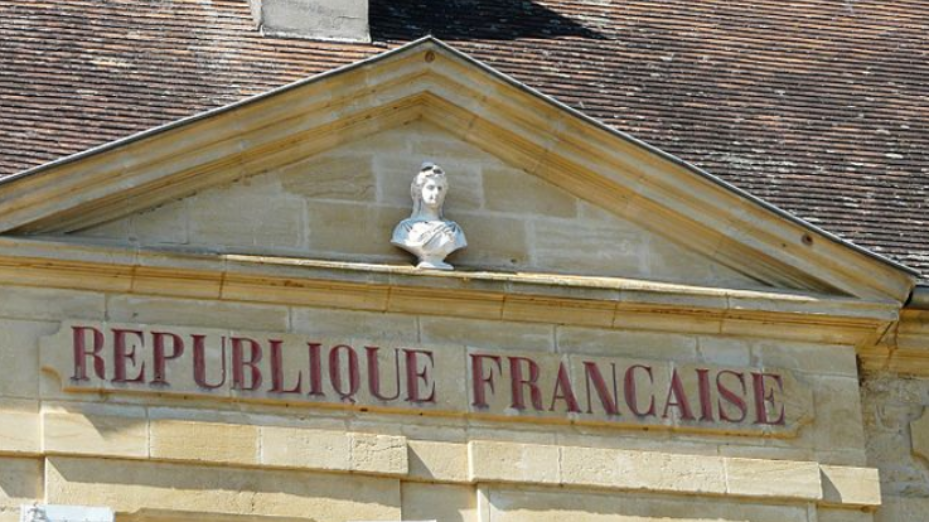
Notre nouveau (et sûrement temporaire) ministre de l’Éducation nationale entend réformer, une fois encore, la formation des enseignants. Je ne commenterai pas ici ses fraîches propositions, étant donné que pour l’instant, il est peu de dire que le dossier est assez maigre. Mais je ne laisse d’être surprise par l’usage envahissant qui est fait du terme d’école de la République, que l’on met à toutes les sauces. Nous savons tous que le terme « République » n’a plus, depuis fort longtemps, son sens premier de res publica, mais a pris une signification étroite et très marquée idéologiquement. Pour autant, la référence permanente de nos hommes politiques reste la Révolution française, présentée comme la mère de notre République. Je ne suis pas une admiratrice béate de l’œuvre révolutionnaire, loin de là, mais sur le sujet de l’école, il serait utile de relire, parfois, les textes des Conventionnels pour en saisir l’esprit et remarquer à quel point toute la construction scolaire du XXe siècle est une œuvre concertée de trahison des principes républicains.
Un principe révolutionnaire : liberté absolue de l'enseignement
Les débats de la Convention au sujet du recrutement et de la formation des enseignants sont passionnants. À une proposition visant à former un corps national d’enseignants, Antoine Thibaudeau, conventionnel élu au Comité d’instruction publique, répondit : « La Révolution vient de détruire toutes les corporations, et on voudrait en établir une monstrueuse ! Une de 172.750 individus qui, embrassant, par une hiérarchie habilement combinée, tous les âges, tous les sexes, toutes les parties de la République, deviendraient infailliblement les régulateurs plénipotentiaires des mœurs, des goûts, des usages, et parviendraient facilement par leur influence à se rendre les arbitres de la liberté et des destinées de la nation. » Thibaudeau était un défenseur farouche de la liberté absolue d’enseignement : « Abandonnez tout à l'influence salutaire de la liberté », s'écriait-il, « à l'émulation et à la concurrence ; craignez d'étouffer l'essor du génie par des règlements, ou d'en ralentir les progrès, en le mettant en tutelle sous la férule d'une corporation de pédagogues, à qui vous auriez donné pour ainsi dire le privilège exclusif de la pensée, la régie des progrès de l'esprit humain, l'entreprise du perfectionnement de la raison nationale. » Et sa voix fut suivie : le décret du 29 frimaire An II confirma cette position. Son article 1 est très clair : « L'enseignement est libre. » Cette liberté fut réaffirmée par le décret du 3 brumaire An IV, rédigé par Daunou, qui envisageait à nouveau un corps enseignant officiel mais rappelait les principes de liberté : « Nous nous sommes dit : liberté de l'éducation domestique, liberté des établissements particuliers d'instruction ; nous avons ajouté : liberté des méthodes instructives » (rapport de Daunou préparant le décret). On est bien loin de tout cela, aujourd’hui.
C’est Napoléon qui mit un coup d’arrêt à la liberté scolaire offerte par la Révolution, par la loi du 10 mai 1806 : « Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l’empire. » Le décret du 17 mars 1808 ajoute que « l'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale. » C’était le début du monopole de l’État sur l’école et sur la formation des enseignants. Mais c’est le fait d’un régime autoritaire, pas l’esprit initial de la République, qui, malgré tous ses défaut, avait à cœur de défendre la liberté dans l’enseignement. Cela amène à conclure que dans sa mainmise quasi absolue sur la formation des enfants comme sur celle des professeurs, la République actuelle, est en réalité, antirépublicaine.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR



















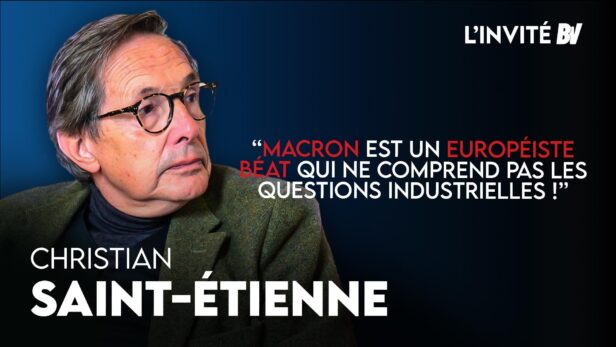





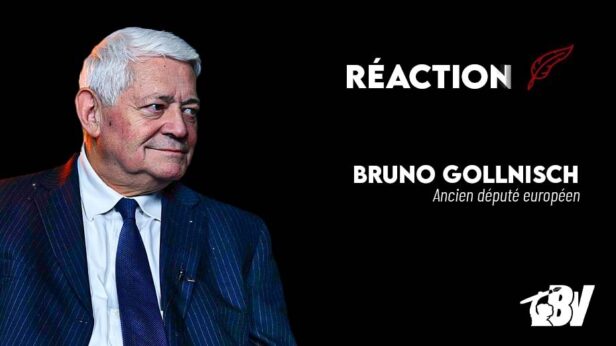




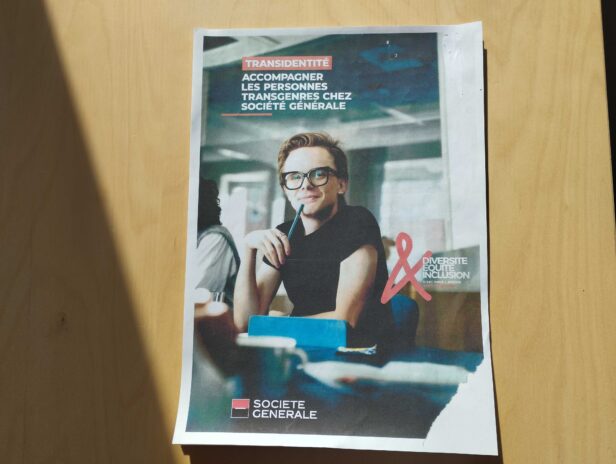




24 commentaires
Virginie. Je me suis attardé sur l’expression « je ne laisse d’être surprise » . Un internaute (négligeons la rigidité de son expression) m’a suggéré le dictionnaire académique. Une consultation qui risquait de m’entrainer dans le labyrinthe de ce dictionnaire. Mais une idée en entraine une autre…. vos difficultés face à l’IA/élèves. J’ai testé Chatbox gpt . En 3 secondes la réponse à la question. Et une réponse clairement formulée. Stupéfiant. A exploiter… Merveilleux pour les élèves.
Rétrospective interessante.
Nos fonctionnaire n’en sont pas à une contradiction près. Je suis exploitant forestier et à ce titre on me demande de régler une taxe qui s’appelle: Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) Celle la il fallait l’inventer! Alors contradiction pour contradiction il faut bien s’y faire.