Wokisme et féminisme se portent bien mal, au pays des mangas

Au Japon, une élue qui demandait qu’on installe dans les toilettes publiques des protections menstruelles gratuites a reçu plus de 8.000 menaces de mort.
Elle s’appelle Ayaka Yoshida, elle a 27 ans et est élue de l’Assemblée préfectorale de Mie, située entre Tokyo et Kyōto. Une performance, dans un Japon qui se situe au 164e rang – sur 190 pays – du classement de la parité en politique. L’Assemblée nationale ne compte, d’ailleurs, que 45 députés femmes sur 465 sièges, et la loi de 2018 « pour promouvoir la participation commune des hommes et des femmes dans le domaine politique » (c’est son titre) a été appliquée pour la première fois au scrutin de 2021. C’est, paraît-il, la faute à Confucius qui, depuis le Ve siècle avant Jésus-Christ, inspire la société nippone.
Hermétique au changement, le Japon ?
Si, géographiquement, l’océan Pacifique sépare le Japon de l’Amérique, dans les têtes, c’est à l’échelle d’une galaxie. Certes, les distances avec l’Amérique trumpienne vont sans doute se réduire, comme en témoigne aujourd’hui l’affaire de l’escrimeuse Stephanie Turner qui a refusé de combattre avec un(e) adversaire transgenre, mais c’est peu dire que wokisme et féminisme se portent mal, au pays des mangas.
Loin d’être une exception, l’attaque contre Ayaka Yoshida n’est qu’un épisode dans une guerre larvée. Un professeur de sociologie de l’université d’Hiroshima et conseiller au « bureau de consultation sur le harcèlement » de l’université le confirme auprès du South China Morning Post, repris par Le HuffPost : plus la société s’éloigne de ses carcans traditionnels, plus « le harcèlement des femmes est extrême et fréquent ». Au point, dit-il, que « chaque fois qu’une femme politique fait une déclaration ou rédige une proposition, elle est presque systématiquement attaquée ».
Le Japon campe sur ses traditions, solides et pour l’instant inébranlables, ce qui rend les réactions à « l’émancipation féminine » d’autant plus virulentes. « Ces attaques masculinistes ciblent particulièrement les femmes lorsqu’elles se mobilisent pour leurs droits, qu’il s’agisse de questions relatives à la santé, au soutien aux mères qui travaillent ou aux violences sexistes et sexuelles », poursuit Chisato Kitanaka.
Un bilan démographique catastrophique
Un dossier du magazine Géo de mars 2024 dressait un portrait en effet peu flatteur de la société japonaise, entre interdictions ancestrales faites aux femmes, concours de beauté qui rappellent étrangement ceux des petites Miss de l’Amérique profonde, frein voire entrave aux carrières professionnelles pour celles qui l’ambitionnent, et même « harcèlement » des mères au point que la pratique porte un nom : le matahara. Toutes choses qui se combinent avec l’image hyper-sexualisée des femmes, y compris des adolescentes et parfois des fillettes. Une mode trouble qui flirte parfois avec les fantasmes pédophiles, mais sacralisée à l’international comme marqueur de la pop-culture asiatique. C’est ainsi qu’on verra, prochainement, circuler dans les rues de Toulon, à l’occasion du festival Mang’Azur, des jeunes femmes en jupette rose bonbon, socquettes et couettes à rubans.
Ce n’est pas en braquant le projecteur sur la gratuité des protections périodiques qu’on peut faire bouger une société encore si corsetée dans les rôles dévolus à chacun. Le grand drame du Japon est la crise mortifère de la natalité. Le bilan démographique y est, chaque année, plus catastrophique, le taux de fécondité s’établissant à 1,15 enfant par femme, pour l’année 2024, quand il devrait être au minimum de 2,1 pour garantir la stabilité de la population. Contrairement à ce qui se produit dans nos sociétés occidentales, « pour des raisons culturelles et institutionnelles, les enfants nés hors mariage sont très rares », au Japon. On voudrait s’en réjouir, sauf qu’à vouloir contenir éternellement les femmes dans un rôle de subalternes qu’elles sont de plus en plus nombreuses à rejeter, on n’aboutit qu’à créer une société de célibataires.
Selon une enquête de Recruit, en février 2024, 34,1 % des Japonais célibataires âgés de 20 à 49 ans disent n’avoir jamais eu de relations amoureuses. Quant au mariage, il est largement démonétisé, puisque « les femmes déclarant ne pas vouloir du mariage expliquent que se marier limiterait leur champ d’action (40,5 %) », et les hommes « craignent à 42,5 % de perdre leur marge de manœuvre financière ».
Qui s’étonnera, après, que le Japon soit l’un des pays qui pratiquent le plus « la sologamie », cette nouvelle tendance qui consiste à se marier avec soi-même…

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR




















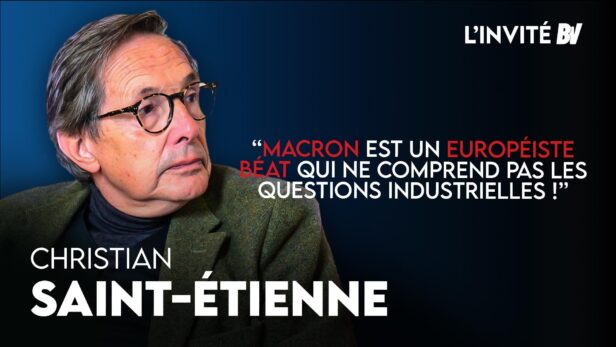





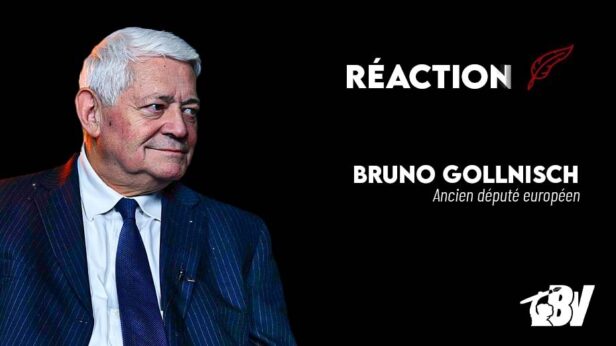




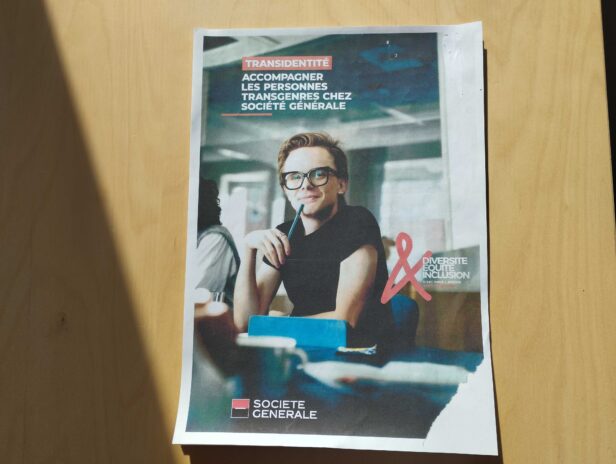





21 commentaires
Ce qui est dit dans cet article est vrai mais omet de dire que la baisse de la natalité et la « sologamie » est liée à l’urbanisation de la vie et aux coûts que cela représente, l’immobilier en particulier.
C’est aussi en partie ce qui se passe en France. D’où le rêve des partis de gauche de faire vivre tout le monde en ville. Cette baisse de la natalité leur permet d’arriver plus vite à leur but.
Les chiffres sont vertigineux !
« La sologamie » (sourire) L’égoïsme de ces Japonaises & Japonais est effarant. A titre individuel, admissible, mais jusqu’à 40 & 42% ! A ce train là, le Japon n’existera plus ?
« Décroissance apaisée et ordonnée qui n’est absolument pas un problème » Guillaume P ? Il faudrait développer !
Quant au wokisme, pas stupides les Japonais !
@Yaya
La France a un avenir qui sera un mix du Liban pour la guerre civile inter-cultures et de Venezuela pour l’économie néo-soviétique. À côté, le Japon est un rêve de prospérité de sécurité et de paix.
.
Une fois descendu à 70 millions d’habitants avec plein d’espaces et d’opportunités, le Japon pourra tout à fait adopter des politiques natalistes et en faveur des familles nombreuses pour arriver à la neutralité.
Beaucoup trop tard pour une politique nataliste !
Trop tard aussi pour ma réponse.
… la sologamie ? ce n’est pas ce qu’on appelait poliment l’onanisme ?
Oui mais là au moins, on fait l’amour avec quelqu’un qu’on aime…
Il n’y a aucune raison que les protections mensuelles soient gratuites .
Il ne s’agit pas d’une maladie …on en parle trop.
Pour connaître « un peu » le Japon, je n’ai pas bien compris la relation que vous faites entre « culture MANGA » qui date de très longtemps et le wokisme ! …
Le « féminisme » poussé à outrance n’est pas à relier avec la culture MANGA car c’est tout sauf du féminisme …
J’avoue ne pas comprendre cette demande de protections périodiques, gratuites ou pas.
« De mon temps », les femmes étaient discrètes sur ce sujet touchant à leur intimité, elles avaient ce qu’il fallait dans leur sac à main et voilà ! Si vraiment il fallait mentionner la chose, nous déclarions être indisposées. Ce mot est désuet de nos jours.
Vous avez raison, il n’y a plus de pudeur, en tant que femme je suis mal à l’aise
C’est la gauche hein. Depuis Lénine leurs idées sont toutes stupides et toxiques (et non, elle n’a même pas inventé le social).
Votre pays est en train de mourir à cause de la gauche qui a détruit l’économie et toutes le valeurs traditionnelles, laissez tranquille le Japon qui va aussi bien que possible et foutez nous la paix avec votre néo-féminisme mortifère.
La dénatalité est mondiale, les gens riches ne font plus d’enfants, mais le japon opère une décroissance apaisée et ordonnée qui n’est absolument pas un problème.
Arrêtons de penser que la baisse démographique est un problème.
À l’heure où les tâches vont être partagées entre les robots et l’intelligence artificielle, il est temps de revoir notre course effrénée vers la surpopulation, qui fait quelques très privilégiés dans un océan de miséreux.
La grandeur d’un pays de voit à sa classe moyenne.
Car, à tout prendre, je suis sûr que peu de français n’echangeraient pas leurs problèmes avec ceux d’un japonais lambda. Même les femmes, soi-disant opprimées par une lecture très hasardeuse du passé mais qui, a y regarder de plus près, ont énormément perdu à « s’émanciper ».
Pour naviguer entre plusieurs femmes en ce moment, je peux vous assurer qu’elles n’ont fait que s’affranchir de maîtres protecteurs et bienveillants au profit de maîtres et maîtresses très intrusifs et intéressés, voir pervers que sont les magazines féminins et les livres de développement personnel.
Sans doute, contrairement à vous, j’ai vécu au Japon qui est loin de la caricature faite dans cet article. Oui les femmes sont des femmes qui s’habillent, se comportent, aiment avec des valeurs qui ne sont pas celles de l’Occident ou plutôt pour une large part qui ne sont PLUS celles de l’Occident. Un peu comme certaine société du sud de l’Europe, la femme fait la loi à la maison si bien que nombre des collègues après le travail prenaient leur temps pour rentrer chez eux. Je n’ai pas senti au début des années 2000 que les femmes dans ce beau pays étaient frustrées ou prisonnières du patriarcat mais féminines, très bien habillées et éduquées, bosseuses et aucunement misandre.
La seule parité acceptable est celle de la compétence, sinon on a des Ersila, Marion etc.
Marion ? Ah bon ? Je pense au contraire que nombre d’hommes devraient s’inspirer de ses compétences et de son courage ainsi que de sa verve.
Je pense qu’Aérotrain49 voulait dire Manon (Aubry)
@Aérotrain49
Ersila, Marion, etc.
Que vient faire Marion dans le même bain qu’Ersila ?
Dix océans au minimum séparent ces deux femmes.
Ou alors, je n’ai pas compris votre propos.
Peut-être Aérotrain 49 veut-il dire Marion Aubry ? Du moins c’est ce que je pense .
Merci à Cavok qui éclaircit le commentaire.